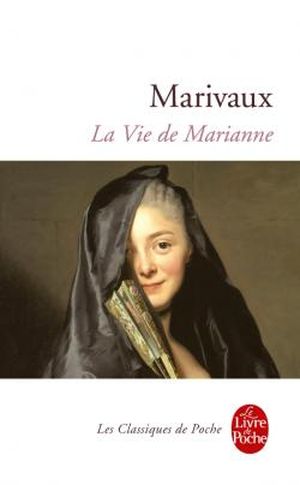Marivaux est un vrai multitâche de son temps : dramaturge avant tout, vous le connaissez peut-être moins sous ses jours de romancier ou de journaliste. D’un côté, le « marivaudage » qu’on lui connaît se retrouve bien davantage dans ses très fameuses pièces de théâtre ; en-dehors de cela Marivaux est pourtant un stylisticien assez remarquable dans sa prose. Pour le meilleur… comme pour le pire.
La Vie de Marianne, c’est un roman écrit en onze ans, sans même avoir été terminé. Une Continuation a bien vu le jour une ou deux décennies plus tard, mais pour qu’elle-même demeure inachevée, ça en valait le coup dis donc… On peut dès lors voir ce roman-feuilleton comme un récit maudit, depuis même sa rédaction et sa parution à l’irrégularité atterrante, son lectorat devant attendre de trois ans à quelques jours pour lire une partie sur l’autre.
Passons donc sur l’étude de mœurs et des caractères de la noblesse française du siècle, qui entre psychologie et sociologie confine presque au naturalisme à certains égards. Concentrons-nous sur la lecture du roman en elle-même, qui s’avère bien plus… pointue ? Harassante en tout cas.
C’est un roman long, lent et éprouvant. D’un côté parce que le style de Marivaux ne profite pas de l’aération qui peut rendre un Proust passionnant malgré la difficulté de lecture, puisque La Vie de Marianne est écrit avec telle uniformité et telle lourdeur qu’il est très difficile de s’accrocher pleinement. Marivaux ne montre ni distance ni placidité à l’égard de son récit, et donne l’impression de le cracher. Pas très agréable…
Si au pire il pouvait y avoir de certains appâts dans le sujet traité, mais sorti des mœurs et caractères susévoqués, Marianne elle-même est un personnage sans le moindre charme. Si on prend effectivement pitié de ses premières mésaventures et de sa relative malchance, elle devient très vite une espèce d’enfant gâtée insupportable. Le plus sincèrement du monde, j’exagérerais à peine en vous énumérant, minimum, une occurrence de pleurs toutes les deux pages dans ce roman, pour des prétextes bien plus souvent futiles que véritablement malheureux à la longue. Que ce soit en tombant dans les bras d’une bienfaitrice, en re(re[re{re}])racontant ses infortunes, en en subissant une nouvelle, en réfléchissant à ce qu’il convient de faire, qu’il s’agisse de Marianne ou de n’importe quel autre personnage, tous féminins bien entendu, on en est servi à toutes les sauces et pour tous les goûts ! Une telle explosion lacrymale rend très vite ce roman toujours plus lourd et indigérable, les larmes prévalant partout et sur tout, au point d’en faire l’apparent ressort stylistique principal, ce qui confine presque au maniérisme...
Et puis franchement, que ça soit avec cette Marianne, Manon Lescaut, Les Egarements du cœur et de l’esprit ou encore Justine (même si pour le coup je l’aime bien celle-là), j’ai toujours ce problème de crédibilité du roman-mémoire ; d’accord, peut-être qu’au XVIIIe siècle les gonzes de la cour étaient plus cultivés et intelligents que nous [sarcaaasme], mais franchement comment les auteurs présumés peuvent-ils se souvenirs de conversations aussi longues et aussi croustillantes de détails ; comment d’aussi longues histoires peuvent-elles êtres racontées d’un seul trait en moins d’un soir…
Restons-en au théâtre de Marivaux, hein, s’il vous plaît, à l’avenir…