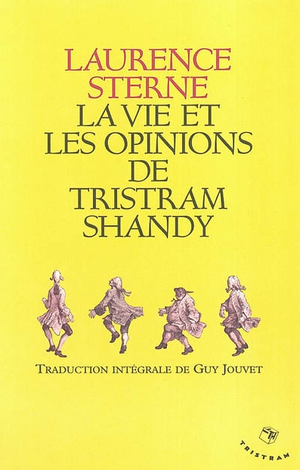Dans le "Tristram Shandy" — oui, on peut abréger le titre, comme pour "la Recherche" et le "Voyage", j’en connais même qui écrivent « le "T.S." » quand il n’y a pas de risques de confusion avec "le Troisième Sexe" de Willy — on trouve de tout : une quarantaine de pages tout de même consacrées à l’intrigue, et le reste aux digressions, portant notamment sur l’obstétrique, la critique, la métaphysique, la poliorcétique et le cul. Principalement en filigrane pour le cul. Enfin, quand j’écris « en filigrane », c’est au sens figuré, il n’y a pas de vrai filigrane dans le papier, autant prévenir d’avance — de rien pour le pléonasme — le lecteur qui aurait entendu parler des audaces formelles du "T.S." et de l’importance que L.S. accorde à la matérialité de l’écriture : majuscules, tirets, typographie, police de caractères, etc.
Le livre se lit plutôt qu’il ne se déchiffre, en tout cas il n’attaque pas les réflexes du lecteur aussi violemment que certains volumes de la liste, très bonne soit dit en passant, « Ils jouent avec la page* ». Mais il part absolument dans tous les sens, multipliant crochets et coqs-à-l’âne. Je n’aime pas étayer un jugement sur une œuvre d’art en lui appliquant l’expression « pour l’époque », mais il faut reconnaître que "T.S." est novateur. Pour l’époque. 1759-1767. Enfin, je dis « pour l’époque », mais c’est à relativiser. : il faut croire que la tradition de régularité et d’élégance de la littérature française a laissé des traces profondes, à voir le temps perdu avant d’importer Shakespeare en France et, de nos jours, le statut relativement mineur dont y jouissent un Sterne ou un Cervantès, ou même le rôle de bouffon un peu inconséquent dévolu à Rabelais, qu’on a laissé rentrer dans la boîte parce qu’il était avec des potes mais qu’on a placé sous la surveillance rapprochée de quelques vigiles des Belles-Lettres. Et je ne parle même pas de la littérature de fantaisie plus ou moins allégorique, tolérée chez Swift, Carroll ou dans un autre registre Kafka, mais dont "on ne veut pas chez nous".
Mais je m’égare. Je parlais du caractère novateur du "T.S.", caractère qu’il faut replacer en contexte pour le saisir, et qui depuis a été surpassé même par des œuvres moins ambitieuses, mais qui peuvent avoir quelque chose de monstrueux.
Cela dit, le livre de Sterne n’est pas qu’une curiosité historique dont le seul intérêt serait d’être « fondatrice » de quelque chose. En s’armant d’un peu de patience et d’attention, et une fois passé le cap des cent premières pages, un lecteur du XXIe siècle y trouvera un agréable « roman sur rien » aux personnages intéressants, et l’occasion de rire un peu et de se cultiver en passant.
La poliorcétique est l’art d’assiéger ou de défendre des places-fortes.
* http://www.senscritique.com/liste/Ils_jouent_avec_la_page/34872
Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur.