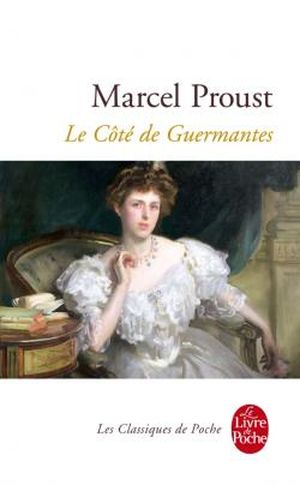C’est tout de même émouvant car, tandis que le narrateur faisait son entrée dans le monde, j’ai eu l’impression, moi aussi, d’être, en quelque sorte, arrivé chez Proust. Peut-être les graines qu’avait semées la lecture des deux premiers tomes, il y a un an, ont-elles germé... D’autant plus facilement, sans doute, que ce troisième tome est celui des retrouvailles : avec Saint-Loup, avec Charlus, avec Albertine. Quoi qu’il en soit, mon plaisir de lecteur fut profond et constant : le raffinement analytique, l’acuité et la sensibilité de l’observation, la richesse du jeu des métaphores et des correspondances qui fait se ramifier, à partir du moment subjectif, les souvenirs, les rêveries, les impressions, les citations littéraires et les références historiques – ce qui nous donne droit à cent cinquante pages de dîner… – et, surtout, la drôlerie – mais tout ceci, on le sait déjà.
Pourtant, j’ai ressenti ce roman de formation avant tout comme un livre sur l’incompréhension. Le Narrateur multiplie les malentendus – avec Saint-Loup dont il ne comprend pas le salut trop raide, avec un Charlus louis-quatorzien dont la colère le laisse perplexe ou avec le désir d’Albertine, douloureusement différé par rapport au sien (ce que Prosut sublime dans la scène drôle et émouvante des premiers émois). Comme le dit la duchesse de Guermantes, « on a entre soi et chaque personne le mur d’une langue étrangère ». Cet espèce de « babélisme » contamine tout le livre, du langage farouche de Françoise à la lettre mêlée de barbarismes et de citations poétiques du jeune valet de pied, ds tournures « Guermantes » mal assimilées par la princesse de Parme au vocabulaire fraîchement acquis par Albertine, qui stimule le désir du narrateur.
L’introduction du Narrateur dans les salons devient ainsi la métaphore de l’entrée dans un monde autre, peuplé de signes à interpréter, et face auxquels il convient de se placer judicieusement. Quelques douloureuses que soient ces impressions nouvelles : voir la poignante description de sa grand-mère qu'il surprend soudain vieillie, à son insu en rentrant de Doncières. Cet effort qui consiste à faire coïncider le réel (et ses impressions chatoyantes que la phrase proustienne rend à merveille) avec les noms et les concepts reconnus et transmis – par exemple le jeu de la Berma avec l’idée du « bon jeu » – est une définition particulièrement émouvante du passage à l’âge adulte. C’est un travail douloureux, qui succède toujours à une première déception, et dont les rêveries récurrentes sur les noms (ce sont décidément mes passages préférés chez Proust !) sont la plus sublime illustration.
Mais la langue la plus capricieuse est bien la langue intérieure. L’une des pages les plus bouleversantes du livre (qui est peut-être un jalon important dans La Recherche) décrit la première palpitation de l’œuvre à venir, lorsque, dans la voiture où il attend Saint-Loup, le soir qui tombe rappelle au Narrateur les arrivées nocturnes à Combray. Le retour de son ami brise cette fragile remémoration, qui lui aurait permis de mettre en chantier une ambition littéraire qui, pour l’heure, demeure stérile.
Dernier langage, et pas le moindre : celui des artistes. Le roman théorise ce qui apparaissait déjà dans les premiers tomes, développant cette idée selon laquelle, pour citer Oscar Wilde, « la nature imite l’art » : le monde « n’a pas été créé une fois, mais aussi souvent qu’un artiste original est survenu ». C’est ainsi que le Narrateur surprend, à Doncières, un « inestimable Rembrandt » dans un « taudis » mal éclairé, ou quelque effet de Turner dans le spectacle, contemplé depuis la fenêtre, des valets qui font le ménage chez Madame de Plassac. Sans Rembrandt ni Turner, le taudis et l’immeuble parisien seraient restées impénétrables et muets. Et désormais, avec Proust, parler au téléphone ou mettre des boules Quiès devient également une aventure esthétique…
(Et j’adore les généalogies !)