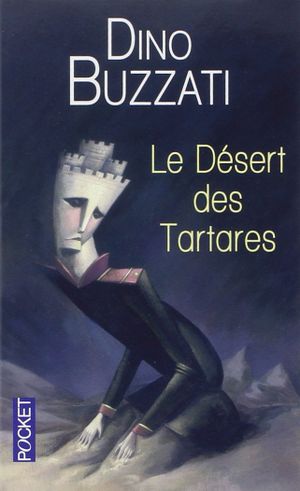[Cette critique s'adresse à celles et ceux ayant terminé le livre.]
Avez-vous déjà ressenti ce curieux sentiment d'engourdissement du corps et de l’esprit que l’on appelle l’ennui ? Il y a un instant, nous traversions l’existence sans nous en soucier. Peut-être nous guettait-il alors, tapi dans l'ombre. Dès l’instant où il frappe, un rideau gris s’abat sur le monde et des gouffres sans fond s’ouvrent sous nos pieds. Commence alors l’errance, la lutte contre le monochrome et l’ascension vers un état de grâce subitement perdu. L’ennui nous dévitalise, il fait nous des loques, et seule sa fin prochaine nous le rend supportable. Le médecin finira bien par nous sortir de cette salle d’attente, le train arrivera en gare, la position de deux aiguilles sur un cadran libérera des milliers d’écoliers. On en aura perdu, du temps, la mort se sera insidieusement rapprochée, mais en on s’en sortira. À chaque fois cependant, l’inquiétude nous traverse : qu’arriverait-il si l’ennui devait durer toute une vie ?
Le Désert des Tartares condense la totalité de son récit dès l’incipit, dans lequel nous découvrons Giovanni Drogo à l’orée de sa vie d’adulte, prêt à quitter la ville et l’académie militaire pour devenir soldat au fort Bastiani. Enfin, une glorieuse existence s’annonce devant lui ! Il s’élance fièrement, mais déjà quelque chose le chiffonne. Son uniforme lui sied mal, pour commencer. Ce n’est pas vraiment ce qu’il avait imaginé comme départ, on est bien loin des représentations du héros quittant le foyer. Peu après, le narrateur nous indique que sa mère conservera la chambre de son fils telle qu’elle a toujours été, avec le vain espoir d’arrêter le cours du temps. Mais les dés sont jetés pour Drogo, comme le symbolise son lent et sinueux parcours vers le fort à travers l’épaisseur de la nuit. Ainsi commence une vie d’ennui, de surveillance et d’attente, comme le souligne ce passage de la première partie de l’œuvre :
“Au lieu de cela, Giovanni Drogo, étendu sur le petit lit, hors du halo de la lampe à pétrole, fut, tandis qu’il songeait à sa vie, pris soudain par le sommeil. Et cependant, cette nuit-là justement -oh ! s’il l’avait su, peut-être n’eut-il pas eu envie de dormir- cette nuit-là, justement, commençait pour lui l'irréparable fuite du temps.” (p. 55)
Ce motif du passage du temps et de son inéluctabilité est omniprésent tout au long du roman, et nous le ressentons d’abord à travers les personnages. La première rencontre de Drogo avec un officier du fort a lieu hors de l’enceinte, alors que le jeune soldat peine à en trouver le chemin. Il s’agit d’Ortiz, qui deviendra bientôt l’ami du héros mais qui pour l’instant s’en tient à une distance toute réglementaires. Les deux hommes discutent des professeurs de l’académie militaire. Mais Ortiz est vieux, et ses années au fort lui ont fait oublier tous ces gens de la ville. Nous nous rendons compte en même temps que lui qu’il ne connaît plus le nom d’aucun des formateurs, révélant ainsi que personne n'échappe à l’oubli. Peu après son arrivée, le jeune officier rencontre le tailleur Prosdocimo qui semble vivre ici depuis des temps immémoriaux, travaillant avec ses assistants dans les souterrains de l’édifice. Ce personnage est construit à la fois sur une opposition avec le protagoniste, c’est un vieillard qui s’adresse à un bleu ; mais il représente surtout un sinistre augure, une projection du futur de Drogo s’il venait à s'éterniser dans cet endroit. Cependant, les deux hommes s’accordent sur un point : leur passage ici n’est que temporaire, ils sont appelés à un destin bien plus grand que celui de pourrir dans ce vieux rade déserté par la gloire. Les relations entre les personnages, enfin, souffrent de cette “irréparable fuite du temps”. C’est ainsi que le soldat, revenu en ville pendant une permission, trouvera le monde changé : sa mère et sa promise sont désormais des étrangères, et les ponts construits par elles dans l’attente sont désormais trop courts pour combler le fossé qui les sépare de Drogo. Chacun se tient à une extrémité, désireux peut-être de rejoindre l’autre mais pris au piège par la course des jours.
Un autre vecteur du passage du temps dans le roman est le fort lui-même. Isolé aux frontières du pays dans la fonction absurde de surveiller un désert, la moindre de ses pierres porte la marque du passé. Avant même d’y pénétrer, Giovanni Drogo compare le mouvement des soldats sur le chemin de ronde à celui d'une pendule. Et bien vite, le clapotis régulier des gouttes qui s’échappent de la citerne rythme les nuits de l’officier, comme un rappel constant des minutes écoulées. C’est la structure entière qui semble soupirer de regrets lorsque l’on se penche sur lignes suivantes :
"La nuit, dans les chambrées, les planches à paquetages, les râteliers d'armes, les portes et même les beaux meubles en noyer massif de la chambre du colonel, tout ce qu'il y avait de bois au fort, y compris les boiseries les plus anciennes faisaient entendre des craquements dans l'obscurité. Parfois, c'étaient de brefs éclatements, semblables à des coups de pistolets, il semblait vraiment que quelque chose se fut brisé, on se réveillait et on tendait l'oreille : mais l'on ne parvenait à entendre que d'autres craquements qui chuchotaient dans la nuit. C’est l'époque où un regret tenace de la vie ressuscite chez les vieilles planches. Il y a très longtemps, aux jours heureux, elles connaissaient alors un afflux juvénile de chaleur et de force, des bouquets de bourgeons sortaient des branches. Puis la plante avait été abattue. Et maintenant que c’est de nouveau le printemps, un frisson de vie, infiniment léger, s’éveille encore dans chacun de ses fragments.” (p.166)
Le vieil édifice murmure aussi sa peine, celle d’un glorieux passé relégué aux oubliettes du pays et presque moqué par les soldats de l’extérieur. La seule échappatoire dans ce lieu hors du temps est la nouvelle redoute, poste d’observation quelque peu éloigné et dont l’épithète tranche avec la nature ancienne de la structure-mère. C’est d’ailleurs de là-bas que viendront systématiquement les quelques rebondissements qui jalonnent Le Désert des Tartares.
Mais parler ici de rebondissements est peut-être exagéré, tant le récit se déroule dans la plus grande des linéarité. Là encore, le projet artistique de l’auteur est sans doute de nous faire ressentir l’ennui dans lequel s’enfoncent les personnages. Nous assistons quasiment à de l’anti-action tout au long du roman, ponctuée de brefs moments d’espoir toujours déçus, comme lorsque des intrus sont aperçus dans le Désert avant que l’on se rende compte qu’ils sont des militaires de la ville venus en reconnaissance. Comme toujours, l’étincelle de l’aventure est éteinte avant que le feu ne puisse embraser le cœur des Hommes.
Au-delà du fond, le motif temporel est présent dans le style même du texte, approchant encore un peu plus le lecteur de la détresse du personnage principal. Dans ce roman, les lignes ont un poids et peuvent parfois nous assommer, ce que l’on pourrait reprocher à Buzzati s’il ne s'agissait pas du cœur même de son propos. Les longues journées sans but se reflètent dans les mots de l’auteur, ainsi la chute de Drogo dans le gouffre de l’ennui est-elle par exemple caractérisée par une anaphore de l’adjectif “habitué” à la page 83. À force de s’être habitué à tout, il est bel est bien prisonnier, au même titre que le lecteur, d’un quotidien banal qui engourdit les sens. On ne revient à nous que lorsqu’une gigantesque ellipse de deux années nous percute en même temps que le personnage. Elles seront dès lors nombreuses à ponctuer le roman, s’étalant de quelques semaines à plusieurs décennies. Nous sommes désormais prévenus, voilà ce qu’il arrive quand on laisse filer le temps !
Si le lecteur comprend assez vite que Giovanni Drogo est le prisonnier de sa propre existence, il peut alors s’interroger sur les raisons qui le poussent à rester au lieu de fuir. Après tout, rien ne lie réellement le lieutenant à ce misérable rocher surplombant le Désert. Plusieurs occasions de fuite lui sont même offertes, qu’il repoussera toujours pour rester un peu plus. Lorsqu’enfin il se décidera à demander une mutation, la roue de la Fortune aura tourné en sa défaveur : un général de la ville refusera d’accéder à sa requête, dans une scène absurde combinant une critique acerbe de l’administration et l’effondrement des illusions du personnages (c’est d’ailleurs pour ce genre de scène que Buzzati est souvent comparé à Kafka). Mais si l’enlisement et la fuite du temps constituent à coup sûr certains des barreaux de la prison de Drogo, ils ne sont assurément pas les seuls.
Le fort exerce lui-même sur ses habitants une fascination qui les pousse à prendre racine entre ses vieilles pierres. Les nombreuses descriptions de l’édifice mettent en avant la vacuité et le silence des lieux. Dans cette vieille bâtisse dont la gloire a terni, des hommes trop peu nombreux errent en quête de sens. Il n’est d’ailleurs pas rare d’y croiser des personnages touchés par ce que le narrateur décrit au chapitre VII comme une maladie ("Il n’y avait pas de remède, nous sommes ainsi faits, [...] et jamais nous en guérirons.") Les militaires qui s'attardent au fort des années durant semblent en effet touchés par ce mal qui les emprisonne dans les limbes. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui se laissent aller à parler des vieilles légendes venues du Désert. On raconte, dans l’espoir de conjurer le sort, avoir vu un jour du mouvement au pied des falaises. Mais en réalité, les gouttes qui s’écoulent de la citerne et deviennent le métronome de cet endroit sinistre. Les instants se muent en années sans qu’on puisse reprendre la barre, et pourtant…
“Et pourtant un reste d’enchantement errait le long des murailles des jaunes redoutes, un mystère persistait obstinément là-haut, dans les recoins des fossés, à l’ombre des casemates, l’inexprimable sentiment de choses à venir.” (p.198)
Les barreaux les plus solides de la prison de Drogo sont à coup sûr ses ambitions. Dès les premières lignes du récit, il déprécie son allure en la comparant avec celle des héros militaires qu’il a toujours imaginée. Si cet acte nous renseigne sur la représentation de l’honneur qu’a construit le jeune homme, il est aussi annonciateur du mal qui rongera le soldat et ses compagnons toute leur vie : le désir de gloire. C’est cette vaine quête qui permet aux hommes de supporter le vide de l’existence, mais c’est un but impossible qui les condamne finalement au malheur. Mille fois Drogo aurait pu s’échapper, rejoindre la ville ou une autre affectation. Mais…
“C’est du désert du Nord que devaient venir leur chance, l’aventure, l’heure miraculeuse qui sonne une fois au moins pour chacun. À cause de cette vague éventualité qui, avec le temps, semblait se faire toujours plus incertaine, des hommes faits consumaient ici la meilleure partie de leur vie” (p.198)
La seconde partie de cette citation nous révèle que le narrateur et par extension le lecteur ne se font pas d’illusion sur le sort qui attend les habitants du fort Bastiani. Nous observons en conscience le personnage principal s’enfoncer dans la vanité tout au long du récit. Celle-ci peut être motivée par des événements ponctuels comme l’aventure de la longue-vue ou bien la présence d’une troupe au sein du désert, mais elle constitue surtout un rêve commun pour toutes ces existences moroses. Comment supporter toutes les conditions que nous avons décrites sans se bercer d’illusions ? Ce sont ici les mirages de l’amour-propre qui sont à l'œuvre et qui mystifient les personnages. Si l’ héroïsme constitue leur seule échelle de valeur, pouvons-nous vraiment nous étonner que cette troupe refuse de quitter un poste inutile ? L’espoir, si maigre soit-il, d’être un jour couvert de gloire enivre assez Drogo pour le pousser à oublier la réalité de son existence. Dès lors se juxtaposent la vie rêvée et la vie réelle, comme l’exprime le narrateur dans le chapitre VI. Il procède alors à un montage romanesque qui met en parallèle ces deux existences pendant que le lieutenant écrit une lettre à sa mère. C’est à cette occasion qu’il choisit de lui mentir en enjolivant ses conditions de vie, l’utilité du fort Bastiani et l’avancement auquel il est promis. Le lecteur comprend dès lors quel poids les illusions peuvent peser.
L’idée d’un “destin heureux qui le mettait au-dessus des autres hommes” (p.106) emprisonne la pensée du personnage principal, mais aussi de ses camarades. Combien se vantent en effet de ne subir ce misérable destin que pour quelques temps seulement. Après tout, ne les tient-on pas en haute estime, ailleurs, en ville, là-bas ? Difficile ici de ne pas relier cette attitude à celle du personnage qu’incarne Jacques Brel dans sa chanson “La ville s’endormait”, et qui déclame : “On m’attend quelque part, comme on attend le roi”, avant de se résigner : “mais l’on ne m’attend pas…”. D’autant plus que l’on sait le chanteur familier avec le roman de Buzzati puisqu’il lui a consacré la chanson Zangra en 1962. Le récit amène rapidement à penser cette vaine gloire comme la vraie maladie qui touche les personnages et enferme leur vie dans une cellule de représentations. Mais l’affaire prend une tournure plus dramatique lorsqu’elle coûte la vie au jeune Angustina. C’est en effet tout au long du chapitre XV que se dessine une vive critique de ce désir de briller, à travers des pages qui mettent en concurrence les soldats de la ville et ceux du fort. Ces derniers, soucieux de rattraper leur retard et de ne pas perdre la face, négligeront leur sécurité jusqu’à provoquer la mort d’un des leurs. Prisonnier de l'idée qu'il se fait du héros, Angustina se laissera en effet mourir de froid par une nuit glaciale, et paiera de son sacrifice la vanité de tous.
Cette critique mériterait d’être étoffée si elle voulait parler un peu plus de cet immense roman. Il y aurait fort à dire sur sa dimension absurde par exemple, ou bien sur la critique qu’il fait de l’autorité et du règlement, celui qui vous pousse à braquer un fusil sur vos amis. L’horizon des non-évènements du récit peut sembler âpre et stérile, mais l’on s’aperçoit bien vite que cette vacuité apparente est toute entière comblée par les questions soulevées par l'œuvre. Quel but trouvons-nous à notre existence ? Nous, qui rions du lieutenant Giovanni Drogo, sommes-nous bien certains de ne pas lui ressembler ? Sommes-nous capables de nous extraire de la prison de l’habitude et du confort pour aller au delà des derniers mots d’Angustina : “Demain, il faudrait…” ?