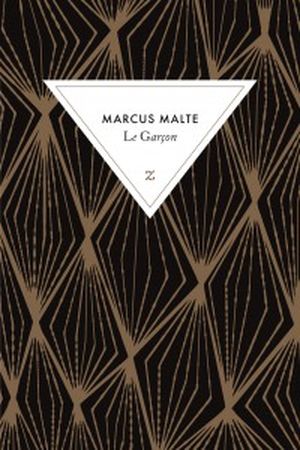Le garçon est un héros sans nom ni voix. Un enfant sauvage élevé par sa mère au fin fond de la Provence, près de l’étang de Berre. A la mort de sa génitrice, il quitte sa terre natale et découvre pour la première fois ses semblables. Livré à lui-même, ne connaissant rien des usages du monde, le garçon parcourt avec innocence le début du 20ème siècle, d’un hameau perdu aux champs de foire, d’une vie de bohème aux grands boulevards parisiens, des tranchées de la Grande Guerre au bagne de Cayenne et à l’Amazonie.
En chemin il découvre l’âpreté d’une vie de rien, la bonhommie d’un lutteur invincible, la bienveillance d’un notable et la passion brûlante de sa fille, la douleur de la perte, l’horreur de la guerre. Au fil des pages affleure l’éveil d’une conscience, conscience d’une âme pure appréhendant le monde « civilisé » dans toute son horreur et sa complexité.
Pfff, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Le garçon m’a laissé sur le cul. A la fois conte cruel et roman d’apprentissage, ce récit hypnotique est porté par le désenchantement, traversé par une mélancolie poétique doublée d’une profonde réflexion sur l’humanité. C’est un récit fleuve qui ne cesse de gagner en puissance, à l’écriture tantôt lyrique, tantôt nerveuse, toujours tenue. Une écriture en demi-ton, « à l’oreille », d’une sonorité délicieusement musicale, si caractéristique de Marcus Malte.
Il lui aura fallu cinq ans pour venir à bout de ce roman-monde plein de souffle à la trame narrative ample, ambitieuse, loin, si loin du minimalisme ambiant et des geignardises nombrilistes de la littérature française actuelle. Mon plus gros coup de cœur de la rentrée littéraire, sans discussion possible.