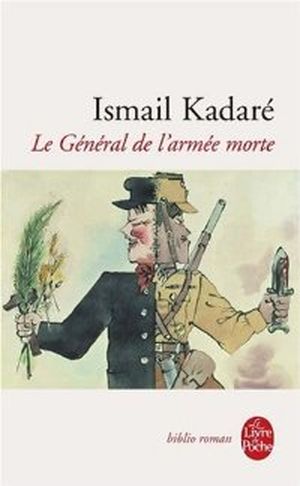Ismaël Kadaré est l’auteur albanais le mieux connu hors des frontières de son pays, et Le Général de l’armée morte est son roman le plus fameux — on s’engage donc en le découvrant non seulement dans la lecture d’un livre individuel, mais dans une rencontre avec la tête de pont de toute une littérature étrangère. L’argument du roman est simple et original : un général italien (et un prêtre) se rendent en Albanie pour exhumer et rapatrier les dépouilles mortelles des soldats italiens tombés dans le pays pendant la Seconde Guerre mondiale. L’intelligence — en termes de stratégie romanesque — de ce postulat tient à ce qu’il permet à I. Kadaré de mêler en permanence deux périodes, celle de la visite et celle de la guerre passée, en permanence mises en contact avec une multitude de procédés directs (le récit d’un habitant) ou indirects (le souhait constant du général de rejouer la guerre passée). Pour autant, Le Général de l’armée morte n’est pas un roman de la réconciliation, mais plutôt celui de la mémoire faussée ou empêchée.
Un des exemples les mieux mis en scène de ce thème est celui du journal d’un déserteur, exécuté par le redoutable “Bataillon Bleu” : son récit touchant est balayé d’un commentaire du général et du prêtre, qui n’y voient qu’une histoire sans intérêt, voire stigmatisent la lâcheté de l’ancien soldat ; ce faisant, ils rejouent cruellement la scène qui débute ce journal intime, où le déserteur se rappelle le premier journal de son enfance, découvert par des camarades qui s’étaient alors moqué de lui. Mais l’ensemble de la mission pourrait bien faire figure d’illustration à taille réelle de la vanité de la reconstitution du passé : plusieurs dépouilles italiennes sont “volées” par une mission analogue engagée par l’Allemagne, dont un membre peu scrupuleux a souhaité “faire du chiffre” en détournant des corps. Le général allemand, face à son homologue italien, lui fait valoir qu’il serait inhumain de faire restituer des corps par les familles allemandes, entérinant par-là le mensonge et son indifférence.
Ce constat effectué, I. Kadaré demeure dans l’ambiguïté quant à la valeur qu’il souhaite lui accorder. D’un point de vue négatif, cette mémoire faussée est celle qui clôt au général toute réflexion sur la guerre passée ; la question du fascisme est écartée, et la guerre d’Albanie est résumée à un problème technique sur les conflits modernes en milieu de montagne, et à quelques réflexions ethnographiques ; le général regrette et déplore la défaite, sans s’interroger ni sur les fins de la guerre ni sur son propre rôle dans celle-ci, qu’on devine peu brillant. Il ne s’en approche en définitive qu’à la fin, lorsqu’il découvre en même temps le corps du colonel Z (seul officier supérieur dont le corps n’avait pas été trouvé, et donc prix de choix) et l’histoire déshonorante de sa mort, dans une circonstance elle-même causée par son défaut total de sens de la mémoire. Pour autant, ce n’est pas par la confrontation avec la mémoire que le général conclut le récit, mais plutôt par la fuite devant elle, matérialisée d’abord par son refus de rapatrier les cendres du colonel Z, puis par le souhait exprimé (dont on ne sait s’il se réalisera) de remplacer son corps par celui d’un autre soldat de la même taille, livré à sa famille.
À partir de ce point, peut-être pourrait-on structurer une lecture du Général de l’armée morte autour d’un triptyque des figures de la mémoire. La mémoire empêchée, d’abord, qui caractérise le général du début de sa mission. La mémoire figée, ensuite, des Albanais, que rappelle tout le roman : leurs champs, leurs récits de la guerre, leurs coutumes, et même leur paysage âpre qui “stocke” la mémoire et les corps. La troisième voie ébauchée par la fin du roman pourrait être celle d’une rupture, ou d’une acceptation de ce que le rapport au passé demeure toujours construit — si bien que tout corps d’un soldat d’un mètre quatre-vingt-deux peut être celui du colonel Z, comme il pourrait être, au fond, celui d’un soldat allemand, ou de tout homme égaré que des généraux chercheraient à faire passer pour l’un des leurs. De ce point de vue, la voix de la raison pourrait être celle de l’« expert » du régime, qui brocarde la description folklorique faite des Albanais par le prêtre, en soulignant que la société traditionnelle montagnarde et sa vendetta ne sortent pas de nulle part, et que les étrangers qui prétendent la scruter ne se prêtent pas à l’exercice par une curiosité candide. Cette pique à la Edward Saïd est une des preuves les plus subtiles de la finesse du romancier, toujours affairé à déjouer les attendus et les facilités de son récit.
Une note en guise de post-scriptum sur l’édition « Les Grandes Traductions » de chez Albin Michel (impression 1983) : la relecture est déplorable (trois coquilles sur une double page, qui plus est dans un moment fort du récit…).