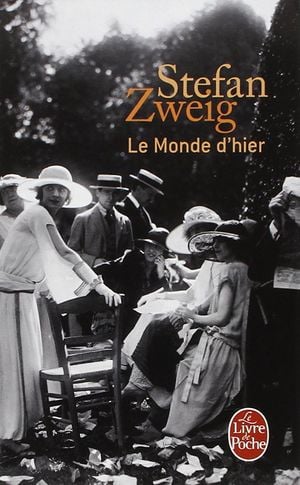Écrivain talentueux, Stefan Zweig ne réussit pourtant dans sa vie qu’à écrire un seul roman, L’Impatience du cœur. Durant ses longues heures de travail, toute sa production littéraire, nouvelles, biographies, était considérée comme un prélude à son grand œuvre qu’il se réservait pour un temps non déterminé. Le Monde d’hier vient parachever symboliquement cet ensemble, non pas en qualité de pièce magistrale, du point de vue de son auteur, mais en tant que testament d’un homme qui était un « citoyen du monde », rétrogradé à la fin de sa vie à l’état de fuyard à cause de ses origines juives. Mélancolique, sujet à des épisodes de dépression ponctuels liés notamment à son manque de confiance criant en ses capacités, Stefan Zweig savait d’ores et déjà que la fin était inéluctable lorsqu’il rédige Le Monde d’Hier. Si ses dernières années ont constitué pour lui un nomadisme forcé, quand, plus jeune celui-ci était avant tout un choix, le suicide, tel qu’il apparaît de façon inéluctable en filigrane dans le dernier passage de son autobiographie sera l’apogée d’une vie que Zweig voulut qu'elle se termine par sa propre volonté. Le Monde d’hier signifie avant tout que celui d’aujourd’hui ne serait pas le sien. Zweig a vécu les plus grands moments de son temps, a participé aux cercles littéraires les plus prestigieux, rencontré les plus grands de l’opéra, du théâtre, de la poésie. Par le dynamisme de son écriture, le début du 20ème siècle défile à toute vitesse, retraçant l’expression que Zweig employait en affirmant qu’il y avait eu de condensé en cette période des évènements qui auraient nécessité plus de cent ans pour survenir lorsque ses aïeux vivaient encore.
Le Monde d’hier est tout aussi intéressant pour ce qui est raconté que pour ce qui ne l’est pas. Considéré comme un essai autobiographique, il n’en possède cependant pas les caractéristiques habituelles. Inutile de chercher des confidences chuchotées à la va-vite, des détails graveleux sur les contemporains de Zweig, comment et pourquoi il s'est marié une seconde fois, ou des lamentations qui s’étalent sur des dizaines de pages. L’auteur se place ici comme le projecteur d’une époque qu’il a enregistré dans sa mémoire, partielle, partiale aussi, en délivrant un témoignage à la valeur historique incontestable, de source directe. Les costumes d’antan revivent sous nos yeux, comme s’ils apparaissaient sur un écran de cinéma, bien que leur enjolivement d’aujourd’hui contraste avec leurs contraintes relatées. La sécurité confiante en les institutions, l’autre, le progrès, et par extension, l’avenir à l’aube du 20ème siècle résonne étrangement dans ce 21ème siècle déjà bien entamé. Les liens entre cette sérénité d’autrefois et la liberté individuelle mettent en exergue ce que nous avons perdu de liberté de mouvement, à près de cent ans d’écart: qui imaginerait désormais circuler sans passeport, quand Zweig se plaignait des obligations administratives, qui lui imposaient notamment de devoir fournir ses empreintes digitales ? Est-ce qu’un Rilke, grand ami de Zweig, poète, bohème, sans adresse postale, décidé à ne pas se confronter à la foule, libéré de toute attache envers la paperasse pourrait encore exister ? Sécurité et liberté individuelle sont, comme les regrets de Zweig l’indiquent, proportionnels. Une guerre mondiale suffit à créer un repli qui fit perdre aux populations ce qu’elles ne retrouveraient plus jamais, ce que encore de nos jours elles continuent de perdre, à cela près que l’homme soumis aux écoutes invisibles se déroule dans l’indifférence quasi générale.
L’optimisme de Zweig est intimement lié à l’idée d’une Europe unie, rassemblée, qu’il jugeait naïvement dans sa jeunesse comme possible pour l’avenir, alors que son existence a été tuée dans l’œuf dès 1914. Polyglotte, circulant partout, jusqu’en Asie, et en Amérique pour mieux saisir les spécificités d’un continent qu’il comprenait mieux une fois qu’il s’en était momentanément éloigné, Stefan Zweig vit sa culture ainsi construite se réduire cyniquement à la part de lui dont il se préoccupait le moins, le judaïsme. Son temps est celui d’une accélération du changement des mœurs et des normes, de l’apparition de nouveaux courants politiques, avec les multiples -ismes, mais surtout d’un certain retour en arrière, où des populations assimilées à la culture de leurs nations respectives se voient ramenées à une religion dont ils ne se rappellent presque que du nom. Le Monde d’hier, fait état de la déception liée à une douce utopie. Non pas que les Juifs n’avaient pas à faire face à l’antisémitisme à la fin du 19ème siècle, mais ses composantes étaient suffisamment lissées pour que beaucoup, à l’image de Zweig ne s’en soucient guère. La seule évolution positive qui jalonne le livre concerne la levée partielle du carcan qui pesait sur la jeunesse, encore que, la même jeunesse servait de chair à canon pour les batailles entre les tranchées, était réunie en bandes propres à terroriser les populations dans l’avènement du fascisme en Italie, mécanique réitérée lors de la création des SA, puis du franquisme, à laquelle Zweig a pu assister par pur hasard. Malgré ses croyances en l’humain, Zweig traduit dans Le Monde d’hier son abdication face à une ombre, celle de la guerre qui ne peut s’empêcher à un moment ou à un autre d’assombrir l’horizon des possibles, entraînant les hommes à se rattacher à la moindre parcelle de bonne nouvelle pour éviter l’affrontement avec le pire.
Son essai n’est pas seulement la retranscription d’une atmosphère dans laquelle les inventions quotidiennes laissaient croire en un futur meilleur. Le Monde d’hier constitue un avertissement pour les générations à venir, déduit entre les lignes. On comprend bien assez vite que l’accélération du temps et la perte des libertés ne sont toujours pas terminées, surtout si l’Histoire à venir continue le mouvement cyclique qu’elle a déjà entamé, il y a longtemps.