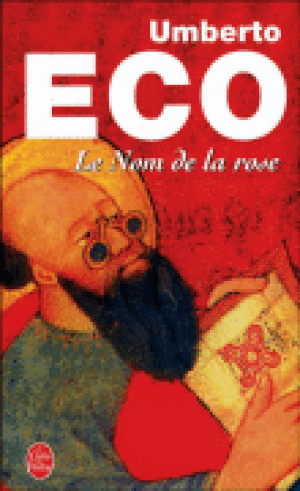Eco ou le don de la glose
Le Nom de la rose est un roman sur les choses, sur les signes, sur les signes qui parlent des choses, et sur les livres, qui sont des signes qui parlent de signes. Comme la bibliothèque labyrinthique et mystérieuse qui fait l'objet de la convoitise des deux personnages principaux, le roman est un édifice de savoir jalousement gardé. Tout est fait pour dissuader le lecteur de poursuivre. Énumérations fastidieuses, descriptions exhaustives, et passages en latin non traduits, sont certes des chausse-trappes efficaces, mais ils sont justifiés : ce n'est pas Eco qui écrit au XXe siècle, mais un moine du XIVe siècle, et ses préoccupations sont fort éloignées des nôtres. Un fil d'Ariane traverse pourtant le livre, pour guider le lecteur dans le labyrinthe de ses circonvolutions : et c'est une intrigue magistrale. L'amateur d'excellents polars ne pourra cependant pas s'en contenter : il en faut plus que l'envie de parvenir au dénouement pour supporter l'érudition parfois écrasante de l'auteur. C'est donc que le chemin mérite d'être parcouru pour lui même et non seulement pour son but. Le Nom de la rose est aussi une œuvre philosophique et historique, qui nous permet de pénétrer non au cœur des faits, mais au cœur des mentalités des hommes d'Église du Moyen-Âge, de leurs doutes métaphysiques, de leurs querelles scolastiques, de leurs contradictions théologiques. Aucun récit de voyage chez les Amérindiens d'Amazonie ne saurait être aussi dépaysant que cette plongée dans une abbaye du Nord de l'Italie médiévale, et dans ses conflits d'intérêt tissés de perfidie, de mesquinerie et de lâcheté. Et puis à la fin, on est quand même bien content de n'être pas moine, et de vivre au XXIe siècle.