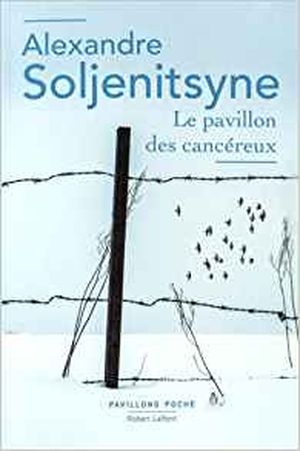Le Pavillon des cancéreux par madamedub
Alexandre Soljenitsyne connut les camps soviétiques, la guerre, l'exil au Kazakhstan, et les affres lancinants du cancer.De cette lutte incessante pour la survie, pour la vie, pour demeurer un homme lorsque les conditions se dégradent, il retire une réflexion profonde sur le cheminement personnel qui peut mener chacun au combat, à la résistance, à l'acceptation, au déni, à la peur ou à la mort.Une question anime le roman, lancé par un malade du pavillon, elle fait raisonner ces mots de Tolstoï au travers de chaque page: "Qu'est ce qui fait vivre les hommes?"Face à la maladie, au tâtonnement des traitements par rayon, mais surtout suite aux désordres du stalinisme, la reconstruction de la Russie (nous sommes en 1955), la question prend un tour sinistre, mais dont la réponse de Soljenitsyne, on le sent, ne voudrait condamner personne.
Si le véritable héros du roman est Kostoglotov, personnage à aura autobiographique, militaire, survivant des camps, exilé, cynique et indépendant, Soljenitsyne développe chacun de ses personnages avec passion et intensité. Chacun suit ce qui semble pouvoir le faire effectivement vivre; la vaillante et naïve Zoé, qui poursuit travail et études au milieu des turpitudes de sa jeunesse, Vadim, le passionné et intègre chercheur, le candide et émouvant Diomka...Mais dans cet univers clos, autarcique, deux personnages demeurent le symptomatique rappel de la société stalinienne.Lioudmila Afanassievna, la chirurgienne de renommée, dévouée et convaincue, réalise qu'elle a contracté le mal contre lequel elle se bat depuis tant d'années; le cancer. Elle soupçonne pourtant qu'il est dû à la manipulation répétée des rayons à la quelle elle se livre pour ses patients. Résignée, elle accepte de se ployer à ce protocole contre lequel Kostoglotov se bat parallèlement; le malade ne doit rien savoir de son traitement, ni des conséquences des moyens employés. Seul le médecin décide jusqu'où on peut aller et si le prix est acceptable.Autre élément aveugle du système, Paul Roussanov, est un haut fonctionnaire, zélé et convaincu. Alors qu'il est malade dans le pavillon, il apprend la réhabilitation de nombre des victimes des procès staliniens, pour lesquels la délation avait principalement joué...d'abord anonymement, puis avec de plus en plus de morgue et d'aplomb...
Confronté à sa mauvaise conscience, à un état et une société encore sclérosés, Soljenitsyne dépeint une Russie contrastée, "blessée" dans ce roman en plus d'un sens.Ces hommes et ses femmes n'ont rien en commun dans ce pavillon hormis la maladie. Ils représentent quelque part ce dialogue impossible de la Russie avec elle-même.Ce n'est ainsi pas pour rien que Soljenitsyne conclue dans cette aporie: "un méchant homme avait jeté du tabac dans les yeux du macaque rhésus. Pour rien...juste comme ça...". Peut-être parce qu'il en va des hommes comme des maladie, il n'y a pas toujours de raisons...