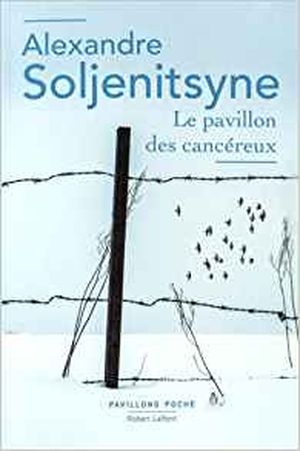Comme s’il avait besoin de sérier les problèmes, ou de garder un semblant d’ordre au milieu du chaos ambiant, Soljenitsyne n’aime rien tant que de circonscrire l’action de ses romans autour d’un décor unique. À moins que ça ne soit une sorte de métonymie romanesque, l’idée étant de représenter la société russe au travers d’un lieu emblématique, clos, aux logiques propres, sorte de mini laboratoire d’observation. Quoi qu’il en soit, cette contrainte qu’il s’impose, il la transcende avec dextérité : grâce à elle le récit s’homogénéise, mais le trait est si sûr, la main si ferme qu’à aucun moment le livre ne tourne au système. Et c’est peut-être dans Le Pavillon des cancéreux que cela apparait le plus clairement, vu le danger encouru à enclore un roman de 700 pages au sein d’un service de cancérologie, au fin fond de l’Ouzbekistan.
Car lorsqu’un récit commence, malgré tout il y a l’imaginaire du lecteur qui entre en jeu : vraiment, 700 pages enfermé dans un hôpital, avec ses malades, ses infirmières, ses médecins, la détresse des uns, les certitudes infondées des autres, et partout la mort qui plane ? Soudain, c’est comme si plus personne n’avait envie d’être là, face à ça, ni celui qui va lire ni non plus, pense ce dernier, celui qui va écrire. Aleksandr semble balayer tout ça d’un revers de plume, et si son livre est si beau, si poignant, au delà de toutes les histoires qu’il renferme, c’est peut-être aussi pour ça. Pour la façon qu’a le romancier de brasser ces vies malmenées – pas seulement par la maladie, pas seulement par la folie du système totalitaire soviétique, mais aussi, surtout, par toutes les incertitudes du quotidien, celles nées du simple fait d’être humain parmi d’autres humains – et pour la façon aussi avec laquelle il parvient à aller au fond de chaque problématique sans aucun pathos, sans aucune retenue non plus : tout simplement campé sur ses deux pieds, face à ses personnages.
Comme toujours chez lui, c’est cette empathie qui stupéfait, ce coup d’œil qui sonde directement chacun et chacune. Et la manière, par les dialogues quand ils sont deux, par les pensées quand ils sont seuls, de rendre tout ce qu’il sent et pressent de chaque petite tragédie ou grand bonheur. Alliant la légèreté et le drame, l’insouciance et l’angoisse, il avance d’un pas tranquille, qui creuse sans blesser. Et parvient chemin faisant à attraper dans son filet le réel, sans abimer ses ailes fragiles par une quelconque vision surplombante ou moralisatrice. La vie se déploie sous nos yeux, simplement complexe, et si chaque épisode fait sens, rien ne semble jamais fabriqué ou artificiel. C’était déjà le cas dans les œuvres précédentes, mais il y a ici un pas supplémentaire qui est franchi : si ses courts romans sont comme des sonates, et Le Premier Cercle comme une symphonie de chambre, on a avec Le Pavillon des Cancéreux une forme proche du concerto idéal : l’orchestre de l’hôpital déploie les thèmes, et sert de contrepoint toujours parfait à la mélodie ample et riche, fragile et hésitante du soliste, le merveilleux Oleg Kostoglotov dont on suit pas à pas la transfiguration jusqu’aux chapitres ultimes et bouleversants décrivant, à la manière de Tolstoï, une résurrection à la fois triste et triomphante.