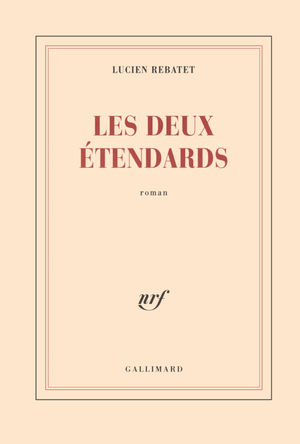Ventre saint-gris!!
Enfin fini, ce colosse, cette masse, cette interminable barrique qui vous tripatouille les intestins. J'ai le souffle court, la poitrine qui bat comme après une course folle avec la première femme que mon coeur ait aimé. Je sens la nostalgie s'échapper comme une plainte de mes entrailles ; 4 mois de ma vie de lecteur, avec de longues pauses, des découragements, des sursauts puis des accès de génie, une torpeur vers le dernier tiers, puis les chairs qui se glacent à la lecture du toboggan aquatique que constituent les 100 dernières pages. C'est un miracle que j'aie ce livre : trouvé d'occasion à 13€ chez un bouquiniste en bas de ma rue, en parfait état, après des années de recherches. Et ce hasard fut mon petit larcin.
D'aucuns diront que ce roman est une symphonie. Et de fait, les techniques d'écriture musicale que le narrateur se targue de maîtriser sont abondamment employées tout au long du récit. Je ne connais pas Wagner, trou dans ma culture musicale dont je ne rougis pas même si je le devine dans toutes les pompes symphoniques qu'on entend au cinéma, et je comprends que ce récit, dans sa longueur, sa densité, son intensité et son incroyable vibrance de texture humaine, y puise une large inspiration; je crois néanmoins que ce n'est pas la musique qui offre la clé de compréhension de l’œuvre mais le cinéma, car celle-ci est un vaste mélo, dense, étiré jusqu'à l'épuisement, dans la plus pure tradition du cinéma de Papa des années 40-50.
4 mois de lecture donc, 4 mois passés à vivre au creux de ces personnages dont le relief et la vraisemblance relèvent du prodige. Pourtant, aucun n'est aimable ni héroïque : tous paraissent curieusement médiocres à commencer par Michel Croz, le narrateur, dont Rebatet parvient à nous transmettre son aversion de soi. Mais ces personnages sont réels, organiques, il prennent vie dans nos intellects avec la ténacité de l'évidence. Et malgré leur veulerie partagée, quelle logomachie, quel torrent de sensation qui nous emporte. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette saillie géniale d'Alain Zannini, alias Marc-Edouard Nabe, sur la lecture et la vie. En lisant Les deux étendards, on lit, on vit, on transpire, le coeur s'accélère, on est transporté, écrasé, humilié même par la puissance intellectuelle et la vitalité qui émanent de ce nabot que seul un inexpugnable amour terrasse ; et les impressions sonores, visuelles, olfactives, les tranches de caractères, les vapeurs d'alcool, des gerbes de Zeitgest mais surtout la capiteuse séduction de ce héros se pressent grouilleusement à nos sens.
Non, je m'emballe sur leur compte. Ces personnages ne sont pas veules, mais ils jouent trop aux épiciers de la grandeur et de l'éternité pour que leurs petits arrangements avec les élans de leur cœur et leur orgueil ne les rejette par contraste dans le trivial. Voyez, ils prennent tellement de reliefs qu'on se met à les juger sur leurs actes comme on le ferait de ces cousins légendaires dont la geste entretient les réunions familiales.
Lire Les deux étendards est une expérience que je souhaite à chacun car c'est un sommet de la littérature, du roman français, écrit en prison par un homme attendant chaque jour l'annonce de son exécution. Il est aussi un opulent minerai de langue française, recréant une époque, des lieux, des milieux sociaux, affectant différents niveaux de langue comme l'argot des collégiens puis celui des étudiants et enfin la langue vernaculaire des bourgeois dans le vent. Cet anti-chrétien a construit un palais superbe ; il a écrit une épopée que trahissent ses longueurs par moment et qui m'empêchent de lui mettre la note suprême, bâti un Taj Mahal à cet amour dans lequel il a jeté toute ses forces et qui l'a vaincu. Nous voilà dans la grande littérature française, celle de la prestidigitation ultime, celle qui prend vie devant vos yeux comme les contes des enfants. Quelle perte féconde, dirait l'autre, que ces 4 mois que Rebatet m'a pris, que je lui ai concédé de bon cœur et au cours desquels j'ai vécu comme jamais.
Voici un roman qui parle à l'intelligence, à l'appétit esthétique, à l'amour de la civilisation française et de sa geste, et ne peut laisser indifférent quiconque se nourrit à ces mamelles.
Pour finir, je chie sur les philistins de la NRF qui ont mal torché leur tapuscrit, pourtant réédité plusieurs fois depuis sa sortie en 1952. Un affreuse faute d'orthographe ou de syntaxe vient relever le lecteur de sa frénésie toutes les vingt pages. Et que je te donne du banc de mariage, et que je t'écris une anectode, et que je t'oublie un pluriel. A moins qu'elles ne reprennent fidèlement la graphie du superbe histrion, il eut été bon d'en expurger ces 1316 pages. A bon entendeur.