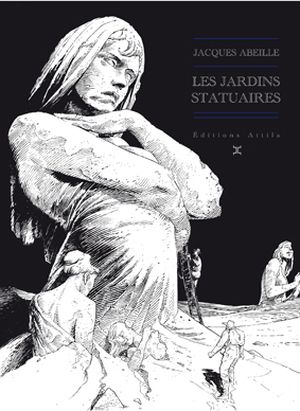Ouais, de la pierre, mais vivante ; un pavé, mais insaisissable. Subsiste quand même pour moi un grain de sable dans la machine, un incompressible hic : de même peut-être que Jacques Abeille a déclaré qu’au fond, il n’était pas un écrivain, au bout du compte / du conte, de même, disais-je, je ne me sens pas chez moi dans les Jardins statuaires. J’y fus bien reçu, j’y passai des heures plaisantes, rien ne m’y révolte, tout juste deux ou trois choses m’y déplaisent-elles ; mais j’y suis comme en exil. Comme si s’appliquait au roman ce propos d’un personnage : « rien de ce que l’on peut dire n’est tout à fait juste, […] mais on peut toujours essayer d’approcher » (p. 39 en « Folio »).
Tandis que j’écris cette critique – et déjà le jour où je finissais le livre –, dans notre contrée, « les voyageurs sont rares. Il y a des routes, mais on n’y passe pas » (p. 13 en « Folio ») – plus beaucoup, en réalité. Pour autant, savoir tous ces gens confinés dans leurs domaines ne m’a pas rendu le livre plus familier, ni notre contrée. Alors, oui, on pourra proposer des analyses des statues qui poussent dans ce roman pour ethnologues, des analyses aussi des coutumes qu’elles impliquent, mais je crois qu’expliquer l’exil implique essentiellement de parler de ce que le livre tait.
Les noms ? Un seul personnage en porte un, Vanina. Les autres sont des fonctions : le narrateur, l’aubergiste, le guide, les doyens, l’amazone, le prince, la petite fille, le gardien… si bien qu’à peu de chose près on se croirait dans un tarot – sans la portée ésotérique – ou au jeu du loup-garou – et l’analogie me semble presque plus parlante ! Les lieux ? Idem : quelques dizaines de domaines dont deux ou trois détaillés, un hôtel, des steppes, une ville abandonnée, un nord et un sud, un gouffre, mais pas le moindre nom de lieu, à l’exception de… Byzance ! C’est le guide qui prononce ce mot, dont le narrateur relève l’emploi : « Il avait dit “Byzance”. Je ne le croyais pas si bien averti des mondes d’où je venais, et qui me paraissaient si lointains. Ou bien devais-je croire que le byzantinisme s’était étendu jusqu’ici ? (p. 103) !
Ces mondes d’où vient le narrateur vient sont les nôtres, sans doute, puisqu’on semble y trouver, sinon des cathédrales, du moins des gargouilles, « démoniaques figures de pierre » (p. 201). Çà et là d’autres allusions à des univers extérieurs au roman : « un boudoir » (p. 203). Mais ces lieux, signes fugaces de l’exil, sont surtout des mots : ne valant rien sans la phrase qui les entoure. Pour le boudoir : « elle se reprit pour remarquer, aussi froidement que si, dans un autre monde, elle m’eût accueilli dans un boudoir pour une visite de courtoisie ». Et pour les gargouilles : « J’étais hanté malgré moi par le souvenir de ces démoniaques figures de pierre que dans mon pays les anciens bâtisseurs se sont ingéniés à placer en des lieux inaccessibles, et dont on découvre soudain, mais trop tard, le visage avide surplombant le cours des choses dans leur innocence, désormais frappés de dérision par quelque pouvoir maléfique ».
Ces deux passages, où les italiques sont de moi, se trouvent à quelques pages d’écart : dois-je déduire d’eux que c’est mon pays qui est un autre monde ? En tout cas, la littérature regorge de pays imaginaires, plus imaginaires encore que celui de Jacques Abeille, et pourtant moins dépaysants. Parce que dans l’Histoire véritable, dans Gulliver ou dans la Machine à explorer le temps, on sait, même implicitement, d’où vient le personnage. Rien de tel dans les Jardins statuaires (1).
Il me semble que de toute façon, le vrai sujet du roman n’est pas géographique, mais chronologique : « Et, dès que j’eus fait une centaine de pas, je connus une de ces émotions qui semblent se jouer de la mémoire pour nous plonger dans un temps très lointain que les événements de la vie – de la vie qui continue – devraient depuis longtemps avoir aboli. Quand il surgit ainsi inopinément, ce profond maintenant, au creux duquel se dérobent les ombres disparues, se donne inqualifiable. Il est gros d’engendrements à venir – qu’on a connus pourtant et que de nouveau on attend de pouvoir nommer – en sorte qu’à l’inéluctable poids du passé se mêle fraîche embrassée la gerbe des virtualités que le cours des choses a abolies, auxquelles on a cru un instant » (p. 192).
D’ailleurs, il n’aura échappé à aucun lecteur digne de ce nom que le thème de l’attente est au centre des Jardins statuaires. Plutôt que l’attente, faudrait-il même dire l’ennui ? Parce qu’en bon humain pascalien, plein de misère, notre narrateur se fait tout de même sacrément chier ! (Ouais, les mauvaises langues ajouteront qu’il n’est pas le seul...) Il a beau se démener du nord au sud et d’une femme à une autre, s’initier à la puériculture et à la ferronnerie, noircir des carnets de notes et trouver du travail, il finit par ressembler à ces personnages de jeux de rôles sur ordinateur qui ne se soucient pas d’accomplir la moindre quête, mais préfèrent se promener dans l’univers du jeu. « Je n’étais pas là pour attendre, mais pour voir » (p. 54), c’est l’explication qu’il propose.
Alors que deux cent cinquante pages plus tard : « Je vais vous dire mon secret de voyageur : je suis un homme qui attend ; même quand je marche, même quand je me hâte, j’attends. J’attends avant même d’avoir rencontré quelque chose à attendre… » (p. 308), dit-il à celle que j’ai appelée l’amazone... Tentative de séduction, évolution du personnage ou mauvaise foi ? Peu importe : l’inconséquence du narrateur (2), ici, c’est l’inconséquence du rêve.
Les Jardins statuaires est un roman sur le rêve. Nul besoin d’être grand clerc pour tirer cette conclusion, il suffit de lire : « les statues sont des rêves » (p. 126). À qui souhaite (re)lire ce livre, je ne saurais que conseiller de ne jamais oublier ces mots prononcés par le guide (3). Cela donne à des phrases comme « Que ce soit votre règne ; celui des pouvoirs imaginaires » (le prince au narrateur, p. 350) une coloration qui me paraît au moins aussi intéressante que les analyses qui consistent à faire du roman une réflexion sur la littérature, ou du personnage une sorte de messie (4). Du reste, les rêves, comme la littérature et la religion, poussent à être sensibles aux signes : or, « Est-on jamais assez attentif ? » (c’est la première phrase du livre, p. 11)...
Quant à l’écriture telle que la pratique Jacques Abeille, elle est à l’image de cette statue foisonnante, comparée tour à tour à un chou-fleur, à un cancer, à un cerveau qui serait à la fois une sorte de cloaque séminal : l’écriture de Jacques Abeille bourgeonne. Je ne parle pas seulement de ce style luxuriant, dans lequel récits et descriptions prennent parfois l’air de labyrinthes grammaticaux, où les dialogues si peu naturels (5), tantôt hiératiques, tantôt confondants de naïveté, achèvent de convaincre le lecteur de l’étrangeté du monde des contrées.
« Comment reconnaîtrai-je ce qui vraiment ne vaudra point d’être narré ? » (p. 537-8), se demande le narrateur, qui est aussi l’écrivain de livres qu’on ne lira jamais : l’écriture est présentée dans les Jardins statuaires comme un pis-aller, comme quelque chose qui ne remplacera jamais l’expérience. Autrement dit, « les noms que la coutume avait déposés sur certains lieux ne pouvaient venir en aide qu’à ceux qui parlaient du pays en le connaissant déjà » (p. 261). Il me semble que c’est aussi de là que provient la singularité d’une telle lecture.
Cette écriture, cette chronologie, sont encore celles du rêve. Pas au sens où les Jardins statuaires transcriraient un rêve éveillé, ni même une alternance de rêve et de veille, pas au sens où le décousu du roman mimerait celui des rêves, mais au sens où c’est un récit de rêve tel que l’auteur le définit en creux dans une interview : « faire un récit de rêve, ce n’est pas retrouver la présence que l’on éprouve dans le rêve. Un jour, j’ai commencé à rêver plume en main. C’est-à-dire que l’état de rêve – il y a pas d’événement, rêvé ou pas, antérieur : le rêve s’actualise dans l’écriture » (ici).
(1) Et presque rien de tel dans un autre roman, les Saisons, dont je ne peux m’empêcher de rapprocher les Jardins. Dans le récit de Maurice Pons, le personnage principal porte au moins un nom, et le lecteur et lui savent ce qu’il cherche – l’oubli. Pourtant, un héros soucieux d’écrire, un univers archaïsant, un dépaysement, une nature qui dysfonctionne (climat invraisemblable chez Pons, confusion des règnes chez Abeille), et une impression que quelque chose d’irréductible résiste à l’analyse.
(2) Si inconséquence il y a. Car après tout, le narrateur ne serait pas le premier personnage qui fait quelque chose alors qu’il n’est « pas là » pour la faire. Plus loin, on trouve encore « je vérifiai à quel point l’attente constituait l’assiette profonde de mon être » (p. 361-362).
(3) On trouve ailleurs des passages qui illustrent l’arbitraire du rêve : « Pas un instant je ne me figurai qu’il pût y avoir des chevaux sauvages dans cette zone boisée. Il fallait des hommes » (p. 277), ou qui appellent les analyses de Bachelard : « Rien n’incite mieux à la rêverie que l’eau qui s’écoule » (p. 55).
(4) La religion est absente des Jardins statuaires ; plus exactement, on y trouve quelque chose comme un culte sans religion. Pourtant, çà et là, un « Voilà l’homme » (p. 285) qui désigne le narrateur, et une ambiance générale qui annonce tout de même furieusement une apocalypse, au point que le terme « révélateur » est employé.
(5) Je reste persuadé que si les dialogues des Jardins statuaires avaient été écrits dans le même style que le récit, ou au contraire bien plus naturels, l’étrangeté du roman eût été moindre. Or, ils se situent dans un entre-deux.