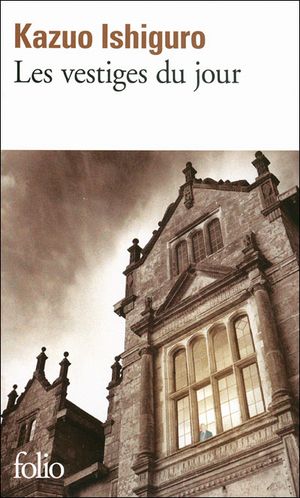2017 : Kazuo Ishiguro, auteur anglais d'origine japonaise peu connu en France, reçoit un Prix Nobel (moins polémique que celui de Dylan l'année précédente) : il est grand temps de lire ses "Vestiges du Jour", oeuvre surtout réputée en ces lieux pour avoir inspiré le meilleur film de James Ivory.
Si le célèbre film est remarquablement fidèle au roman, le choc du livre - oserais-je dire sa logique supériorité ? - viens de l'extraordinaire écriture de Ishiguro (le genre de chose qui vous vaut un jour le Nobel, en fait...), alignement d'une précision méthodique, que l'on pourrait facilement qualifier de "bien japonaise", de faits faussement anodins qui finissent par construire l'image tragique d'une vie gâchée. Car, en se soumettant avec une sorte d'arrogance supérieure aux rituels de la servitude institutionalisée de la haute société anglaise, en en cherchant presque passionnément la "dignité", le personnage magnifique de Stevens, narrateur se penchant rétrospectivement en quelques courtes 300 pages sur les faits marquants d'une vie consacrée à l'obéissance envers et contre tout, révèle non seulement son aveuglement, mais celui d'une époque, et bien sûr le nôtre qui acceptons toujours notre servitude sociale en la justifiant : car quelle différence entre le respect de Stevens envers les règles imposées par sa condition - qui ne sera jamais, jamais remise en question - et notre soumission actuelle au Capital et aux soi-disant inévitables "lois du marché" ? Derrière la façade des normes, se dissimule la même collusion avec le Mal, matérialisée subtilement dans "les Vestiges du Jour" par la complicité avec les Nazis...
Mais au delà de cet aspect politique puissant de l'oeuvre, c'est évidemment la déchirante histoire d'un amour étouffé, nié, anéanti qui restera longtemps dans l'esprit du lecteur : un amour que la mémoire faussement défaillante de Stevens réduit à une poignée de scènes anodines, s'étalant sur plus de 30 ans, et qui laisse à la fin, pour s'être enfin "matérialisé" en une phrase terrible ("Par exemple, je me mets à penser à la vie que j'aurais pu avoir avec vous, Mr Stevens"), un atroce goût de cendres. Un désespoir absolu qu'il convient évidemment de cacher immédiatement par d'absurdes mensonges supplémentaires (sur le soir qui est la plus belle partie du jour ou sur l'impératif de savoir "badiner")... Pour ne jamais, au grand jamais admettre, que, en niant notre propre humanité, nous n'avons PAS vécu.
[Critique écrite en 2017]