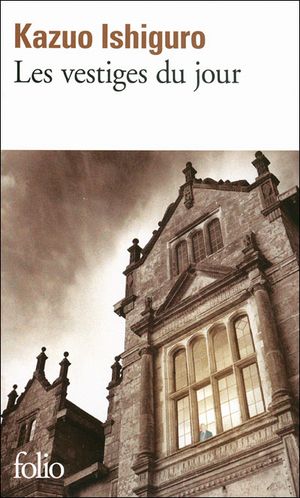La relation qu'un homme entretient avec lui-même possède quelque chose de fascinant. Afin de maintenir un sentiment de soi cohérent et suffisamment stable dans le temps, un humain peut choisir d'accorder une grande importance à l'image qu'il renvoie. Aux autres bien sûr, mais surtout à lui-même. Ce qui est en soi à peu près la même chose quand on y pense. Après tout, ne dit-on pas que "Je est un Autre" ? Ce besoin de contrôle inhérent à la maîtrise de cette image est à relier avec la tradition philosophique ancrant l'idée que l'être humain est partagé entre les passions et la raison. L'idéal qu'un homme peut, ou doit atteindre, est d'empêcher que passions prennent le dessus sur la raison. Celui qui atteindra un tel objectif deviendra "maître de lui-même".
Mr. Stevens a passé toute sa vie à perfectionner l'art d'être maître de soi. Son âge d'or, au milieu des années trente, est loin derrière lui. Aujourd'hui il est plutôt satisfait de ce qu'il est dans le regard des autres, même s'il lui reste toujours par-ci par-là quelques détails à perfectionner.
Son ancien maître, Lord Darlington, est mort il y a quelques années. Il a vécu avec lui l'incertitude de la situation internationale des années trente en Angleterre : celle de l'appeasement, et de la tentative par le Foreign Office de contenir Hitler par une politique bienveillante. Une politique qui aura les effets que l'on connaît, même si sa portée est encore aujourd'hui remise en question par des historiens.
Stevens se voit accordé par son maître une semaine de vacances. Il en profite pour aller voir une ancienne collègue, Miss Kenton. Nous suivons alors le fil de ses pensées durant ces quelques jours dans la campagne anglaise. Entre souvenirs et réflexions sur l'essence de la qualité d'un majordome, Stevens nous fait entrer petit à petit dans un monde aux couleurs défraichies. Mais derrière ce qui ne pourrait être une collection d'anecdotes, va se dessiner un double portait en noir et blanc.
Car la vie de Stevens est idéale, c'est-à-dire entièrement basée sur des idées. Ce dernier enchaîne réflexions et débats autour de concepts nébuleux comme la dignité, le professionnalisme ou la grandeur. A trop faire exister ces idées évanescentes, elles prennent une place tentaculaire dans son esprit, lui faisant perdre de vue ses désirs propres. Ce que Stevens semble oublier, c'est que pour pouvoir se dire "maître de soi", il faut être deux. On ne peut être maître et esclave à la fois. Alors nous avons à faire à un dédoublement de Stevens : il y a d'un côté le majordome impeccable jusqu'aux bouts des ongles, réfléchi et austère, se pliant en quatre pour les besoins d'un autre. Il est tout entier dédié à ce qu'il suppose que l'autre attend de lui. Etant donné que l'histoire est narrée par Stevens du début jusqu'à la fin, nous avons le droit à un style particulièrement précis : les phrases sont longues, soigneusement manufacturées. Stevens veut à tout prix être transparent. Pas question de laisser transparaître un espace de vulnérabilité dans son armure.
Et il y a l'autre Stevens. Celui qui n'apparaît qu'entre deux mots, dans les hésitations et les doutes du narrateur. C'est celui-là qui a ses désirs propres, ses ambitions et ses failles dans la carapace que son métier lui amène. Très vite, l'on comprend que Stevens ne s'autorise rien de lui-même. Il doit toujours en passer par un médium particulier pouvant lui fournir une justification. Il a besoin d'un autre pour pouvoir agir. Rarement un livre nous donne ainsi une impression aussi nette d'un homme plongé dans l'indécision face à son être même : Stevens est-il l'ombre d'un autre, ou un homme à part entière ? Stevens tentera de justifier sa soumission en la transformant en devoir. Il fuit constamment tout ce qui pourrait pointer vers sa propre subjectivité. Sa vie est une suite sans fin de fuites du même acabit : lorsqu'il souhaite améliorer son art de la conversation, c'est pour son maître et non pour lui. Les chocolats chauds quotidiens avec Miss Kenton ne sont que purement professionnels. Il ne joue pas "un" rôle. Il en joue plusieurs, et chaque public aura le sien. Devant des paysans, il sera un gentleman. Devant des gentlemen, il sera un moins que rien. Rien ne dépasse, ou ne semble dépasser.
Salman Rushdie décrivit à l'époque le livre avec une lucidité remarquable : "the real story here is that of a man destroyed by the ideas upon which has has built his life". Derrière son apparence stricte, droite et distinguée, Stevens est en vérité incroyablement vaniteux. Passionné par "les grands hommes", et tout heureux de capter une part de leur notoriété en les servant, il s'aliènera dans de tels passions. Ses justifications seront toujours implacablement logiques, si bien qu'il ne les remarquera que des décennies plus tard. Là réside toute la beauté du livre. La façon dont Stevens va tenter de mortifier son être va se déplier avec délicatesse, pour nous apparaître ensuite clairement au fur et à mesure de ses souvenirs. Plus le narrateur se livre et tente de se justifier, plus celui-ci nous apparaît paradoxalement comme tristement humain.
Le livre est par conséquent d'une beauté rare, celle que le lecteur inattentif pourrait facilement manquer, s'il ne se rend pas vite compte du jeu de dupes que Stevens joue avec lui-même. Car celui qui devient maître de soi n'a plus d'idéal à atteindre. Il ne peut plus progresser, il reste bloqué dans la position qu'il a choisie. Qu'importent toutes les justifications du monde, il ne reste que les regrets.