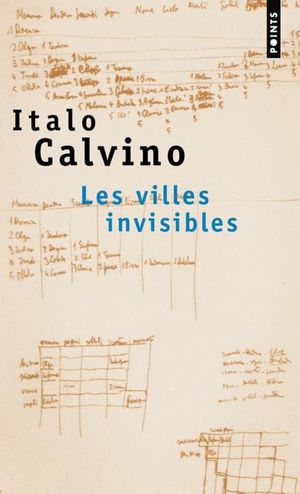J’ai traversé ce livre comme un étranger glissant dans un palais de verre, un intrus perdu dans une demeure aux parois transparentes, mystérieusement recouvertes de buée. S’il m’arrivait de coller mon visage au carreau pour découvrir quelques trésors suggérés derrière le miroir, espérant voir se dessiner une forme étrange à travers le givre, une ombre mystérieuse, un paysage lointain, un secret millénaire, je ne trouvais que de nouvelles vitres qui s’enchâssaient les unes dans les autres, d’autre plaques de verre qui ne donnaient sur rien d’autre qu’elles-mêmes, et l’édifice est vite apparu comme un leurre destiné à me laisser frustré de toute présence réelle.
Le livre est une variation sur les récits de Marco Polo, ses années en Orient au service du Khan Kubilai, dont l’écrivain Rusticello a gravé la légende dans le livre le Devisement du Monde, rédigé vers 1300. Notons que ce livre ancien est, selon le médiéviste Jacques Heers, un livre qui « déconcerte par son allure et sa démarche fort lourdes, par une construction très répétitive, un schéma fastidieux, toutes choses qui engendrent inévitablement ou lassitude ou ennui. »
Voilà qui suggère que le livre de Calvino, en gardant beaucoup de ces caractéristiques pénibles, est peut-être, finalement, un bel hommage.
Les deux personnages principaux, le Khan et Marco Polo, sont ici terriblement vaporeux, deux simples évocations qui peinent à s’incarner. Ils ressemblent à des personnages de conte sans importance, flottant au-dessus d’un récit qui ne prend jamais vraiment racine, qui évoque un empire dépourvu de chair que l’on a peine à matérialiser. Leurs échanges sont assez plats, intellectuels sans être profonds. Ils ne sont teintés ni de flagornerie, ni d’orgueil blessé, ni de jalousie, ni d’admiration. Seul peut-être l’ennui d’un côté et l’extravagance inépuisable (bien qu’infantile) de l’autre servent de moteur à leurs conversations silencieuses (qui n’ont peut-être pas lieu).
En effet, dans Les Villes invisibles, on parle mais on ne parle pas. On est dans un jardin, mais on y est pas. Telle ville est peut-être ceci ou peut-être cela. La ville suivante est en fait une autre ville, puis toutes les villes. La contingence la plus diffuse règne dans les récits microscopiques qui s’enchaînent de manière répétitive et, si rien n’implique véritablement rien, si rien n’appelle ce qui va suivre, si toute forme peut succéder à toute autre et si rien n’a vraiment d’importance, on est en droit de se demander : « pourquoi ce livre plutôt que rien ? »
Les descriptions de villes se ressemblent énormément et, si l’on peut apprécier le travail de ciselage qui apparaît parfois dans les détails invoqués, l’odeur des épices et le reflux qui caresse le rivage, la diversité des métiers mis en avant et les descriptions d’architectures, ce travail timide est souvent annulé par l’abstraction rêveuse et naïve qui l’accompagne. L’auteur, en divaguant de manière très conceptuelle, toujours désincarnée, pas vraiment pertinente, reprend tout ce qu’il donne. Il met en doute l’existence de ce qu’il décrit, il utilise des concepts aussi généraux que dépeuplés (le désir, la mort, le secret) et lance douze pistes pour n’en suivre aucune. L’univers parfois tangible qui s’était dessiné sous nos yeux, bien qu’aussi vide de personnages que les photos d’Eugène Atget, se dissipe comme un nuage de fumée sous les coups de ces assauts fantaisistes.
Cela permet peut-être de rappeler qu’un des principes les plus fondamentaux de la fiction (ça n’a pas bien changé depuis Aristote) est de se situer, de prendre une direction précise, de suivre une piste avec rage. Non pas de se noyer dans des « peut-être » un peu timides, ni d’annuler chaque situation par son contraire.
Ici la symétrie, la quête d’un désir abstrait, le symbolisme se retrouvent en permanence à la source des villes miroirs qui contiennent souvent toutes les autres, s’enchâssent dans leurs jumelles, croissent au milieu de leur propre image, s’effondrent sur leur propre reflet.
Les habitants sont toujours tout entier dans le concept de la ville. Ils n’ont pas de visage ni de personnalité. Ils apparaissent comme des morts ou des statues de pierre, comme des idées qui n’ont pas d’idées.
Aux allures poétiques des descriptions répondent la froideur matérielle et le règne des objets, la technique et les symboles creux. Cette succession de plans sans intentions, de mythes sans peuple pour les incarner, de conceptualisations sans enjeu et au fond très générales ne m’a décidément pas parlé du tout.