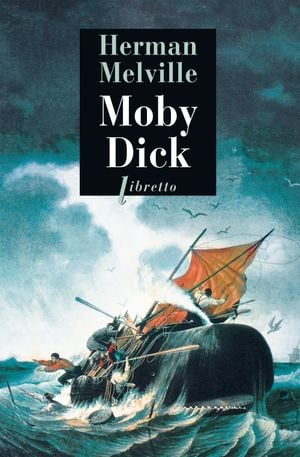Difficile de donner en quelques lignes son avis sur un tel monument. Ma note oscille d'ailleurs entre 6 et 8, car j'ai des sentiments contradictoires vis-à-vis de cette oeuvre. Je vais m'en expliquer en filant une métaphore un peu facile, mais bon.
Ce livre, dont je ne ferai pas l'injure de rappeler le sujet, est comparable à une baleine.
- Le squelette narratif a peu à voir avec sa structure d'ensemble. Comme la baleine, ses organes vitaux sont cachés derrière une épaisseur anormale de graisse : je pense aux longs excursus didactiques, a-narratifs, typique de la littérature du XIXe (l'exemple le plus frappant en étant Jules Verne). Comprenons-nous bien : je n'ai vraiment aucune réticence vis-à-vis de ces excursus, qui peuvent dégager une forme de poésie. S'il y a 5-6 chapitres de ce genre, pourquoi pas. Mais là, je pense qu'un bon quart du livre est consacré à des chapitres qui ne mettent même pas en scène l'équipage au travail, mais développent une typologie des baleines, s'étendent à loisir sur les vertus du spermaceti, les manières de l'extraire, le rôle du charpentier dans un navire, ou pire, la représentation des baleines dans les gravures (lesquelles ne sont pas reproduites). Souvent, c'est du moins le sentiment que j'ai eu dans cette traduction sans doute un peu vieillie, j'ai eu le sentiment que le ton se faisait délibérément emprunté, comme si Melville pastichait le positivisme.
- Comme les baleines, parfois le livre sonde, et on le perd complètement de vue. Si les personnages détaillés au départ sont bien plantés, celui de Pip, le petit garçon noir qui accompagne le capitaine, ou celui du Parsi, dont je n'ai absolument pas compris son rôle dans l'histoire. Dans ces moments-là, on laisse aller la corde et l'on se dit que l'on reprendra le fil quelques pages plus loin.
- Comme les baleines, cette lenteur parfois désespérante cache une incontestable puissance, que l'on voit parfois trop tard. Dans les romans d'époque contemporaine, "Moby Dick" est probablement ce que j'ai pu lire qui se rapproche le plus d'une "Illiade", et les nombreuses allusions aux mauvais présages (le quadrant cassé, la perte de la corde à mesurer la vitesse, le chapeau pris par l'oiseau). Ou encore la manière répétitive d'envisager le voyage (le Pequod rencontre différents bateaux, autant d'éléments narratifs signifiants). Dommage qu'il faille attendre si longtemps pour que le cachalot blanc (qui semble bien une entité mâle) se donne à voir.
Pour couper à cette métaphore, je note que ce roman a recours au même symbolisme efficace, un peu appuyé et si typiquement américain que l'on retrouve chez un Hawthorne.
Je note des incohérences dans la situation narrative. Le chapitre XXXIV raconte de manière plaisante les repas en commun entre Achab et ses trois seconds, mais comment le narrateur, simple matelot, aurait-il pu être au courant ? De fait, la situation narrative est un peu faussée, car le narrateur semble omniscient, alors qu'il est censé être acteur. De ce point de vue, Melville a renoncé à toute vraisemblance.
Le livre comporte aussi son lot de trouvailles, d'expérimentations littéraires, qui en font une rhapsodie. Je pense notamment à un chapitre présentant le courant de conscience d'un personnage pensif sur le pont désert. Ou encore à des chapitres organisés comme des petites saynettes avec didascalies et tout.
C'est le genre de livre dans lequel on peut piocher une citation au hasard et trouver son bonheur. Mais la volonté de partir d'un hyperréalisme pour aller vers l'idéal, le symbolique, peut sembler parfois un peu systématique. Je pense notamment à la figure d'Achab, dont les discours à la 3e personne me semblent outrés. En gros, Achab est trop bavard pour son propre bien, et sa figure de révolté, ou plutôt d'individualiste forcené, a parfois quelque chose d'artificiellement gonflé.
Un livre très riche, trop riche pour être digéré en une fois, un peu décevant par sa structure, résolument à part dans la littérature XIXe.