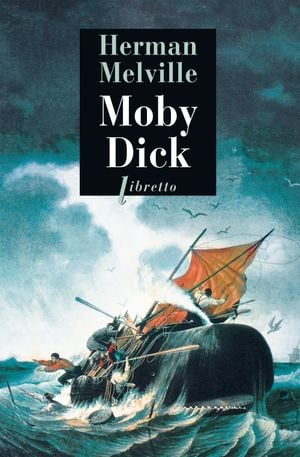Je ne me ferais pas d'amis par cette critique, mais je me dois à ceux qui liront de leur narrer le fond de mes sentiments et pensées à l'égard de cette œuvre majeure de la littérature américaine, caractéristique qui visiblement m'est passée bien au-dessus du crâne. J'étais pourtant sûr en entamant ce volume que je serais emporté, grand admirateur à la fois de Jules Verne et Stevenson depuis mon plus jeune âge et de Jack London, qui cite Melville comme une grande influence.
Comme quoi, on peut être surpris. Tout d'abord, sur les 750 pages qui constituent le livre, il faut en attendre plus de 100 avant que le personnage principal ne se décide à embarquer sur un bateau et à prendre le large. Je n'aurais rien contre si ces 100 pages passées à terre étaient riches d'enseignements sur la sociologie et la vie des marins de l'époque et de ce qui peut se passer dans un ville portuaire de la côte atlantique américaine à cette époque, mais il n'en est rien. Le seul rôle de ce préambule (peut-on appeler cela un préambule quand cela dure une centaine de page ?), est de nous introduire le personnage principal (sur lequel on sait finalement très peu) et son acolyte Queepeg(un harponneur de couleur noire), et de nous présenter les quelques jours à terre où ils se mettent en recherche d'un baleinier sur lequel s'embarquer. Je dois toutefois reconnaître que cette relation est bien développée par Melville, et je me suis en particulier attaché à Queepeg, et les quelques situations cocasses qu'il engendre par sa méconnaissance du monde occidental. J'ai également trouvé un passage qui ma particulièrement plu, comme quoi je suis poreux au style de Melville, mais bien imperméable à sa narration :
En fin de compte, nous nous trouvâmes assis, toujours bien bordés dans
les couvertures, mais adossés à la tête du lit, les genoux remontés,
et nos nez dessus comme si nos rotules avaient été des chaussettes.
Nous nous sentions parfaitement bien, d'autant que dehors il faisait
froid et, sans chercher si loin, froid aussi dans la chambre, qui
était sans feu. A ce sujet j'ose avancer que, pour bien jouir de la
chaleur, il faut avoir quelque petite partie du corps exposée au
froid; car il n'est qualité au monde qui ne vaille que par le
contraste. En soi, rien n'existe. Si vous vous vantez d'être partout
et depuis longtemps confortable, vous pouvez être assuré que vous
n'êtes plus confortable du tout; mais si, au lit, comme Queepeg et
moi, vous avez le sommet du crâne légèrement froid, alors, en votre
âme et conscience, vous pouvez vous flatter d'être incontestablement
au chaud. Pour cette raison, une chambre à coucher ne devrait jamais
avoir de feu. C'est là une des incommodités luxueuses des riches; car
le comble du bien-être est de n'avoir, entre vos corps au chaud et le
froid extérieur, que votre courtepointe. Alors vous êtes comme une
étincelle unique au coeur d'un cristal arctique.
A ce moment, j'avais déjà un sentiment de longueur; une centaine de pages passées avant d'embarquer ? Et pourtant, jamais après dans ce roman je n'ai passé 100 pages aussi agréables. En effet, sur les 650 pages restantes, environ 100 doivent être consacrées à l'anatomie des baleines et cétacés en tout genre. Comprenez-moi bien, je n'ai rien contre ce genre d'inclusions informatives, car je considère qu'un des attraits de la littérature est d'augmenter son savoir et sa culture générale tout en passant de bons moments. Mais on aurait pu à mon humble avis soustraire les trois quarts de ces pages sans que rien ne soit enlevé à l'expérience de lecture, si ce n'est bien sûr l'ennui colossal qu'elles génèrent chez le lecteur. Je conçois que pour le lecteur à l'époque de parution, l'intérêt pour ces choses devait être grand pour ces énormes monstres et leur physionomie, mais vivant à l'époque où on fait décoller des fusées capables de réattérir, je n'ai pu être sensible à ces interminables esquisses, dont on ne retient de toute manière rien après avoir terminé le livre.
Même après avoir embarqué, l'équipage met un sacré petit bout de temps avant de tomber sur la première baleine de leur périple. A tel point que j'avais presque oublié que ce bateau, le Péquod, était un baleinier. Défile devant les yeux avides d'aventures du lecteur la description d'un nombre incalculable de membres d'équipage, descriptions inutiles ou ratées, car jamais on ne se souviendra de leur nom ni de leur caractéristiques; il est impossible de s'attacher à ces personnages qui apparaîtront plus tard par éclats successifs. Le capitaine, Achab, a une personnalité développée qui a, il faut bien le reconnaître, une certaine profondeur, au point que lire des analyses de ce personnage m'intéresseraient pour pouvoir mieux le saisir.
Après 700 pages, apparaît enfin Moby Dick et arrive la chasse que le lecteur attend depuis qu'il a attaqué le livre. Pas de grandiose, rien de gigantesque. La folie d'Achab est révélée au grand jour, mais le combat épique qu'on attendait face au colosse des mers est très, très, très pauvre. 700 pages de descriptions inutiles et interminables pour arriver au paroxysme de l'histoire, et la boucler en 50 pages sans aucun panache.
Plus jamais je ne lirais de Melville, ce roman m'en a profondément dégoûté. Je lis pour vibrer et m'oublier dans des récits haletants, pas pour devenir un spécialiste des mammifères marins. Je pensais entamer un récit passionnant de traque à la baleine, qui s'est révélé être un journal de bord interminable et plat, suintant l'ennui.