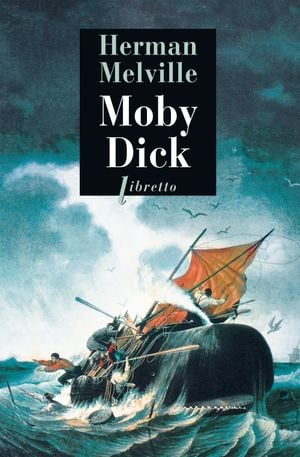Échec lors de sa sortie en 1851, Moby Dick devait être pourtant le chef d’œuvre de son auteur, Herman Melville. Il y mit donc beaucoup de sa personne et se renseigna énormément sur le monde des marins et celui des baleines. Je me suis attaqué à ce beau pavé de plus de 700 pages, présenté en partie par Jean Giono, car j’avais envie de découvrir l’un des piliers du Roman américain.
Le résultat a été longtemps déconcertant. Quand je l’ai commencé, je l’ai trouvé très fluide. Notre personnage principal se nomme Ishmaël qui ‘exprime à la première personne et désire à tout prix embarquer en tant que marin à bord d’un bateau. Ce sera le Péquod, dans lequel il rentre avec un certain Queequeg, une armoire à glace d’un silence dérangeant. Comme Ishmael, on embarque pour ce qui s’annonce être un roman d’aventure passionnant. Mais l’ennui (terme adéquat) réside dans des passages désirant nous éclairer sur le monde des baleines. Or ces passage qui peuvent correspondre à des chapitres entiers sont beaucoup trop exhaustifs. Trop exhaustifs car comme je l’ai indiqué au début de la critique, Melville voulait enrichir le plus possible ce qu’il assimilait comme son chef d’œuvre. Des lignes plus adressées aux zoologistes et aux passionnés des baleines donc. J’ai alors abandonné ma lecture du pavé pendant une année, avant de la reprendre prêt à en découdre jusqu’à la dernière page.
Mises à part ces chapitres cétologiques (sur nos chères baleines et nos chers cachalots) qui se veulent carrément encyclopédiques, les passages dédiés à l’aventure d’Ishmaël témoin innocent du Péquod sont quand même intéressants. L’équipage fera la rencontre d’autres navires dans des moments parfois mystiques. Mais surtout la force du roman repose sur la fameuse poursuite de Moby Dick la baleine blanche par le tyrannique capitaine Achab, personnage d’une beauté presque biblique. Cette quête philosophique, qui correspond à celle d’un fou meurtri intérieurement et physiquement (la jambe de bois et les cicatrices en témoignent) entraînant son équipage jusqu’au bout des mers infernales, porte bien évidemment le roman.
Le style lyriquement riche de Melville se lit vite. Il nous attire dans cette folle poursuite pour savoir ce qu’il va finalement se passer page après page. Les détails cliniques prennent parfois le poids sur le déroulement de l’histoire mais la vie des protagonistes particuliers du Péquod nous préoccupent : le capitaine Achab, ses seconds Flask, Starbuck et Stubb, mais aussi Queequeg, Tashtego, Dagoo, et surtout notre jeune Ishmael qui va murir à partir de cette expédition. Le capitaine Achab se fait attendre pour notre plus grande impatience mais aussi notre plaisir avant sa première apparition, à la moitié du roman. Comme Ishmaël, on s’en retrouve hypnotisé par le maître des lieux dont on a tant entendu parlé. Le livre prend alors une dimension plus élevée dans le mysticisme voire la folie.
Vers la fin, le roman s’accélère comme le rythme des mers. Il annonce quelque chose de grandiose : comment va se conclure un combat final et brumeux engagé entre la Nature et l’Homme ?
Un classique à lire au moins en édition abrégée.
Ils se racontaient des histoires impies, des contes terrifiants avec des mots joyeux ; des rires sauvages s’élevaient comme les flammes de la fournaise ; les harponneurs allaient et venaient devant eux en gesticulant follement avec leurs énormes fourches. Pendant ce temps, le vent hurlait, la mer bondissait, le vaisseau grognait et piquait, sans cesser cependant de lancer fermement, de plus en plus loin, son enfer rouge dans les ténèbres de la mer et de la nuit, mâchant les os blancs de la baleine dans sa bouche méprisante, et crachant salement de tous les côtés. Ainsi lancé, frêté de sauvages, chargé de feu et brûlant un cadavre en plongeant dans les noires ténèbres, le Péquod semblait le double de l’âme de son capitaine fou.