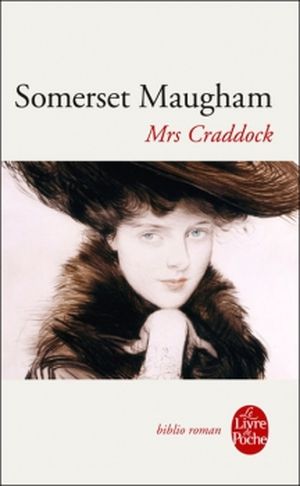Avant, Bertha Ley, jeune aristocrate, s'ennuyait avec distinction entre sa tante Polly et le cercle restreint des notables fréquentables de ce joli coin de campagne anglaise. Tout valant mieux que la routine, elle s'éprend passionnément du métayer de ses terres, Edward Craddock, un beau gaillard solide, droit dans ses bottes, pour qui vaches, poulets et travaux des champs n'ont aucun secret.
Les femmes, en revanche, il ne les pratique guère, ce qui n'est pas pour déplaire à Bertha qui l'épouse ni une ni deux et se réjouit déjà de pouvoir modeler ce cœur vierge à sa convenance.
Mais le cœur sans imagination de son lourdaud de mari n'est qu'une pompe qui permet à son propriétaire d'arpenter sans fin ses terres et de métaboliser ses repas pantagruéliques, non l'organe des sentiments exaltés ni le siège de l'amour absolu et passionné que la jeune femme attendait. Que faire, en effet d'un homme pour qui "women are like chickens, [...] when they cluck and cackle just sit tight and take no notice" ?
Il n'est donc pas question de savoir si Bertha, intelligente, cultivée et à l'esprit au moins aussi affûté que celui de sa tante va se réveiller, mais bien quand elle va le faire, et ce qui en découlera.
Vague après vague, la réalité se lancera à l'assaut de son aveuglement initial, douchant son enthousiasme, sa ferveur, sapant ses certitudes. Contrairement à la suite du Cantique des cantiques évoqué dans le titre de ce billet, les noces éternelles ne triompheront pas de la souffrance endurée. Au lieu du “happily ever after” tant espéré par Miss Ley, le mariage fera d'elle une Mrs Craddock vite déçue puis cruellement blessée par la vraie vie. Viendront alors la période du désenchantement, celle du retour à soi et aux sens, puis celle de l'apaisement.
Ce qui avait dérangé les censeurs, au moment de la publication du livre (1902), est sans doute la sensualité exprimée et assumée de Bertha à laquelle répond le féminisme teinté d'ironie de la tante Polly, celle pour qui “marriage is always a hopeless idiocy for a woman who has enough of her own to live on” et qui choisit de considérer toutes choses de la vie comme une source d'amusement.
L'inhabituelle liberté de ton de ces deux personnages de femmes est justement ce qui m'a séduite, mieux, enthousiasmée, surtout quand on l'oppose, comme ici, à la lourdeur passéiste véhiculée par les personnages masculins du récit. Vient s'y ajouter l'ironie discrète de Maugham, présente à chaque ligne, qui donne tout son mordant à ce qui aurait pu n'être qu'une mièvrerie de plus sur le thème de l'amour déçu.