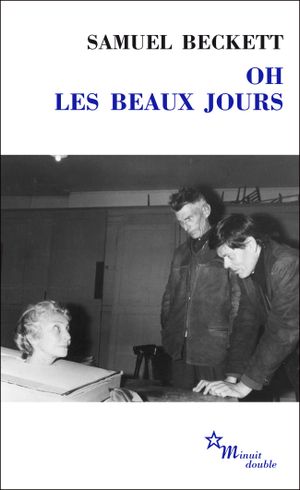« Il vous en reste une partie, de vos classiques, pour vous aider à tirer votre journée » (Winnie, acte I, p. 69). Une toute petite partie, alors. Ou presque pas. Ou pas du tout. Deux actes, histoire de. Et deux personnages, trois si on compte la « fourmi, vivante ! » (Winnie, I, p. 36). Pour le reste – intrigue, interaction, ou même dialogues –, on repassera. Inutile de dire qu’un lycéen habitué à s’appuyer sur du Molière, de l’illusion dramatique et de la triple unité depuis la sixième a de quoi être décontenancé. (On notera d’ailleurs que le passage qui ouvre cette critique n’est pas le seul de la pièce à pouvoir être interprété comme une rupture du quatrième mur.)
Au commencement, donc, une « lumière aveuglante » (p. 11) et une prière à demi audible dans un monde qui pas plus que celui des autres pièces de Beckett n’est habité par le moindre dieu. Le clown blanc et l’auguste – ou les Laurel et Hardy, ou Itchy et Scratchy, ou Raymond et Huguette, ou Jay et Silent Bob – de cette vaste blague sont comme la plupart des personnages beckettiens : décrépits et entravés. Pourtant amoureux : « La vie une dérision sans Win ! » (p. 74) se souvient Winnie : c’est ce que lui disait Willie du temps de leur jeunesse.
La première propose une logorrhée constante. Pas plus – mais pas moins, « pas mieux, pas pis » – que le lecteur, elle ne semble comprendre la structure de la pensée qu’elle exprime. (Et pour quiconque veut recevoir une leçon de comédie, un coup d’œil à l’interprétation de Madeleine Renaud s’impose.) Les répliques du second dépassent rarement le monosyllabe, en-dehors de quelques passages lus. La langue de ce théâtre de l’absurde-là cause de gros problèmes d’articulation – son et pensée.
Et puis – « ça qui est merveilleux » ! – au milieu de toute cette parole en décomposition, quelques instants de grâce. Deux époux qui rient ensemble. Des bribes de souvenirs des « beaux jours » d’autrefois. « (Expression heureuse.) » Et l’ascension finale de Willie, peut-être l’un des plus beaux témoignages d’amour du répertoire du XXe siècle. On néglige l’humour de Beckett, voire sa gaieté : jeux de mots, rapprochement incongrus, quelquefois joie toujours sincère des personnages.
On pourrait aussi croire que dans la soupe de langage que constitue Oh les beaux jours surnagent quelques paroles de lucidité personnelle : « Je n’ai pas perdu la raison. (Un temps.) Pas encore. (Un temps.) Pas toute. (Un temps.) » (Winnie, II, p. 65) ou de vérité en lettres d’or : « il ne se passe pas de jour – (sourire) – le vieux style ! – (fin du sourire) – presque pas, sans quelque enrichissement du savoir » (Winnie, I, p. 23). En vérité, c’est l’ensemble – soupe verbale + gestes entravés + décor nu… – qui met en scène la pauvreté de la condition humaine, dans ce qui est probablement la plus drôle des illustrations du divertissement pascalien.
Du reste, les personnages savent que leur langage n’est qu’un pis-aller, ce dont Willie semble avoir pris son parti, et ce que Winnie exprime clairement : « Oh sans doute des temps viendront où je ne pourrai ajouter un mot sans l’assurance que tu as entendu le dernier et puis d’autres sans doute d’autres temps où je devrai apprendre à parler toute seule chose que je n’ai jamais pu supporter un tel désert. » (Winnie, I, p. 33-34).
Le nombre de répliques où Winnie parle des mots est remarquable… C’est étrange, n’est-ce pas, de dire avec des mots que « Les mots vous lâchent, il est des moments où même eux vous lâchent » (Winnie, p. 30) ? Oui, mais « non, ici tout est étrange » (p. 48 et p. 51). Car la véritable pure communication entre les deux personnages viendra tardivement, sans passer par la parole : un jeu de regards, une esquisse de geste tendre et une mélodie.