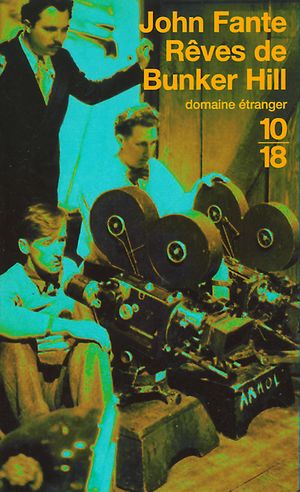D’une verve et d’une malice d’une tristesse infinie, la rencontre avec Bandini. Au détour de Bunker Hill ou d’ailleurs, anecdotique, improbable, fatidique. « My first collision with fame was hardly memorable », bon. D’accord, peu importe (abrutis). Et l’ironie, et la désillusion, et l’amertume, et la tendresse, surtout la tendresse ? C’est la neige éternelle de Boulder, Colorado, elle est partout, dans tous tes pores, dans tes yeux jusqu’aux entrailles, et toi la neige sur le macadam d’Hollywood, tu fonds. Il est doux-amer, le Bandini, toujours à côté de lui-même, toujours un peu dans la souffrance de celui qui aime déraisonnablement cette chienne de vie. Dio cane. A côté de lui-même, Bandini : il a ses rêves, et il a Bunker Hill : Vil Coyote et Bip Bip, les rêves de Bunker Hill. C’est toujours le même roman qu’il écrit au fond, la souffrance de l’indicible et de l’inaudible, sale minable, l’écrivain raté. Loser magnifique, Bandini. « The most famous unknown writer in America », les Coen feront de grandes choses avec toi, tu verras. Toujours le même livre, tragique ; mais quand même, Bunker Hill…
Bunker Hill, c’est le zénith, l’immortalité de Bandini dans une phrase, la toute petite, insignifiante, dernière phrase. « But what the hell, a man had to start someplace ». L’ironie, la désillusion, l’amertume, la tendresse abîmée de tristesse. Un roman d’apprentissage, ma gueule, apprendre à ne pas apprendre, l’histoire d’un mec qui n’en peut plus d’aimer la vie jusqu’au bout des stances. « But what the hell », le tragique de l’existence tout entier, l’immortalité des rêves, « a man had to start someplace ». Bandini, le cowboy de minuit à l’assaut de la littérature, pour ne pas rater un rencard avec la vie. Il faut bien commencer quelque part.