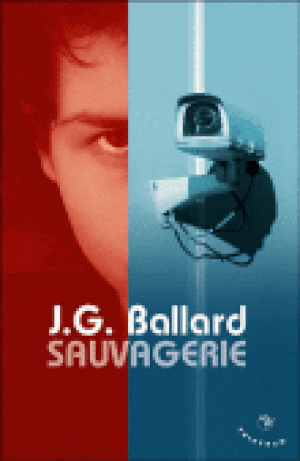Une résidence de luxe ultra-sécurisée dont on découvre un matin tous les habitants adultes assassinés ; quant aux enfants, ils ont disparu. J’ai assez vite résolu le fin mot de l’histoire, et je vous déconseille de lire la suite de cette critique si ce n’est pas votre cas, que vous n’aimez pas les spoilers et que vous n’avez pas lu Sauvagerie (1).
C’est bon ?
Ce sont les enfants qui ont tué tout le monde avant de fuir. Comme la série d’assassinats a été planifiée méthodiquement, j’admets que le court roman de Ballard puisse être plus choquant que Sa Majesté des mouches, qui ne met pas vraiment en scène un massacre, ou que les Révoltés de l’an 2000, dont les jeunes protagonistes, crois-je me souvenir, ne deviennent des meurtriers calculateurs et sans pitié qu’à la suite d’une épidémie. (De même dans le moins réussi The Children.) D’ailleurs le titre original et celui d’une des deux traductions françaises me semblent passer à côté de quelque chose, laissant planer l’idée d’un libre cours des instincts, alors que le déchaînement de violence y est méticuleusement organisé. (Traduire, comme cela a été fait, Running Wild par le Massacre de Pangbourne plutôt que par Sauvagerie est certes infidèle et donne à l’ensemble une tonalité kitsch-mélo assez proche de la série Z, mais résume assez bien l’affaire.)
La raison pour laquelle douze adolescents et une enfant tuent l’ensemble des adultes de leur résidence, dont leurs « parents aimants, éclairés, partageant des valeurs libérales et humanistes qu’ils manifestaient presque à l’excès » (p. 17 de l’édition Tristram) a naturellement de quoi mettre à mal les notions d’amour filial, de gratitude et plus généralement de morale : « Ils ont tué pour se libérer d’une tyrannie de l’amour et de la gentillesse » (p. 17). Pourtant, ouvrez les page « psycho / enfants » de n’importe quel magazine du dimanche, jetez un œil dans n’importe quel jardin public d’un quartier favorisé de nos villes, et la fiction de Ballard prendra un visage beaucoup moins saugrenu.
« J’ai eu le sentiment très net, et pas pour la première fois, d’avoir affaire à de jeunes esprits qui se forçaient à la folie comme moyen de trouver la liberté » (p. 61) : on voit que Ballard analyse lui-même les personnages de son récit, par la voix d’un narrateur psychiatre chargé de faire la lumière sur les meurtres. De même, les parallèles avec des événements qui n’avaient rien de fictif sont explicites : « Je pense que les meurtres eux-mêmes n’ont été que le dernier ajout à un processus de retrait du monde extérieur qui avait commencé bien des mois, voire des années, auparavant. Comme pour Michael Ryan, le tueur de Hungerford, ou les nombreux exemples américains de tireurs fous qui ouvrent le feu sur les passants, l’identité des victimes n’a pas de sens particulier pour eux [les enfants] » (p. 68).
Il ne faudrait pas non plus lire Sauvagerie comme un réquisitoire contre la jeunesse, un truc qui serait à l’adolescence ce que les Anges de la télé-réalité sont à l’intelligence. S’il y a une morale à ce récit – qui, notamment grâce à la vivacité de sa construction et au caractère parfois problématique de son narrateur, ressemble davantage à une fantaisie qu’à un roman à thèse –, ce serait simplement celle-ci : Foutez-leur la paix – « Les enfants voulaient à tout prix la rudesse des émotions réelles, des parents qui ne sont pas toujours d’accord avec eux, sont agacés, impatients, ou même ne les comprennent pas. Ils avaient besoin de parents qui ne s’intéressent pas à tout ce qu’ils font, qui ne craignent pas d’être irrités ou ennuyés par eux, qui n’essaient pas de gérer chaque minute de leurs vies avec la sagesse de Salomon » (p. 55).
Sur cette fantaisie, la plupart des lecteurs souhaiteraient apposer le qualificatif d’anticipation, ce qu’on ne saurait leur reprocher.