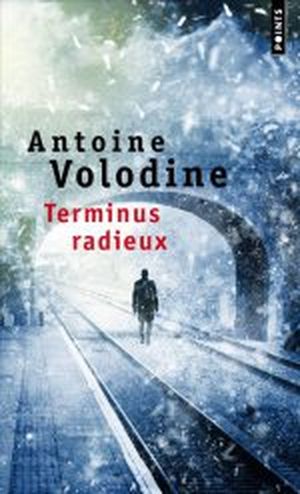Un roman magnifique, qui est à la fois une somme dépassant tous ses précédents livres, et une somptueuse porte d’entrée dans l’univers d’Antoine Volodine et des écrivains post-exotiques, pour ceux qui ont encore la chance d’avoir tout à découvrir (paru fin août 2014 aux éditions du Seuil).
Après l’échec et le naufrage de la Deuxième Union Soviétique, suite aux accidents en chaîne de petites centrales nucléaires déglinguées et à l’écroulement de l’Orbise, dernier bastion de résistance de ceux qui luttaient pour un monde égalitaire, Iliouchenko, Kronauer et Vassilissa Marachvili, trois combattants en bout de course, se réfugient dans des territoires devenus inhabitables à cause des radiations, pour échapper au massacre des derniers d’entre eux.
«Et puis, maintenant, le phare de l’Orbise n’éclairait ni le monde ni le petit territoire où s’étaient amassés ses ultimes partisans. Toutes les sauvageries allaient réapparaître. Tout ce que nous n’avions pas eu le temps d’éradiquer pendant nos courts siècles de pouvoir. La morale des tueurs et des violeurs allait se substituer à la nôtre. Les cruautés ancestrales ne seraient plus taboues et, de nouveau, comme dans la période hideuse qui avait précédé l’instauration de la Deuxième Union Soviétique, l’humanité allait régresser vers son stade initial d’homme des cavernes. Ses idéologues se rallieraient à ceux qui depuis autrefois prônaient l’inégalité et les injustices. Ses poètes mercenaires chanteraient la culture des maîtres. La soldatesque ne serait plus tenue en laisse. La danse de l’idiotie et du sang allait reprendre.»
Allant vers l’avant et vers la mort tout en s’entraidant, dans des espaces désertés de steppe et de taïga, ils vont se rapprocher du kolkhoze «Terminus radieux», communauté isolée du monde et de la ligne du parti depuis très longtemps, dont le président est un certain Solovieï, un homme imposant au physique de moujik hirsute, sorcier étrange qui recourt à des pratiques incestueuses et obscures, assisté de la Mémé Ougdoul, dont l’organisme est, comme celui de Solovieï, insensible aux radiations et qui gère les humeurs et appétits de la pile nucléaire, enfoncée dans le sol du kolkhoze depuis l’accident de la centrale locale.
«Solovieï quant à lui ne poussait jamais la porte de l’école pour parfaire l’éducation de ses filles. Il préférait se rendre à l’intérieur de leurs rêves. Qu’il choisit pour ce faire de traverser le feu, de s’engager corps et âme dans l’espace noir ou de se mettre à voler puissamment dans les ciels chamaniques, il aboutissait certaines nuits au cœur de leur sommeil et il y entrait sans frapper.»
Dans une nature abimée par l’homme pour des siècles, qui retrouve une majesté sauvage avec la raréfaction des humains, les errances de cette communauté et celles d’un groupe de soldats qui recherchent dans la steppe un camp où finir leur voyage, tels «un groupe de zombies au dernier stade de l’existence», forment un récit poignant sur une humanité crépusculaire, dans un espace où le temps et l’existence semblent s’étirer indéfiniment, et dans des directions paradoxales, créant des images d’une force inouïe et un univers de la pâte dont sont fait les rêves.
«Au-dessus de la steppe le ciel étincelait. Une voûte uniformément et magnifiquement grise. Nuages, air tiède et herbes témoignaient du fait que les humains ici-bas n’avaient aucune place, et, malgré tout, ils donnaient envie de s’emplir les poumons et de chanter des hymnes à la nature, à sa force communicative et à sa beauté.»
Comme Solovieï, Volodine est chamane, infusant dans ses romans tout ce qui l’a précédé et ici les contes en particulier, et faisant s’élever un récit somptueux, terriblement noir et nostalgique, et teinté de cet humour insensé et jamais entamé malgré les défaites.
«Le train cahote sur sa route à petite allure. Les passagers sont affalés dans la pénombre des voitures. Ils ne sont pas tous morts mais prétendre qu’ils sont vivants serait excessif.»