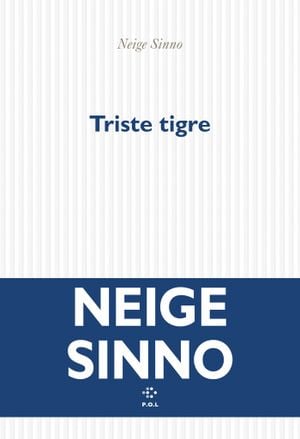Se méfier de Télérama. J'avais déjà noté que, côté cinéma, je suis plus exigeant que leur mascotte qui saute un peu facilement de joie. Pareil pour la littérature semble-t-il. Ce Triste tigre était à leurs yeux rien moins que le livre de la rentrée littéraire 2023.
Il s'agit d'un Nième témoignage d'une victime d'abus sexuel. Après Angot, Springora, Kouchner et tant d'autres, passés ou futur - je lis qu’Agnès Jaoui vient de commettre le sien. Attention, je ne suis pas blasé, je ne prétends pas qu'on en a lu assez. Mais le sujet ne suffit pas non plus à faire l'oeuvre. Neige Sinno en a conscience, on ne peut lui enlever ça. Au point que son récit est traversé par d'interminables circonvolutions intellectuelles : faut-il écrire ? à quoi ça sert ? est-ce une forme de thérapie (surtout pas) ? est-ce pour entrer dans la tête de la victime (c'est impossible) ? dans celle du violeur (c'est impossible) ? pour aider à tourner la page (c'est impossible) ?
Ce qui m'a intéressé, c'est précisément ce dernier point : cette idée qu'il est vain de vouloir se débarrasser d'un tel traumatisme. Ce qu'on peut faire, c'est apprendre à vivre avec, du mieux qu'on peut. Le violeur vous a fait ce que vous êtes, c'est sa victoire, c'est ce qui est tragique, au sens grec du terme : impossible d'échapper à son destin de violée. "Tout mon caractère, c'est lui qui l'a fait. Le bon et le mauvais. Le génial et le terrible" (page 177). C'est à mon sens le message fort du livre.
Ainsi, page 211, Neige Sinno évoque un voisin dont elle sait qu'il a subi le même genre d'expérience qu'elle : ils se comprennent sans se parler. Elle opère un rapprochement avec les gens qui ont été torturés en Syrie :
Ils ont vu le mal dans les yeux de leurs tortionnaires, ils ont été confrontés à l'impossibilité de nier la cruauté humaine. Ils ne peuvent plus se libérer de cela.
Je reconnais dans ces descriptions ce que j'essaie d'exprimer difficilement en ce qui concerne ma propre expérience : avoir été obligée de passer du côté obscur m'empêche à jamais de retourner à l'innocence.
Certes, l'autrice a trouvé un homme aimant, a eu une fille avec lui, vit à présent d'une façon relativement sereine au Mexique. Mais elle le dit page 231 : "(...) c'est une sensation étrange que d'être à l'abri quand on sait que l'obscur ne cesse pas d'exister quand on le quitte".
Ce qui m'a aussi intéressé, c'est cette idée que le viol est plus une question de pouvoir que de sexe. Si son beau-père l'a violée, c'est surtout pour perpétuer le pouvoir qu'il exerçait sur elle.
Neige Sinno s'est donc apparemment décidée à écrire tout de même, ce qui pose une nouvelle question : faut-il le faire en travaillant la langue ? Elle se méfie du style, craignant qu'il soit pour le lecteur une fuite devant la réalité nue. Ainsi dit-elle crûment les choses, et ce dès l'incipit du livre : "Etre seul dans une pièce avec un enfant de sept ans (...), mettre son sexe en érection dans la bouche de cet enfant, faire en sorte qu'il ouvre grand la bouche". Si le lecteur referme le livre après la première page, il aura au moins dû affronter cette obscénité-là. Pourtant, page 254, on pourra lire : "(...) prendre le lecteur en otage par la terreur, cela me semble être une faute artistique". N'est-ce pas un peu ce qu'elle a fait dès sa première page ? L'autrice refuse toute idée de distance par rapport à ses viols. Deux pages plus tôt, elle écrivait :
Mais faire de l'art avec mon histoire me dégoûte. Cette distance qui nous protègerait, moi et mes éventuels lecteurs, des éclaboussures, des fluides qui dégoulinent de la vie réelle, me semble un peu hypocrite, un peu raide, un peu menteuse aussi. Car c'est quoi cette fameuse Langue ? Qu'est-ce qu'elle a de supérieure à l'autre ? (...) Pourquoi est-ce que le témoignage serait forcément inférieur ?
En réalité, ce n'est pas une question d'inférieur ou de supérieur, mais une question de registre. Il y a le registre du journalisme, qui est d'informer, de susciter la réflexion, au besoin de bousculer. Exemple page 93 :
Les différents études sur les agresseurs que j'ai consultées indiquent qu'environ 20% des violeurs d'enfants sont d'anciennes victimes. Un chiffre légèrement supérieur à l'incidence sur la population globale. (...) le fait d'avoir été victime soi-même dans l'enfance est un facteur de risque, mais n'est pas une condition nécessaire ni suffisante pour devenir à son tour agresseur.
Si, avec cette dernière phrase, on enfonce un peu une porte ouverte, le chiffre de 20% d’anciennes victimes est plus faible que ce que je croyais. J'apprends donc quelque chose, mais dans un style journalistique. La langue employée est celle que je trouve dans Le Nouvel Obs. Pas celle que j'attends d'une nominée au Goncourt...
A côté du style journalistique, il y a celui de l'art, ce qu'on nomme la littérature, qui est de sublimer la parole, de faire accéder à un autre état de conscience. On peut comprendre la position de Neige Sinno, ce refus de créer du beau à partir du laid. Ce que Nabokov a fait, soutient-elle, n'est défendable que parce qu'il n'était pas un pédophile. Page 253 :
Vous êtes bien d'accord pour affirmer que si Nabokov racontait son histoire personnelle transformée en roman par l'utilisation de pseudonymes, du style et quelques fioritures, ce serait un peu problématique ? Est-ce que le livre serait littérairement toujours valable s'il s'agissait de l'expérience de l'auteur et d'une petite fille qu'il aurait vraiment connue et abusée ?
Littérairement oui, car l'oeuvre existe en elle-même (on aura compris que je me place résolument du côté de Proust et contre Sainte-Beuve). Moralement, c'est une autre histoire : je ne suis pas sûr d'avoir envie de découvrir l'oeuvre de Gabriel Matzneff...
Résumons : Neige Sinno veut témoigner mais ne veut pas vraiment témoigner, elle veut écrire mais ne veut pas trop écrire, au sens où j'entends ce mot : vraiment écrire, c'est-à-dire travailler la langue. Page 102 :
Je veux qu'il existe [ce livre], mais je ne souhaite pas qu'il ait beaucoup de lecteurs [quelle fatuité de publier et d'écrire ça !]. Car ce serait une façon d'exister dans la littérature non pas par mon écriture mais par mon sujet, ce qui a toujours été ma hantise.
Je veux témoigner mais sans être trop lu. Je veux qu'on m'apprécie, pas en tant que victime mais pour mes qualités littéraires, mais je ne veux pas que mon livre soit littéraire... Et je m'étends longuement pour expliquer ça. Il y a en réalité une certaine complaisance à se répandre sur la complexité de sa situation, à brandir son impuissance à résoudre ces paradoxes.
C'est précisément sur la question littéraire que mes réserves sont les plus fortes. Quelques exemples. Page 38 :
Il faut regarder ses bons côtés. C'est ce que les témoins qui sont venus parler ont dit aussi au procès. (...) Il l'avait donc fait, mais en dehors de ça, il était super.
Il était super, je n'écrirais pas ça dans un livre. Idem page 130 avec le trivial "je devais avoir dix ans, quelque chose comme ça". Je reproche aussi ce genre de choses, que je ressens comme des fausses notes, à Angot. Autre indicateur de faiblesse du style, la répétition, souvent signe d'impuissance littéraire. Ici page 182 : "Parce que j'ai été violée. Parce que j'ai été violée". A-t-on vraiment besoin de cette répétition pour comprendre que le traumatisme est persistant, alors que le livre ne fait que ressasser cela ?
On trouve aussi carrément des fautes de syntaxe. Page 105, on peut lire "on voit tous midi à notre porte". Soit elle utilise le pronom au sens général et il faut écrire "à sa porte" (j'aurais opté pour ça), soit elle veut dire "nous " et il faut écrire "nous voyons tous midi à notre porte". Même chose avec, page 114, "c'est surtout de lui dont elle se souvient". C'est soit "c'est surtout de lui qu'elle se souvient", soit "c'est surtout lui dont elle se souvient". Que fait le correcteur de chez P.O.L. ?... J'ai l'air de chipoter ? C'est au soin apporté à ce genre de détail que l'on distingue un écrivain, à ce travail d'artisan, d'orfèvre, qu'on attend moins d'un journaliste.
Bref, comme tant de récits autobiographiques qui paraissent, ce n'est pas vraiment écrit. Amusant que Neige Sinno cite Maylis de Kerangal. Il se trouve que ce Triste tigre succède dans mes lectures au dernier opus de celle-ci, Jour de ressac. L'effet de contraste fait très mal à Neige Sinno.
Sur le fond, quelques affirmations sont pour le moins discutables. Page 30, contestant que Lolita soit une histoire d'amour, Neige Sinno écrit "une histoire d'amour, c'est censé au moins être à deux". Donc une personne qui en aime une autre qui ne le lui rend pas, ce n'est pas une histoire d'amour ?... Voilà une conception bien restrictive de la chose. Que Lolita soit une histoire d'amour ne change rien à son caractère pervers. Car oui hélas, l'amour peut se loger dans la perversité.
Une fois ces grosse réserves posées, il faut reconnaître que ce Triste tigre comporte pas mal d'éléments assez féconds. Quelques exemples.
J'ai trouvé éloquente la comparaison de sa vie avec un film de David Lynch, page 83. "Un sentiment d'horreur indéfinissable, toujours là, poisseux", c'est exactement cela que distille le cinéaste américain. La référence aide à ressentir, un peu, ce qu'a vécu la narratrice (même si c'est impossible !...).
Quelques pages plus loin, page 88, Neige Sinno s'insurge, comme souvent dans le livre, contre un cliché, celui qui voudrait qu'écrire permette de "sortir de l'enfer" selon le mot d'Antonin Artaud. "En réalité, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que celui qui écrit, dessine, etc., est déjà de fait sorti de l'enfer, c'est justement pour ça qu'il peut écrire. Car quand on est en enfer, on n'écrit pas, on ne raconte rien, on n'invente pas non plus, on est juste trop occupé à être dans l'enfer." Cela me semble, en effet, très juste.
Sur la question de l'ambivalence d'un être, qui ne se réduit pas à sa part maléfique, sur les "bons côtés" cités ci-dessus, l'autrice trouve, page 106, une formule de nouveau parlante : "[la part maléfique] n'annule pas celle des bons côtés, des moments de joie, de la photo de famille, mais elle en change la nature, elle est sa part d'ombre, sa siamoise maudite". Si ce qui définit l'écrivain est cette capacité à trouver le mot juste, ici Neige Sinno l'est pleinement. Dont acte.
Moins bien formulée mais tout aussi instructive est cette idée page 121 :
Le viol est une soupape psychique. Il s'agit pour les agresseurs de se préserver, à travers la violence, de quelque chose de plus grave pour eux. Ce choix de la violence s'expliquerait par une acceptation sociale de celle-ci comme forme de défense masculine.
D'une part, loin du propos, stupide à mes yeux, de Manuel Valls, "comprendre, c'est déjà excuser", je pense que ce n'est qu'en comprenant ce qui se passe dans la tête des violeurs qu'on se donne une chance de résoudre la question. D'ailleurs, Neige Sinno l'affirme dès le début : "Car moi aussi [attaquer le roman par "car" m'a semblé une coquetterie de style, de ces artifices littéraires que l’autrice rejettera plus loin] , au fond, ce qui me semble le plus intéressant c'est ce qui se passe dans la tête du bourreau". D'autre part, la deuxième phrase dit bien l'un des points-clés : le surmoi. Le violeur n'a pas ce surmoi qui lui dit "ça, c'est interdit".
Page 174, l'autrice évoque son allergie à tous les mots qui contiennent "viol" :
Même certains mots qui n'ont rien à voir où les deux syllabes de viol apparaissent plus ou moins dans la composition provoquaient chez moi un rejet instinctif : violet, violon, de traviole, ravioles. Il me suffit de les entendre encore aujourd'hui pour qu'une tension se produise dans mon corps, automatiquement. Avant, c'était une petite décharge électrique. Maintenant c'est devenu abstrait, un malaise passager.
Lacan n'aurait pas dit mieux.
Page 222, Neige Sinno signe un passage vertigineux, lorsqu'elle raconte, avec une honnêteté très courageuse, qu'abuser de sa propre fille lui a traversé la tête. Elle masse sa petite fille et...
Il suffirait que ma main change de direction, qu'elle descende dans sa culotte. Je pourrais caresser sa petite fente si je voulais. Elle serait tellement surprise qu'elle n'oserait rien dire. Je pourrais mettre mon doigt dans son cul, c'est à quelques centimètres, et nos vies en seraient changées à jamais.
Et page suivante :
J'ai la certitude absolue que je ne vais pas lui faire du mal. Mais je peux sentir la frontière entre le bien et le mal. Je peux deviner ce qu'ils ressentent, ce rush d'énergie folle qui te traverse, cette adrénaline.
Il fallait oser écrire cela.
Enfin, d'une manière générale, l'autrice parvient à se tenir sur une ligne de crête : ni dans la haine ni dans le pardon. Une gageure.
Ces indéniables qualités compensent en partie la faiblesse de la forme. A l'heure où je rédige cette critique, les deux textes les plus lus sur SC mettent 10 et 2. Je me situe au milieu, légèrement au-dessus de la moyenne de ces deux positions extrêmes.