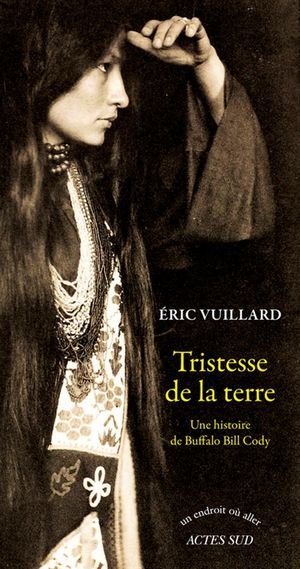Révéler la face cachée de l'Histoire avec un grand H, tel est le "créneau" qu'a investi Eric Vuillard. Qu'il s'agisse de la révolution française, de la montée du nazisme ou du Congo belge, l'écrivain s'emploie à démystifier de célèbres tranches d'Histoire. Ce sujet-là était donc vraiment pour lui puisqu'il raconte comment William Cody, dit Buffalo Bill, secondé par le major Burke, a créé de toute pièce rien moins que le mythe américain, à coups de grands shows qui tournaient partout dans le monde. Naissance aussi du show business donc. Bigre, rien que ça : il était urgent de s'y pencher en effet.
Comme toujours avec Vuillard, on s'instruit : on apprend ainsi que les cris lancés en tapotant sur sa bouche pour figurer les Sioux sont une pure invention de Cody. On découvre l'ampleur du massacre de Wounded Knee, que Cody surnomma La bataille de Wounded Knee. Page 52 :
Au petit matin, le 15 décembre 1890, une quarantaine de policiers indiens avancèrent au petit trot jusqu'à environ un kilomètre et demi du camp de Sitting Bull, puis entrèrent au galop dans le village. Tout le monde dormait. Ah ! que nous aimions le petit matin, la fraîcheur de l'air, les grandes lames de lumière sur la terre pierreuse. Mais ce matin-là, ce n'étaient pas les oiseaux qui chantaient, ce n'était pas la jeune fille qui faisait sa toilette en fredonnant dans la cabane voisine, c'étaient les sabots de quarante-trois chevaux qu'on entendait dans un demi-sommeil.
Tous, hommes, femmes, enfants, seront tués.
A la tristesse, s'oppose l'ivresse du grand spectacle. On apprend que le Wild West Show alla jusqu'à recruter des Indiens chassés de leur réserve pour faire plus authentique. Jusqu'au grand Sitting Bull. Il y a de l'obscénité qui éclate à chaque page de ce Tristesse de la Terre. Pourtant, pas trop de manichéisme venant de Vuillard : Buffalo Bill est présenté comme respectant et même aimant les Indiens. Ce que dénonce surtout l'écrivain, c'est l'attirance populaire pour le spectaculaire et le clinquant. Intemporel.
Comme toujours avec Vuillard, le style est de qualité, mordant, souvent teinté d'ironie. Cet opus s'achève, de façon surprenante, sur une figure positive, à l'opposé de la démesure du Wild West Show : le portrait de Wilson Bentley, un homme qui consacra sa vie à étudier... les flocons de neige.
Au début, il croyait découvrir un modèle unique ; il se trompait. Dieu a fait autant de modèles que de flocons. Et afin que cette merveilleuse beauté ne soit pas perdue, Wilson les dessine. Mais les flocons disparaissent. Pfft. Il n'a jamais le temps de terminer son dessin. Sa propre haleine les fait fondre. On dirait que Dieu veut garder le secret de leur individualité innombrable [belle formule].
Un éloge de la modestie, de l'éphémère, de l'impalpable, de l'attention portée à ce qui semble négligeable. Il voulut même photographier le vent. Mais c'est à la neige qu'il retourna au soir de sa vie. Ainsi se conclut le roman :
Il vendait ses clichés à cinq cents, et puis on en retrouvait les motifs reproduits sur des bijoux très chers, chez Tiffany. Il ne connut ni la richesse ni la gloire. Après la mort de ses parents, il vécut seul dans une petite partie de la maison, ses frères et soeurs occupant le reste. Un beau jour, à l'âge de soixante-six ans, tandis qu'il se promenait dans la neige, à dix kilomètres de chez lui, le froid lui pénétra les os ; mais il voulait encore voir quelque chose, absolument, une stalactite de glace sur une branche de pin. La tempête se leva. On l'appela. Mais il regardait encore. Il regardait la forme si fine et si gracieuse de ce morceau de glace, sa tige frêle, mince, sensible, sa frange vaporeuse. On le porta chez lui inanimé. C'était la veille de Noël. Lors de son enterrement, on raconte qu'il neigeait.
7,5