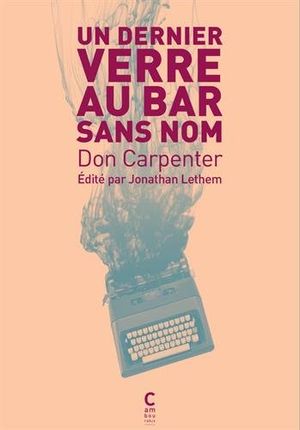Ouvrir Don Carpenter c’est se prendre en pleine poire les vents d’une nostalgie qu’on n’a pas connue. C’est côtoyer la Beat Génération tout en restant simple spectateur, de peur de salir le décor, mais en s’estimant déjà chanceux de pouvoir les « approcher ».
Un dernier verre au bar sans nom dresse le portrait de personnes plus ou moins douées pour l’écriture, vivant en quelque sorte dans l’ombre de Kerouac, Ginsberg ou encore Richard Brautigan. Tout en étant fidèle aux thèmes qui sont chers à Carpenter (l’univers carcéral, l’homosexualité, le milieu d’Hollywood, …), on est donc invités à voyager d’une côte à l’autre des Etats-Unis tout en jubilant du génie de l’auteur. Impossible de terminer un paragraphe sans se dire « ce type à tout compris à la littérature américaine et à la frustration du rêve américain non abouti».
Roman inachevé, publié à titre posthume, c’est en prenant son temps à lire chaque ligne, en étant le plus concentré possible qu’on parcourt les 380 pages de ce récit sensible et gigantesque, avec dans le bide une sorte de jalousie admirative pour l'auteur.
Rien que les contrastes entre ces personnages destinés à devenir de grands écrivains qui se cassent la gueule, de voir des paumés devenir des dieux littéraires vivants qui finissent par se faire bouffer par l’industrie du cinéma américain des années 60 valent ce putain de détour.
Pour moi c’est un grand oui, un Kerouac en mille fois moins chiant, un prélude au Karoo de Steve Tesich tant les portraits de cette Amérique semblent authentiques.
Z’avez pu qu’à vous ruer dessus, gros gros coup de coeur !
Booyaaah !
Lou