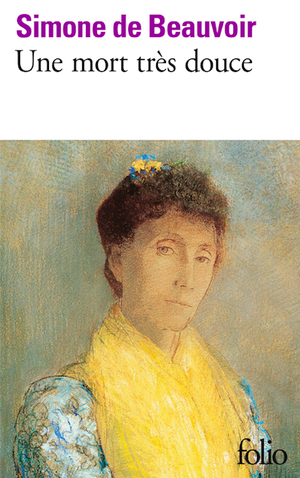Dans ce récit biographique, Simone de Beauvoir relate et partage un intime bouleversant : les derniers jours de sa propre mère, Françoise, alors atteinte d’un cancer irrémédiable de l’estomac.
Nous suivons avec la femme de lettres et ses ressentis, ses angoisses, ses dilemmes moraux, ses rétrospections, cette descente agonique vers le néant. En effet, tout en en relatant les étapes, les soubresauts, l’intellectuelle confronte à la manière d’un dernier bilan la vie de sa mère et la sienne, mettant à jour les rapports complexes, distants qu’elles ont entretenus. Pour Françoise, Simone est à la fois une philosophe reconnue et admirée des autres, mais une fille qu’elle comprend peu et dont elle s’inquiète des choix, notamment en matière de mœurs et de religion. Inversement, reconnaissant certes à sa mère une vitalité à toute épreuve, Simone constate néanmoins la vie étriquée dans laquelle elle s’est empêtrée du fait du rigorisme de son enfance et de sa génération (dont le mariage et la primauté du mari), les contradictions entre cette existence et le désir d’être pour-soi et le ressentiment qui en a découlé. Ne satisfaisant pas à ce désir d’indépendance, Françoise a d’une part beaucoup vécue par ses filles (Simone et Poupette), d’autre part en jugeant selon les autres, faisant ainsi montre d’une possessivité et d’un suivisme tous deux refusés par Simone et créant une lourde distance que les années n’ont su combler.
« Penser contre soi est souvent fécond ; mais ma mère, c’est une autre histoire : elle a vécu contre elle-même. Riche d’appétits, elle a employé toute son énergie à les refouler et elle a subi ce reniement dans la colère. Dans son enfance, on a comprimé son corps, son cœur, son esprit, sous un harnachement de principes et d’interdits. On lui a appris à serrer elle-même étroitement ses sangles. En elle subsistait une femme de sang et de feu : mais contrefaite, mutilée, et étrangère à soi ».
Cela étant dit, à l’annonce du cancer et de la fin certaine attendant sa mère, Simone est prise d’un vertige et d’un chagrin qui la surprennent et qu’elle ne parvient pas à rationaliser. Est-ce l’accompagnement final d’un être aimé qui dépérit, qui souffre, et dont on redoute la maltraitance, la torture thérapeutique ? Est-ce le remords d’avoir permis l’opération garantissant quelques jours de survie, mais à quel prix ? Est-ce le trouble lié au mensonge par lequel Poupette et Simone maintiennent leur mère dans l’espoir en taisant la présence du cancer ? Est-ce encore la volonté inébranlable de vivre qui habite Françoise ? Sans doute la composition d’un tel chagrin n’est-elle pas chimiquement pure. En revanche, ce qui ne fait point doute, c’est la proximité retrouvée qu’éprouve Simone à différentes occasions : lorsqu’elle voit sa mère s’écouter enfin, tout en restant empathique et disponible aux autres ; lorsque ses forces uniquement dirigées vers la guérison et la vie, elle ajourne la visite des confesseurs ; suprêmement, pour se joindre à la révolte de la vie contre la mort.
Cette combativité, certes vaine, n’était pas sans grandeur. Finalement, Françoise s’éteint relativement rapidement, au terme d’un mois, sans avoir trop souffert : d’ « une mort très douce ». Simone de Beauvoir peut s’apaiser du fait d’avoir été là pour sa mère, d’une présence apaisante. Certes, on ne rattrape pas le temps perdu, mais la question n’était pas là puisque ce temps passé non-partagé le fût en conscience.
L'écrivaine achève son récit par un point de vue philosophique et phénoménologique de la mort. Elle considère ainsi qu’ « on ne meurt pas d’être né (…). On meurt de quelque chose ». Autrement dit, la mort, plus précisément le vécu de la mort (précision allant de l’abstraction à l’existence), n’a jamais rien de naturel. Elle n’est pas inscrite au cœur même du processus vital, à la manière d'une énième étape. Indépassable, elle n’en constitue néanmoins pas autre chose que son Autre radical.
On ne meurt pas de vivre.