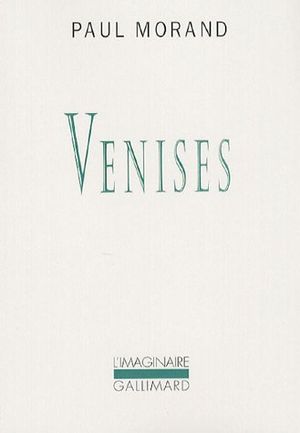Il a fallut que je m'adresse à Wikipedia et autres encyclopédies en ligne pour bien cerner (est-ce possible?), en amont de ma lecture, le personnage de Paul Morand, écrivain et diplomate au parcours décrié. Venises fait partie de ses œuvres tardives (publiée en 1971, cinq ans avant sa mort). La découverte avec les premières pages du texte de son aspect autobiographique et chronologique (on pourrait plus justement parler de journal de bord psychologique), m'a tout à la fois inquiété et fait palpiter, tant il semblait intéressant de lire la « défense » d'un individu dont l'histoire a définitivement inscrit en marge du nom la mention, Académicien collaborateur.
Et finalement non. Dérivant sur l'onde paisible d'une sorte de mélancolie, Morand a semble-t-il choisit de sauter des pages, et d'omettre certaines années de sa vie. Ne s'est-il jamais rendu à Venise entre 1939 et 1950 quand il semble y avoir séjourné chaque année en dehors de cette période ? N'y a-t-il jamais pensé ? On peut en douter. Mais, si l'ouvrage saupoudré de déclarations polémiques aurait probablement gagné en intérêt, il aurait certainement perdu en sincérité. Morand a choisi de faire de ses Venises le fil conducteur, le métronome de ses mémoires. Son silence est à cet égard une grande marque de respect.
Pourtant si le propos, tel une gondole voguant sur la lagune vénitienne, est marqué par une langueur délectable, que l'on ne pouvaient qu'attendre d'un vieil homme « sage » qui se remémore ses jeunes années passées dans une ville hors du temps, il ne parvient malheureusement pas à éviter les hauts fonds du « c'était mieux avant » et de la « triste époque ». Se teintant de fait d'une aigreur et d'une mélancolie qui gâchent au lecteur une partie de son plaisir.