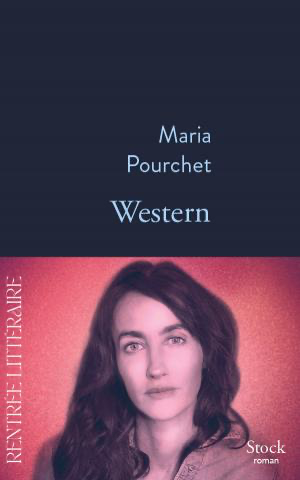Après Feu, Maria Pourchet nous narre le coup de foudre improbable entre un acteur à succès et une cadre coordinatrice de projet dans le numérique. Tous deux ont fui la capitale pour une maison isolée dans les Causses. Le célèbre Alexis tente d'échapper à la furie médiatique déclenchée par le suicide d'une ancienne conquête qu'il a poussée au désespoir. La très ordinaire Aurore veut rompre avec son bullshit job et avec tout ce que sa vie charriait de non sens. Ce qui les réunit ? Alexis est le propriétaire de ladite bicoque, l'ayant acheté à la mère d'Aurore sans que celle-ci soit au courant. Malaise.
Ce qui est bien vu, c'est de commencer par le sexe. On est au XXIème siècle, donc c'est madame qui prend l'initiative. Cette étape-là évacuée, on peut passer aux choses sérieuses : se connaître. Non plus charnellement mais en causant. Là, les choses se gâtent : le jeu "action/vérité" donne lieu à une confession lourdingue au sein d'une grange attenante dans laquelle le comédien s'est replié. C'est long, peu passionnant et modérément crédible. Plus réussi est le décorticage des sms qu'Alexis échangea avec Chloé, sa jeune conquête : Maria Pourchet met à jour ce qui se terre derrière le langage d'une façon assez réjouissante. Exemple, page 212 :
Nous y sommes. Le discours remplace, le discours fantomatise l'amour et vampirise le sujet. La perversion ici d'Alexis et son impardonnable faiblesse furent d'engager les mots et non sa personne, suscitant une escalade hystérique chez le sujet aimé. Bientôt Chloé, en cette glissante fin du troisième temps, ne peut que superposer présence verbale et présence physique. Le réel et le fantasme, le ressenti et le tangible, le lu et le vécu sont démoniaquement voisins, perméables et bientôt indistincts. Elle devient folle, comme promis. Elle est faite, ainsi qu'on dit dans la cuisine des gibiers faisandables.
(Comme on le voit, l'écrivaine ne recule pas devant des néologismes : fantomatise, faisandables, démoniaquement. J’aime plutôt bien)
L'impression qui domine est celle d'un roman assez inégal. Sa principale faiblesse à mes yeux est de ne pas parvenir à rendre son couple attachant. Tout ça manque beaucoup de chaleur, à l'image du style de l'écrivaine, volontiers tranchant. Quant au parallèle avec le western, il m'a semblé pour le moins capilotracté - pour employer, à mon tour, l’un de mes néologismes favoris. La tentative de dresser le portrait d'un Don Juan aujourd'hui n'est guère plus convaincante.
Le style ? J'avais beaucoup aimé celui de Feu. Ce nouvel opus aussi est indubitablement écrit : il y a une certaine densité, et quelques phrases bien senties. Page 55, cette allusion à son premier roman à succès, dans la description de la mère d'Aurore :
Feu professeurs d'anglais, qui serait feue agrégée d'anglais si Aurore n'était pas née un mois avant l'examen. Et surtout huit mois après un "oui" pensif et irréfléchi dans une mairie communiste - la deuxième vague du féminisme, avait coutume de dire Sabine, ne m'est pas suffisamment passée dessus, en tout cas beaucoup moins fort que ton père.
Page 57, cette jolie formule aux allures de zeugma: "Elle doit sa nouvelle maison à la mort de sa mère, et sa nouvelle fonction à la mort du travail." (puisque Aurore a pu s'installer là grâce au télétravail). Et, dans la même veine, celle-ci, s'agissant de la relation d'Alexis à Chloé, page 215 : "Enfin, ultime privilège patriarcal, Alexis s'octroie le droit souverain de parler en dernier. En étant le premier à se taire". Joli paradoxe. Page 229 encore : "Et le coût pour elle de se taire encore, et de continuer comme d'habitude, balader dans Paris ses ensembles graphiques en laine froide, son invariable demi-sourire qui demi-ferme ses yeux minces".
A certains moments, à la manière d’un Kundera, l'autrice s'immisce dans le récit, de façon assez savoureuse comme page 132 : "Chloé, flanquée de sa mère qui lui ressemble désormais plus qu'elle ne devrait, mère qui n'est pas là pour être décrite mais pour soutenir et accompagner".
Et pourtant, la magie n'opère pas. La faute à ce que j'ai ressenti comme un manque d'authenticité : j'ai eu sans cesse la sensation que Maria Pourchet se regardait écrire, multipliant les "coups" pour en mettre plein la vue. Exemple page 149, cette succession de courts paragraphes, procédé que j'ai trouvé très poseur :
C'est faux.
Qu'un amour l'a convaincu de tenter un concours national.
N'importe quoi.
Que sa mère a vu en lui dès son plus jeune âge un genre de Sarah Bernhardt.
C'est la meilleure.
Que.
Tout est faux. Tout.
Cette dernière phrase s'applique assez bien au roman de Maria Pourchet. Rebelote page 238 :
On pourrait le débusquer dans son trou, lui trancher la carotide.
Qui ça on ?
On.
Poseuses aussi ces successions de phrases courtes. Exemple page 189 :
Lui. Il ne la reconnaît pas à l'instant. La tristesse dont elle est repeinte. Les yeux, le visage, les vêtements. (...) Lui revient une seconde, une seconde seulement, l'obsession motrice qui l'avait fait renaître et devenir. Etre quelqu'un d'autre. Il voudrait être quelqu'un d'autre. Ce désir-là, à vingt ans c'était des ailes. A quarante-cinq c'est un aveu de défaite, d'abandon. D'ailleurs il va bientôt abandonner.
Signalons pour conclure une faute de syntaxe, page 217 : "Mais le petit ne dirait rien non plus, sa mère lui a demandé de mentir et c'est sa mère, alors il ment". "Ne dira", non ?
Résumons. Une histoire d'amour insuffisamment étayée, un style un peu trop complaisant, un raccord artificiel avec les films de cow-boys : malgré ses qualités de forme, ce Western manque un peu sa cible.