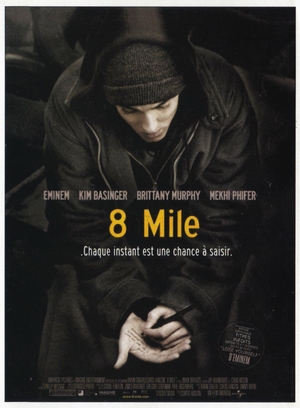8 mile n’est pas un grand film, on ressent très bien au visionnage qu’il n’en a pas l’intention. Mais il a le mérite d’être une excellente photographie de l’environnement dans lequel a grandi Eminem. Deux ghettos, celui des blancs bouseux (white trash) du Michigan et celui des noirs rassemblés dans des quartiers tout aussi délabrés que celui des blancs, deux mondes théoriquement séparés par la 8 mile road, pour éviter tous conflits, ceux qui sévissaient violemment dans les années 60, et ceux-là même qui ont fait fuir massivement les blancs dans les années 70. «Théoriquement séparés» car en réalité les blancs composent avec les noirs dans une tension de chaque jour, dans la même misère. Le film capture tout ça.
On se ballade avec Jimmy et sa bande de pote nourrie à Tupac, Mobb Deep, Notorious Big et autre Rakim (il y a même un moment où on entend Outkast) et qui zonent comme les galériens qu’ils sont. Jimmy est un loser qui vient de larguer sa copine, il taffe à l’usine, rare survivante d’une ville industrielle longtemps aux mains des grands groupes puis plus tard rongée par la crise. Détroit est une ville pleine de cicatrices. Rien d’étonnant de voir tout le long du film des noirs improvisés des mini rap-battle à la sortie du taff ou sur les parkings comme quelques bluesmen grattaient des guitares en leur temps, les gestes du désespoir se répètent à travers la musique, des gestes de création.
Chaque semaine Futur organise des battles au Shelter, l’occasion de montrer ce qu’on a dans le ventre, Jimmy y participe mais la peur retient ses mots et le film choisira de raconter la revanche qu’il nourrira pendant plusieurs jours, c’est la motivation de Jimmy qui sera le squelette du film. Mais même en tant que fan d’Eminem, ce n’est pas ce qui m’a intéressé quand bien même les scènes de battle sont puissantes. Moi ce que j’aime dans 8 Mile c’est la chair du film, la photographie presque zolienne de la jungle urbaine et les conditions de vie de ceux qui l’habitent.
Si les noms des gens et des lieux sont inventés, toutes les situations filmées sont vraisemblables et réalistes. Les quartiers délaissés, le Chin Tiki comme lieu de rendez-vous, les nombreux affrontements entre groupes représentants chacun leur quartier, les trailer park qui pullulaient dans la ville, les radios locales, le Shelter qui dans la réalité s’appelait le Saint Andrew’s et qui était une église abandonnée réaménagée en lieu de battle, les gestuelles de ces battles, la maison abandonnée qu’on s’amuse à brûler (en réalité chaque veille Halloween les jeunes brûlaient des maisons abandonnées durant ce qu’ils appelaient la Devil’s Night) etc…
Le défaut du film alors ? Trop s’attarder sur cette réalité sans chercher à booster l’intrigue et ennuyer le spectateur non renseigné en l’entraînant dans un film qui promet d’être un Rocky du rap alors qu’en réalité il s'attarde sur autre chose.