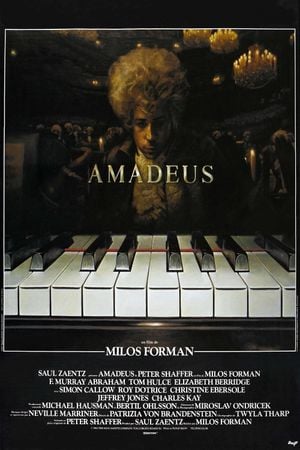Derrière une lourde porte fermée, un homme crie, hurle à la mort, implore : "Pardonne, Mozart, pardonne à ton assassin !" On frappe, on tambourine, on tente de l'appâter avec d'appétissants gâteaux ruisselant de crème, mais rien n'y fait. Les deux valets forcent la porte, tombent sur un vieillard ensanglanté, le cou tranché. On le transporte en hâte sur un brancard, il neige. C'est Vienne, en 1823. Les images défilent, chaotiques, impressionnantes : le clair-obscur d’une cellule, des yeux qui regardent en dedans et qui flamboient sous les rares cheveux blancs d'une tête ridée, couleur de parchemin moisi par le temps. En face, un jeune prêtre écoute avec stupeur. On se croirait dans un conte d'Hoffmann. D'emblée, le récit est placé sous l'emprise de la demande, du péché, donc de la confession. Antonio Salieri vit un calvaire depuis trente ans, et ne redeviendra vraiment lui-même que s'il se confie, s'il avoue son crime. Par l'intermédiaire du curé, le spectateur entre dans la fiction, il va enfin comprendre de quels remords il s'agit, et de quel crime. Le film s'inscrit à l'intérieur d'un récit rétroactif, d’une pseudo-pénitence. Pseudo car elle est profondément païenne. Ce faisant, le vieillard dresse avant tout son propre portrait, celui de l'abjection, et il jouit en blasphémant. Lorsque le prêtre lui rappelle que tous les hommes naissent égaux devant Dieu, Salieri lâche un sourire amer. Pour lui, depuis longtemps Dieu a choisi son camp : avec son adversaire, Mozart, caché dans sa musique. Et si Dieu est avec Mozart, celui-ci, innocent, inconscient, libertin, ne le sait pas — c’est là toute l’ironie, la grande farce de l’histoire. Le dispositif du film met Salieri en position de contrôle (il n'a pas cessé de regarder vivre le célèbre compositeur, de l'analyser, sans que l'autre n'en sache rien), mais de contrôle hystérique : Mozart est de toute évidence, même pour lui, un maître. À la faveur de la narration, le vieillard va pouvoir se libérer pour finir en paix, rieur, illuminé. Avec la bonne humeur d’un moribond sadien, il se proclame le "Roi des Médiocres", leur Saint. Donc la confession commence, et on bascule dans le passé.
https://zupimages.net/up/18/05/ximf.jpg
Pour Miloš Forman, les retours en arrière ne sont pas des figures de style. Sans le suicide manqué, sans la folie rôdant dans les couloirs de l'hôpital, sans les éclairs de lucidité grondant dans l’esprit du vieil homme, les visions extravagantes qui surgissent n'auraient pas de sens. Premier point : la mise en scène est subjective, prend en charge les souvenirs et leur déformation par la psychanalyse sauvage du septuagénaire s'adressant au prêtre. Deuxième point : la vraisemblance historique des maisons, des palais (le rococo viennois XVIIIème siècle reconstitué grâce aux richesses architecturales de Prague), des décors et des costumes, authentifie l'époque. Qu'importe si, à la cour de l’empereur Joseph II (qu’interprète savoureusement Jeffrey Jones, avec son œil de gallinacé futé), les personnages parlent anglais. Leur vérité est dans leurs apparences et leur comportement — vérité supérieure, au-delà de la véracité historique, et qui sonne étonnamment juste. Troisième point : le conflit sous-tendant le ressentiment de Salieri, motivant ses actes, est celui de la création musicale considérée comme un don de Dieu. Ce don n'est pas allé au compositeur italien fécond, fêté et respecté, mais à un être qu'il en juge indigne. Cette musique-là vient du ciel, qui l'a donnée à un ange impur aux dépens de Salieri, son fidèle serviteur. Celui-ci jettera au feu son crucifix, signe blasphématoire du combat engagé contre l'ange. Au milieu des intrigues de palais, des bals masqués délirants, des concerts, des représentations théâtrales, il tisse sa toile de haine. Il ourdit une machination qui prend peu à la peu la signification d’une révolte prométhéenne : en s’appropriant la création ultime de Mozart, il vole le feu aux dieux. Mais son but est inatteignable, son projet porte en lui-même son propre échec : c’est parce qu’il est le seul à avoir identifié le génie de son adversaire, à s’en préoccuper, et parce qu’il en est le plus grand admirateur, que Salieri ne peut supprimer ni l’œuvre ni cet homme vulgaire qu’il méprise.
Amadeus est donc l'histoire d'un impossible tandem, car si la figure de Salieri n'existe que dans une relation avec Mozart, hantée par la jalousie, le calcul, l'obsession de l'observation, celle de Mozart au contraire se suffit à elle-même : le jeune homme est un charmeur effronté, grossier, picoleur, turbulent, brûlant la vie par les deux bouts, mais aussi un artiste insolemment, outrageusement, évidemment génial. Il a les traits contemporains d'une pop star punk ou d'un super champion (un Messi ou un Federer de la musique), il est une incarnation moderne d'enfant-roi, iconoclaste au regard des mœurs de son temps. Toute la force dramatique du film tient dans la non réversibilité du duel Salieri/Mozart. La rivalité exacerbée ne joue que dans un sens, elle grandit d'autant qu'elle ne trouve aucun répondant chez l'autre, qu'elle n'est pas réciproque. On pourrait presque dire que le génie de Mozart est quasi-autistique (il rit du rire des idiots), ce qui ne fait que rendre plus folle encore l'obsession de son adversaire. S'il y a un mot qui dit bien à quoi ressemble cette structure, c'est celui de panoptique. On ne voit Amadeus que par les yeux de Salieri, carriériste distingué qui arbore les signes des vertus ascétiques de l’artiste entrant en art comme on entre en religion. C’est lui qui dialogue avec le divin, dont il ne reçoit que des réponses sporadiques et nécessiteuses. S’il ne renonce pas à la réussite sociale et vise la gloire posthume, la pratique quotidienne de sa musique se plie à la règle la plus monacale et la plus besogneuse. Le héros tragique, c'est lui. Mozart, de son côté, ne se pose pas ce genre de questions : il vit, il s'amuse, il sait que sa musique est bonne parce qu’il est vantard et connaisseur, mais il ne cherche pas à donner dans le sublime. Il ne théorise pas sur la mystique de l'art, il crée simplement car c’est dans sa nature. C'est un élu. Paillardise, ivrognerie, scatologie sont les contrepoints d’un génie qui jaillit naturellement, dans l’ignorance de toute morale, sans le moindre échange contre le renoncement à la vie du corps. De la statue du commandeur à papa Leopold, du cabaret à la fosse commune, rien d’essentiel ne manque au récit de sa vie. Sauf qu’il ne s’agit pas d’un tableau mais d’un "thriller dans un milieu musical", comme le définit judicieusement le cinéaste, trop profondément homme de spectacle pour s’intéresser au noyau dur de son film, à l’os du sujet, sans l’habiller de ce qu’il faut de chairs crédibles et de falbalas d’époque.
https://zupimages.net/up/18/05/7hif.jpg
La lutte entre Salieri et Mozart est ainsi contée avec plus que du brio : une plénitude constante dans l’expression, propre aux vraies œuvres inspirées. Les plans sont coupés au ras de leur durée nécessaire, les transitions sont continuellement inventives (voir ce moment où Salieri froisse une partition : le bruit se prolonge dans le vacarme assourdissant d’un coup de tonnerre), les couleurs sont plus vraies dans leur symbolique que les objets colorés qu'elles représentent, le mouvement est plus dansé que joué. Tout particulièrement, Forman fait un usage admirable de la musique, d’opéra surtout, plaçant des extraits superbes aux plus hauts points de tension. Son statut ne cesse de changer d’une seconde à l’autre : dramatique, décorative, écrite, fredonnée, jouée... Elle semble réellement divine ; elle se crée, on peut dire, sous nos yeux. Elle s'élève dans les décors bariolés, à la faveur de mises en scène dépourvues de grâce, elle se génère sur un lit de tortures, elle peut s'improviser dans des lieux de débauche. Ce qu'il reste d'enfantin chez Mozart adulte n'a rien de merveilleux, ce n'est pas la part de poésie qu'il a conservée mais ses tics hérités d'une éducation de chien savant. Vieillard dément ou homme mûr pétri de jalousie dévorante, de fureur rentrée, d'esprit de vengeance, F. Murray Abraham est aussi formidable que Tom Hulce, dissipant son talent et son argent en distractions stupides avant d'accéder à l'ascèse par la hantise du père, la pauvreté, l'approche de la mort. Lorsque Salieri se travestit en homme noir venant commander le Requiem, puis se montre, à visage découvert, un faux ami qui arrache à Mozart mourant les notes de l’œuvre inachevée et découvre alors l'ineffable création, Amadeus atteint son sommet. Forman réussit à filmer un processus magique : Mozart compose comme il respire, et s'il respire mal vu qu'il agonise, il compose génialement, de façon visionnaire, tel un médium. Il imagine sa musique, fait danser les notes devant lui, devant Salieri qui, pourtant expert, a du mal à suivre. Préposé à la dictée, ce dernier est le passeur entre Mozart et le spectateur. En faisant culminer son film dans cette séquence, Forman joue moins à "l'un contre l'autre" — Mozart contre Salieri — qu'à "l'un faisant la courte échelle à l'autre", par un amour commun de la musique. L'exploit est presque redevable des deux, unis dans un effort transcendant : le premier est seul dans son acte créateur, le second nous le rend tangible.
L’une des forces du cinéma de Forman a toujours résidé dans son talent à portraitiser ses protagonistes au plus profond de leurs vérités psychologiques. Ici, le principe transite souvent par des antinomies : Mozart prend un plaisir fou à la parodie grotesque de son Don Juan, la salle entière reprend en chœur La ci darem… Tout le film contredit l’imagerie convenue en même temps qu’il s’en sert sans vergogne. Le dessin est inséparable du mouvement, il est lié à une structure, à un montage par l'action, à un sens remarquable du cadre et du plan, à l'immanence d'un propos politique qui ne s'avoue pas comme tel mais qu'il est impossible de ne pas lire en creux. Ce propos est indissolublement rattaché aux personnages, à la variété des caractères qui transparaissent, à leur position par rapport à la Loi (c'est évident dans l'opposition des figures de Mozart et de Salieri). S’il dresse avec une infaillible précision de trait la peinture d’une époque, de ses coutumes, de ses codes sociaux, s’il analyse les rapports du pouvoir, du spectacle et de la culture, Forman fait aussi une œuvre subversive, en tordant le cou à toutes les règles établies de la biographie filmée. Auréolée d’un prestige jamais démenti, consacrée par une Académie des Oscars qui (cela lui arrive parfois) ne s’est pas trompée, son entreprise demeure toujours aussi étonnante de richesse et de beauté.
https://zupimages.net/up/18/05/i3yt.jpg