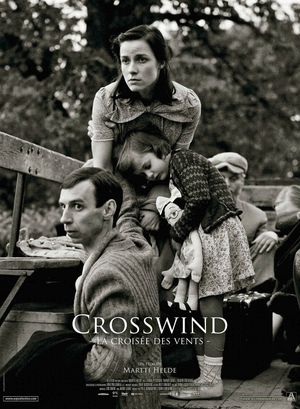Le cinéma, comme son étymologie l’indique, est l’art du mouvement. Or dans In the Crosswind de Martti Helde, celui-ci nous propose une succession de tableaux figés au service de son propos, le destin d’une famille séparée et déportée en Sibérie à l’époque stalinienne. Cette forme de mise en scène cadre bien avec l’histoire racontée, celle d’une famille heureuse, comme en témoignent les scènes initiales où les personnages sont en mouvement, qui se retrouve victime de la folie de Staline, ce qui a pour but de leur enlever ce qu’ils ont de plus précieux : leur vitalité. Si à partir de ce moment là, tout devient figé, les tableaux sont pourtant bien loin d’être immobiles : il s’en dégage un incroyable dynamisme, par l’expressivité des personnages les composant, le mouvement d’un rideau dans le vent ou un infime battement de paupière, et les sons permettent de faire vivre l’image. Helde maîtrise parfaitement la composition du cadre, ce qui donne naissance à des images incroyablement puissantes, une parmi tant d’autres serait celle du face à face entre un soldat russe armé et un petit garçon brandissant son épée en bois avec un air de défi, devant les camions de déportés. Les tableaux sont extrêmement travaillés : on y perçoit un énorme travail du chef opérateur, chaque contraste est pensé, le noir et blanc est sublimé par les jeux de lumière. La caméra circule au milieu de ces compositions avec fluidité, jouant sur la focalisation pour nous faire voir chaque expression, chaque détail. Cette mise en scène est finalement une illustration de leurs vies volées, mises en suspend pendant ces longues années d’exil sous la blancheur sibérienne.
Les lettres d’Erna, qui expriment la situation avec justesse, nous guident au long du film et donnent une dimension toute personnelle à ce cauchemar, à la manière du journal d’Anne Franck. Mais au fur et à mesure s’opère un décalage entre la voix d’Erna et l’image : pendant que celle-ci continue de s’accrocher aux minces espoirs qu’il lui reste, la caméra nous montre quant à elle la réalité, comme l’exécution d’Heldur, qui nous est montrée de loin, à travers des barreaux, sans bruit de coup de feu, comme si la violence était mise à distance. L’ampleur de cette répression est seulement suggérée par l’empilement de bottes abandonnées.
A la fin, Erna se remet lentement en mouvement quand elle peut enfin retourner en Estonie, à la mort de Staline. Elle reste un moment immobile, devant le train, pendant qu’autour d’elle la vie semble avoir repris un cours normal, puis elle s’avance, goûtant cette liberté qui lui est remise, mais en laissant pressentir la difficulté qu’elle aura de faire son deuil, comme le montre les souvenirs du début qui reviennent.
Finalement, le choix de cette mise en scène audacieuse, que d’aucuns qualifieront de pompeuse, permet de donner au film toute sa cohérence et sa force, et nous montre un pan « oublié » de l’Histoire à travers un témoignage d’une grande sensibilité.