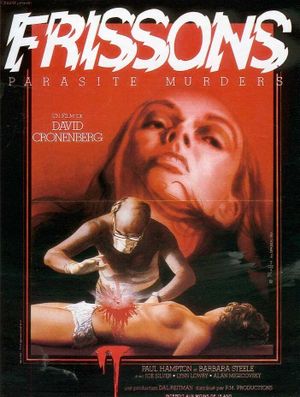ça commence sur cette dichotomie propre au film d'horreur (et à plus forte raison du film d'horreur gore) : sur fond de musique angoissante, on nous présente une résidence idéale, apte à combler tous les besoins de ses habitants ; tellement apte, d'ailleurs, que ces derniers y vivent en quasi autarcie, avec leurs propres services d'alimentation, de sécurité...et surtout leurs propres services médicaux. Un petit paradis sur terre que l'on peut voir d'abord sur papier glacé, mais qui n'est pas si différent en vrai. Tout est net, propre, immaculé.
Mais pendant que de nouveaux résidents (un petit couple tout ce qu'il y a de plus tarte, le genre à prendre son premier appart’, acheter une voiture et faire un premier enfant dans la même minute pour cocher toutes les cases de la normalité) emménagent dans la résidence, un drame se déroule quelques étages plus haut, dans le logement d’un couple bien moins conventionnel : un vieux crouton poursuit à travers la pièce une jeune femme ayant l’âge d’être sa petite-fille, pour ensuite l’assassiner, la dénuder et la disséquer. Sur la table d’opération de fortune, le frêle cadavre de la jeune fille laisse entrevoir sa jolie chair, tandis que le docteur, lui-même dénudé, donne à voir un corps nettement moins gracieux (et sur le point de mourir lui aussi, puisqu’il se suicide quelques minutes après). Et malgré tout le sang qui peut gicler, le décor reste aussi blanc, aussi clinique qu’un laboratoire : il est net propre, immaculé. Le malaise peut s’installer durablement.
Car à la manière d’un Hitchcock, Cronenberg nous présente ici un décor de carte postale, un cliché de perfection, pour mieux le souiller. Il introduit là-dedans quelques taches dégueulasses qui s’étendront sur l’endroit comme sur un buvard. Car la jeune fille, voyez-vous, était le patient zéro d’une infection que le docteur avait lui-même créé (et qui, comme toute bonne créature du mal, lui avait échappé), et qu’avant de mourir, elle avait eu le temps d’aller disperser quelques fluides (et quelques vilaines bêtes) chez d’autres habitants de la résidence. Le carnage peut commencer.
Mais on le comprend, au fond, ce docteur : à force d’être parfait, cet immeuble est sans aspérités. Ses couloirs sont sans âme. Ses jardins sont artificiels. Ses habitants s’y croisent, mais ne s’y rencontrent pas. Ils ont des interactions policées, gentillettes, et terriblement fausses. Les plus chanceux s’offrent une baise de temps à autre. Les autres (parmi lesquels on trouve de nombreux petits couples tartes) s’emmerdent et ne se comprennent pas. Pour l’un d’eux, celui chez qui le foyer d’infection se fera le plus virulent, c’est le schéma classique où madame fait des scènes inutiles et où monsieur esquive plutôt que de dire clairement ce qu’il veut. Tout est trop net, trop propre, trop immaculé. Il fallait bien une grosse tache rouge là-dedans. Il fallait bien que monsieur ose enfin dire que ce qu’il veut, c’est juste niquer, encore et encore. Et il fallait bien que madame prenne conscience que son mari l’intéresse moins que la jolie voisine du dessus, qui lui faisait vainement du pied jusqu’ici. Avec ces bestiaux lâchés dans l’immeuble, plus de frontière : chacun exprime ses envies et il n’y aura aucun jaloux. La concierge replète, le groom maniéré, la petite fille innocente, tout le monde y passera. Plus aucun critère ne joue. On renoue avec sa part bestiale de la plus belle des manières, dans cet immeuble bien trop civilisé.
Mais dans tout ça, on n’a pas encore parlé du héros. Ah, le héros…un mec comme elles en rêvent toutes. Épaules carrées, belle coupe de surfeur, intelligent, fort, averti, médecin de profession, il émoustille son assistante au point qu’elle se change devant lui. Mais il a un défaut : il est trop asexué. Il semblerait que l’atmosphère clinique de l’immeuble et de son travail ait aspiré toute once de sensualité en lui, au point qu’il reste froid devant des corps nus. Qu’à cela ne tienne, ils vont bientôt être suffisamment nombreux pour le dévergonder. Et voilà comment ce brave docteur en vient à nager dans une mare de liquides infectieux, seule personne sensée parmi ce troupeau de bêtes de sexe.
Parce qu’il est encore assez lucide pour voir que les parasites libérés par son confrère (et ancien mentor) ne sont pas forcément une solution : ils ont aussi leurs inconvénients. Les autres résidents se laissent aveugler ; aveugler par leur recherche de bonheur. Dans un cas comme dans l’autre, c’est toujours ça qu’on leur promet : d’un côté le bonheur parfait au travers d’une résidence qui comblera tous leurs besoins, de l’autre une frénésie sexuelle qui les débarrassera de tous leurs ennuis. Et ils croient que ça va les combler. Oubliant très vite que dans leur habitat asexué, on s’emmerde pas mal, et que des parasites hypersexués, c’est quand même très douloureux à porter. Et que dans les deux cas, ils sont aliénés. Comme quoi, qu’il soit civilisé ou animal, l’Homme reste l’Homme, enchaîné à son illusion du bonheur absolu sans se rendre compte des états effrayants dans lesquels il s’enferre. Et il passe comme ça, d’état en état, convaincu que chaque nouvelle condition est meilleure que la précédente. Immaculé ou pas, l’Homme reste toujours aussi débile, aussi tarte.
Mais bon, je pense qu’avec tout ça, on a fait le tour de ce huis-clos dégueulasse. Il faut que je vous laisse : je dois baiser ce soir. Et je sens que ça va être bien, BIEN SALE.