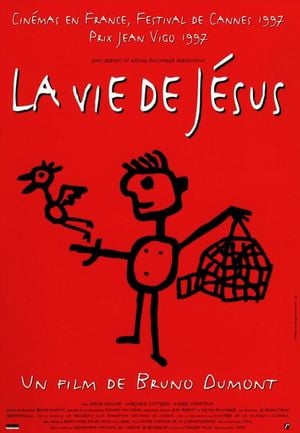Dans ce premier long-métrage, Bruno Dumont plonge le spectateur dans la morosité ambiante de Bailleul. Même si le cinéaste s'attache certainement en partie à placer son histoire dans cette géographie très précise du fait que ce soit sa ville natale, il y a en outre l'idée de mettre en scène des perdants de la société dans une atmosphère non seulement économiquement (à cause de la désindustrialisation !), mais aussi spirituellement morte. Et ce n'est pas une fanfare minable ou le bar de la mère du personnage principal, donnant l'impression d'avoir un seul client (Pourquoi il commande un verre de vin blanc pour partir immédiatement sans le boire ? C'est complètement bête de filmer ça !) qui viennent à améliorer cette image.
Bref, par le biais des réprouvés (joués par des amateurs du coin ; ce qui va devenir par la suite une des caractéristiques du réalisateur !), le Nord de Dumont ici est une terre aride où seuls l'ennui, la stupidité, la frustration et la violence peuvent y donner des fruits en abondance. Toute volonté d'ordre intellectuelle ou du moins réflexive, poussant à vouloir s'améliorer ou à aller regarder ailleurs, semble impossible.
Le protagoniste, Freddy, et sa bande forment une galerie de trognes bien cassos du cru affublées de toutes les tares physiques et émotionnelles, incapables de s'exprimer correctement par l'intermédiaire de leurs actes et de leurs paroles. Leurs instincts, les plus souvent bas, les guident, comme le mettent en relief une scène de sexe crue sur l'herbe, une séquence d'agression sexuelle, un racisme primaire et bien sûr une jalousie trouvant son aboutissement dans un meurtre.
Il y a bien quelques éphémères touches de lumière, notamment lorsque Freddy et ses potes vont à l'hôpital, rendre visite au frère d'un des leurs, le corps agonisant gangrené par le Sida, montrant une affection naturelle pour ses proches. Ou lorsque la petite amie s'ouvre à l'Arabe quand celui-ci fait preuve d'une attitude respectueuse envers elle. Mais elles sont rares. Et pour le cas particulier des zonards, elles laissent très rapidement la place à l'obscurité.
Il est difficile en conséquence de ressentir autre chose que du mépris à l'égard du personnage principal (du moins, c'est mon sentiment bien subjectif !) face à l'abjection dont il est fait preuve du début jusqu'à la fin. C'est pour cette raison que j'ai du mal avec le titre (un du genre "La Vie de Satan" ou "Sous la grisaille de Satan" aurait été plus en phase par rapport au contenu !) ainsi qu'avec la fin, car pour moi, il n'y a rien de christique en lui (le véritable Jésus serait plutôt la victime !) et toute pensée de rédemption est naïve ; il se révèle trop sauvage, trop chef de meute, trop enfermé mentalement dans cette façon d'exister, pour que le fait qu'il puisse subitement avoir ne serait-ce qu'un remord paraisse crédible.
Par contre, j'ai apprécié le symbolisme subtil de la vitesse ou du télésiège, signifiant un bien-être ne réussissant à s'épanouir un tant soit peu hors du statisme pesant d'un sol phagocytant par sa dangereuse monotonie.
Autrement, le talent formaliste du cinéaste n'a pas attendu pour faire son apparition par les intermédiaires d'un incontestable sens du cadre, plaçant impeccablement ses caractères au sein d'un environnement bien défini, et d'une photographie accentuant les teintes flamandes.
Si j'avais vu le film l'année de sa sortie en salles, j'ose espérer que j'aurais écrit que c'est l'expression d'un style bien personnel ne demandant qu'à continuer de se manifester tellement il est trop unique pour se permettre de ne pas réapparaître dans d'autres œuvres.