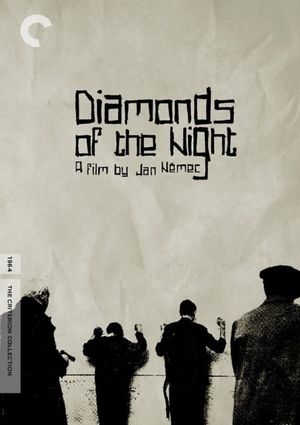C'est le simple récit d'une évasion vouée à l'échec. Deux jeunes Juifs sautent d'un train et marchent dans la forêt, boivent l'eau des rivières, demandent à une fermière de leur donner du pain, et sont dénoncés puis pris en chasse par de vieux ivrognes allemands. Le tout premier travelling, avec la caméra embarquée dans la course, est d'une grande délicatesse. On voit les mains de l'un s'agripper aux vêtements de l'autre, pour lui donner la force de continuer. La nuit tombe peu à peu, les mains s'élèvent pour se protéger des branches, on pense à Bresson. On suit les personnages de biais, parfois de dos comme chez Alan Clarke ou les Dardenne, et soudain on les voit en gros plan dans la nuit, il n'y a pas de règle définitive. Ils ne parlent presque pas, sinon pour dire "rapproche-toi de moi". Rien n'est appuyé, tout est là.
Peu à peu d'autres scènes traversent le film, d'abord difficilement identifiables. S'agit-il de souvenirs ou d'hallucinations ? Le récit est mis à mal par leurs apparitions, souvent inexpliquées. Certaines reviennent, s'épaississent, deviennent plus cohérentes mais jamais vraiment identifiables. Ce qu'on prenait pour un souvenir se teinte de fantasme (la traversée du tramway détruit, avec les passagers tout au bout). Lors de la scène avec la fermière, celle-ci se fait assommer quatre ou cinq fois par le jeune homme qui lui réclame du pain, mais il n'en est rien, on comprend simplement qu'il projette de la frapper au cas où elle se serve de son couteau contre lui. De même, revient fréquemment cette scène où les deux garçons trouvent une rivière, de nuit, où enfin s'abreuver ; alors qu'ils sont déjà beaucoup plus loin, déjà sauvés du train qui les conduisait vers le camp, déjà perdus... Comme si cette grâce que la nature leur avait faite ne cessait de leur apparaître (cette tendresse, cette clémence du paysage, les accompagnant jusqu'au bout de leur course, à défaut de celle des humains). Et puis il y a l'image d'une porte fermée qui fait irruption plusieurs fois, sans doute un souvenir pesant sur toute une vie, jouant sa note sèche tout le long de l'existence (de la même façon que les cloches n'arrêtent pas de sonner pendant le film, en sourdine, mais présentes). Cette porte finit par bouleverser, alors même qu'on ne sait pas ce qui devait se trouver derrière.
Jan Nemec, par la sophistication de son montage, montre comment le temps vécu est fait d'espoirs, de craintes, de ressassements obsédants, de vertiges et de projections fulgurantes. Comment la réalité elle-même est toujours remise en jeu (ou en question) par ce temps vécu. Il parvient à abolir toute distinction entre objectif et subjectif ; l'un et l'autre se mêlent absolument. Le montage contribue fortement à cette impression, mais c'est aussi l'épure de la mise en scène qui permet à chaque scène de devenir cristalline, et de produire comme un son, qu'on perçoit et reconnaît à chaque fois qu'on le retrouve, alors même qu'il signifie très peu, et qui nous surprend toujours parce que l'affect dont il est chargé n'est plus du tout le même. C'est la même image, mais plus la même émotion : on ne se baigne jamais dans le même souvenir.