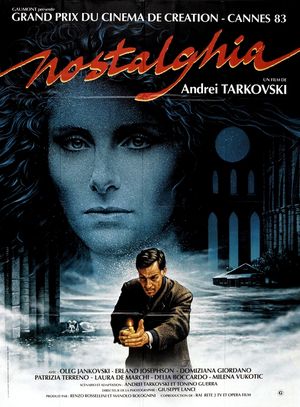« Nostalghia » est un film méditatif, un long poème culminant sur les rives tergiversantes de l'âme, un paysage de l'âme pourrait on dire, au sens dont le perçoit David Caspar Friedrich. Réalisé alors que le réalisateur russe se retrouve exilé, banni de ses terres russes natales, il trouve dans le personnage principal Andrei, un alter ego parfaitement tragique. L'histoire est donc celle de ce poète russe qui recherche les traces d'un compositeur qui a séjourné en Italie au 18ème siècle. Pour parfaire ses travaux, il est accompagnée par une traductrice, Eugenia, d'une beauté botticellienne sans précédent. Voilà ce qui est le point d'orgue du film. L'histoire a certes son importance, mais elle reste toutefois en suspend, tant la volonté de l'artiste, de ce mystique qu'est Tarkovski, est hautement plus ambitieuse, périlleuse même. Car le fracas s'avère immense : l'Homme a perdu son goût de vivre, et par VIVRE, nous entendons aussi bien entendu cette dévotion pour l'art. Dans cette œuvre crépusculaire, mettant en évidence les ruines et les vestiges de l'Italie, le réalisateur nous offre sa vision incertaine du monde dans lequel il vit, a t-il encore confiance en son art ?
L'instabilité, le caractère insaisissable de la matière et des choses, c'est bel et bien ce qui transparaît dans cette mise en scène particulièrement lugubre. Il se fait alors adepte d'un cinéma poétique, où ressortent différentes allégories, symboles qui peuvent contrarier la lecture du film pour certains, mais qui pour d'autres bien au contraire reste un parfait exemple de pureté cinématographique. En effet, Tarkovski ne prétend pas « décrire » simplement son espace, mais bien le découvrir, tel un voyageur; à la recherche de l’inexplicable, en quête d'une vérité absolue, qui se trouve hors de notre conscience rationnelle. Avec lui, la représentation de l'image acquiert un statut quasiment religieux, sacré, en cela il peut être rapproché avec des cinéastes tels que Dreyer ou encore Paradjanov.
Ce langage poétique justement contamine tout le cadre, semble omnipotent. C'est l'intervention de l'au-delà qui semble jaillir de l'image, que ce soit le brouillard, les oiseaux dans l'église au début, l'eau qui coule également dans la maison de Domenico, ou bien une plume scintillante se posant sur la tête d'Andrei. Toutes ces images peuvent être interprétés de différentes manières, mais seul le ressentiment importe, les choses sont parfois inexplicable, et dans le cinéma de Tarkovski nous le comprenons bien, comme le dit le protagoniste lui même : « La poésie est impossible à traduire : comme l'art ». C'est donc aussi une manière pour le cinéaste de nous interroger sur la notion d'art en tant que « sublime »; il suit alors, peut être involontairement les conceptions esthétiques de Burke sur ce propos, car comme le souligne l’essayiste irlandais, c'est le croisement entre l'effroyable et le beau qui forme cette notion. Contemplation de cette étendu qui est présente dans « Nostalghia », pour Tarkovski, il faut transcender la réalité, et par delà même le paysage. On conçoit alors très rapidement cette différence d'échelle qu'il peut y avoir entre notre humanité et le monde immense, le personnage d'Andrei prend conscience qu'il peut mourir, de sa petitesse, « Le beau n'est que le commencement du terrible » disait Rilke.
Cette caméra mouvante, ces lents plans-séquences nous invitent à occulter cette instabilité, cette fuite du présent, qui semble glisser, se noyer. Dans le film, seul les images nous montrant le passé d'Andrei semble avoir du poids. Le présent, lui, ne semble pas exister. Pour Tarkovski, « le temps révèle l'essence des choses », ainsi le protagoniste ne semble exister qu'à travers sa mémoire, ses pensées pour sa famille. La question du songe, semble hanté également tout l’œuvre, en cela, on comprend l'influence d'un peintre tel que Piero Della Francesca, les corps dessinés par le peintre semblent similaire à ceux exprimés à travers l'écran par le réalisateur russe, ces corps sont aussi bien terrestres, qu'animé par l'idée du lointain, du divin; c'est donc la puissance de ce peintre silencieux, faire exister ces personnages dans un songe permanent. C'est ce que s'adonne à faire Tarkoski lorsqu’il filme son protagoniste longuement, s'endormant sur son lit, nous avons ce même bouleversement, faire coexister Andrei avec un « ailleurs ». C'est un cinéma de la réminiscence.
« E questa la fine del mundo ? », s'écrira un enfant. Car oui, l'humanité a perdu la foi, atteinte par cette fameuse « maladie mortelle », elle doit donc racheter son salut, se repentir. Le seul qui semble encore avoir cet appétit de l'invisible, c'est le prétendument fou Domenico, et certainement le seul qui semble au plus près de la vérité du monde. Alter égo du cinéaste au même titre qu' Andrei ? Certainement....il nous offre la révélation d'un monde, celle d'une réalité profonde, ainsi, il sculpte le temps, choisissant des moments purs de cinéma. C'est ce que nous dit Tarkovski, et nous le voyons avec la dernière séquence lorsque le personnage se retrouve dans l'eau tenant une bougie, c'est que l'homme doit se racheter par delà la transcendance, et sa spiritualité. Nous devons ainsi réapprendre à vivre de nos perceptions immédiates, car dans notre société actuelle, nous avons oublié d'être des « être spirituels ».