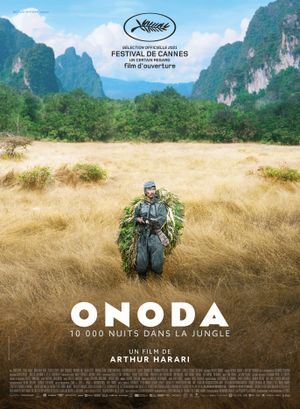Vers la fin d'Onoda, une séquence vaguement réminiscence du cinéma d'Ozu montre les principaux lieux du drame vidés de toute présence humaine. Si c'est peut-être l'un des plus beaux moments du film, il met cependant en avant l'un de ses choix les plus discutables : l'espace, que l'on soit en 1944 ou en 1973 est presque toujours filmé de la même manière. Qu'il soit habité ou non, il ne semble retenir (à quelques exceptions près) ni la folie de la guerre, ni la solitude hantée par le souvenir des morts. Il n'y a sans doute qu'à la fin, où le protagoniste revient faire hommage à ses compagnons morts, à l'image du nœud défait par les années, qu'on pourrait voir le potentiel d'une guerre dont les traces s'effacent avec le temps. On regrettera le fait que son poids émotionnel soit quelque-peu tronqué par les raisons que l'on vient de décrire, ainsi qu'une conclusion qui tire en longueur.
Reste cependant l'idée d'un chant qui reste le même, bien que les paroles soient pour chacun différentes. Ce même chant, qui hante l’œuvre, et qui est sans doute la clef pour appréhender sa poétique, semble représenter le lien entre l'individu et le groupe, entre l'homme et une certaine unité cosmique, un monde indépendant du monde qui serait l'île de Lubang.