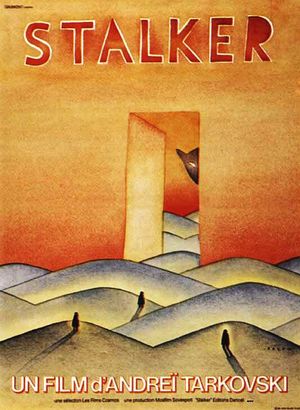Il existait un territoire proscrit et convoité, dangereux et mystérieux que l’on nommait la Zone. Créée jadis par la chute d’un météorite, imputable à une civilisation extraterrestre, un désastre nucléaire ou une imprudence humaine, nul ne sait. On y avait dépêché des commissions d’enquête, mobilisé des armées d’intervention, envoyé une division blindée qui n’était jamais revenue. Des gens avaient disparu, des phénomènes inexplicables s’étaient produit, des bruits avaient couru. On parlait même d’une chambre secrète à l’épicentre de ce coin de campagne bouleversé, qui exaucerait les vœux les plus intimes. Du coup, on l’a entourée de barbelés, de grillages et de miradors, on en a interdit l’accès. Des curieux, des aventuriers, des désespérés tentaient parfois d’y pénétrer, sous la conduite d’un guide. Il s’était ainsi constitué une race de parias, de sous-hommes dont la descendance était maudite. Ces passeurs s’appelaient des stalkers. Autour de la Zone, un paysage ferroviaire, des terrains vagues désolés, des baraquements de brique noircie, parcourus de tunnels dédaléens où croupissent des eaux mortes, où des coups de projecteurs jettent une lueur blême sur des tranchées suintantes : une gigantesque prison à ciel ouvert, évoquant le cerveau noir de Piranèse. Viennent à l’esprit ces figures minuscules et écrasées qui gravissent des escaliers en surplomb sur le vide, contournent des colonnes ruisselantes et se lancent sur les fragiles passerelles que la frénésie de l'aquafortiste jette, sans leur assigner de but, entre les blocs cyclopéens. Le jeu des perspectives noyées d’ombres et échafaudées sur des cloaques, l’autorité obsédante des murailles aveugles composent un théâtre intérieur dont l’épouvante émane du cauchemar davantage que de la réalité, si menaçante soit-elle. Se détachant à peine de l’univers hagard et tortueux où l’image sépia s’acharne à les engluer, les trois personnages de Stalker ne sont d’abord que les antennes humaines de l’angoisse ambiante. Leur traversée du miroir est gravée avec cette précision hébétée que procurent les hallucinogènes, où le "moi" abdique son despotisme pour n'être plus qu’un récepteur, la plaque de cuivre vierge où s'inscrivent les visions, corrodées par quelque acide inconnu. Parcourant des entrepôts désaffectés, empruntant des canalisations asséchées, à pied, en jeep puis dans une des draisines qui desservent les galeries minières, ils parviennent à déjouer la surveillance des vopos armés, postés autour de la Zone, et à s’y infiltrer. La frontière passée, c’est un trip charbonneux qui s’achève. Le film devient en couleurs, le vrai périple commence.
https://www.zupimages.net/up/20/02/2xjf.jpg
On ne connaîtra pas les noms de ces trois voyageurs, seulement les sobriquets qu'ils se donnent entre eux. Il y a les clients : l'Écrivain, apparemment poussé à cette extrémité par l’accablement, le manque d'inspiration, et le Professeur, qui semble mû par la curiosité scientifique. Cultivant très vite un rapport d’antagonisme, ils se chargent d'incarner deux manières d'être au monde, de concevoir l’existence, qui s'expriment non par des plaidoiries alternées (chacun défendant les valeurs qu'il croit représenter) mais par de fielleuses invectives réciproques. L'Écrivain raille les thermomètres, baromètres, "merdomètres" du Professeur, sa manie de l'analyse dont, pourtant, l'intéressé ne donne aucune preuve. En récompense, le Professeur n'a pas de mots assez méprisants pour les billevesées de la pauvre imagination qu'il prête à l'Écrivain, sans que celui-ci ne manifeste davantage ce tour d'esprit. Aucune de leurs attitudes opposées ne trouve d'application concrète, comme si la Zone en rendait l'usage caduc. Ce sont des prétextes d’acrimonie, de pures constructions intellectuelles, privées d'un support observable dans les comportements et même dans les propos de chacun lorsqu'il se risque à parler pour lui-même et non contre l'autre. Leur conflit larvé éclate à la faveur de pauses où ils se jettent à la figure l'image qu’ils se font de leur adversaire, par laquelle ils se définissent négativement. Pétri de sarcasme, de hargne et de détresse, qu'il exhale en insistant férocement sur leur dérision, avec son maintien voûté, sa manière de rencogner son visage usé par le mépris dans ses maigres épaules et son pardessus de clochard, l'Écrivain fait penser à Louis-Ferdinand Céline, incarnation logorrhéique de cet homme du souterrain dont Dostoïevski a pris en charge l'amertume. Et puis il y a le Stalker qui, pour en être familier, sait bien la vanité de ces joutes dans la Zone. Il est à la fois le pédagogue, l’officiant, l’intronisateur. Son crâne rasé et ses yeux délavés l’apparentent au rescapé d’un goulag, au Juif revenu d’un camp ou au nouveau prophète d’un monde en lambeaux. Il est celui en qui jaillit la part de Dieu hors d’un corps-dépouille se mouvant en corps christique, et qui surgit tel un avatar du prince Mychkine ou d'Aliocha Karamazov.
Les lois du no man's land dans lequel ils s’enfoncent se résument aisément : il n'y en a pas. Tout peut arriver, tous les pièges et embûches sont possibles à défaut d'être imaginables. La Zone réagira de manière imprévisible à ce que feront les hommes. Cet animisme n’est pas systématique. Certes on ne doit pas offenser l'entité, mais elle pourra opposer un démenti foudroyant à qui la respecte et la vénère, et à l’inverse négliger de châtier celui qui n'observe pas le protocole empirique et déférent imposé par l’éclaireur. On progresse à tâtons, comme sur un jeu de l'oie aux principes inconnus dont chaque case promet un abîme, et la dernière le bonheur. Faïence, papier imprimé qui se délite, bois détrempé paraissent en décoction dans une eau tantôt stagnante et boueuse, tantôt courante et limpide. Des tanks recouverts de mousse, des poteaux télégraphiques déracinés, des objets usuels sont pris dans un lent processus de décomposition, oxydés, réabsorbés par l’humus, le lichen ou la tourbe d’une terre en mixtion. Tarkovski organise un emboîtement complexe : une région révérée (la Zone) dissimule un temple (la Maison) qui abrite un tabernacle (la Chambre), but ultime de l’expédition. Cet enfouissement oriente la quête vers les profondeurs. Une fois entrés dans la Maison (sans qu’aucune solution de continuité ne signale le passage du dehors au dedans), les voyageurs sont livrés aux caprices d'une topographie insensée, non euclidienne. Les contours de l’architecture spatiale, immatérielle et intemporelle où ils évoluent semblent reconfigurés par leur procession dans le sanctuaire. Le parcours s’apparente à une plongée dans les entrailles de la terre, un cheminement ardu au sein de ténèbres chtoniennes, une lente immersion dans l'inconscient du monde, dépourvue de point de repère. Cette féérie en décor naturel demande une attention forte, comme un jeu d’enfant. C’est un espace d’abandon requérant un regard exorbité, un univers fantastique parent de Gracq, du Jünger d’Heliopolis et de Jules Verne. Des escaliers, des coursives, des boyaux sinueux, des caves, des grottes, des salles immenses et ensablées, des vestibules dont les fenêtres reçoivent la clarté du jour alors qu'on les croyait souterrains : ces lieux hétérogènes obéissent aux règles changeantes d'un univers sans logique discernable, où l’on se borne à aller. Et la fascination délivrée alors par le film doit tout à l’éblouissante inspiration visuelle que Tarkovski met au service d’une telle aberration géodésique.
https://www.zupimages.net/up/20/02/okz0.jpg
Lorsque les pèlerins atteignent l’antichambre, le récit adopte un principe d’attente évoquant un théâtre de l’absurde déplacé en circonstance. Le Professeur veut tout faire sauter au moyen d'une bombe : la fréquentation du "Diamat" ne peut qu'inciter à cette mesure radicale contre un foyer d'obscurantisme que l’on soupçonne plus ou moins christianisant. Alors le Stalker explose. Il ne sait pas argumenter comme ses compagnons mais il se livre à un long et superbe monologue. Il gémit, sanglote, menace, frappe, supplie, plaide pour la Zone et la Chambre, qui sont tout ce qu’il a au monde, le seul espoir des malheureux auxquels il peut venir en aide en les y conduisant. La confrontation entre l'Écrivain et le Professeur cède à une autre, combien plus cruciale : l'innocent contre les docteurs, le dénuement contre l'intrigue et l'argutie, la spiritualité contre l'analyse. Et l'on voit bien la position de Tarkovski, le croyant, le slavophile, l'homme des racines, de la terre et du limon. La Zone est la dernière enclave de la Foi, l’ultime chance de l'Amour, le refuge de la Transcendance. Les visiteurs se laissent fléchir par le désarroi de l'innocent et renoncent in extremis à franchir le seuil de la Chambre, sans que cet abandon soit montré comme une faiblesse : ne pas agir est parfois la forme suprême de l’action. Aucun des protagonistes n’est condamné ou sanctifié : le Professeur n’a que des motifs nobles de vouloir atomiser la Zone ; l’Écrivain, alcoolique, montre de l’honnêteté et de la lucidité. Quel besoin ce dernier a-t-il, lui qui ne croit en rien, pas même en lui, de tenter les épreuves imposées ? Dans le long couloir baptisé le Hachoir, il titube, s’arrête, philosophe, hurle, tombe mais repart, mû par une force inexplicable. La caméra l’accompagne dans sa progression chaotique qui est celle de l’humanité. Elle parcourt ailleurs des lieux glauques et délabrés, comme elle le ferait pour la frise précieuse d'un fronton, les bas-reliefs ou les mosaïques d'un mausolée. Elle remonte soudain vers l'éther, filmant la matérialité de l'air ; elle décrit microscopiquement en rasant à fleur d'eau les dessins que forment les déchets immergés, à la manière d'un Painlevé filmant scientifiquement la faune et la flore. Elle explore strates, protubérances et traces d'une décharge géologique où tous les souvenirs, toutes les images ont chû. Elle découvre des êtres endormis et les berce en de splendides travellings latéraux, tous ces mouvements s'accordant sur des variations multiples de la gamme chromatique, passant du noir et blanc aux teintes les plus transparentes, comme un peintre au travail délayant la texture des couleurs sur sa palette.
L’œuvre de Tarkovski est une série d'instantanés des lambeaux de vie qui flottent à la surface de son océan intérieur. Cet océan, il avait eu l’audace d’en offrir une vue d’ensemble dans Solaris, comme s'il disait : voilà la centrale où s'ourdissent, se composent et se décomposent mes rêves et les vôtres. La Zone se situe sur terre mais au cœur de son labyrinthe gît le même secret. Le poème ne connaît qu’un registre et d’infinies sources de connotations, d’amplifications, d’incitations. L’allégorie suppose deux registres et un code pour naviguer de l’un à l’autre, sans quoi la figure tiendra de la devinette ou du grimoire ésotérique. Le propre des symboles est leur aptitude à la prolifération : on tire sur le fil, tout le vêtement vient. Mais si les incertitudes bondissent en cascades, la conviction animant Tarkovski plus que tout est que l’art console et justifie. De cette prophétie témoigne la dernière séquence : épiphanie de formes, de teintes hésitantes, de rythmes, de silence — de grâce. Sortie d'une toile de Paolo Uccello, une fillette est apparue, un châle à coquilles d'or noué sur les cheveux. Elle est dotée du pouvoir de télékinésie. Au dernier plan, la pureté de son profil droit fait songer aux émaux, ivoires et enluminures de l’art sacré. Devant elle, une table et trois verres dont l’un contient des scories sales : une coquille d’œuf, un débris vert, peut-être une plume d’oiseau. Matière morte, vie périssable, dégradation. Le plus beau verre glisse doucement pour s’arrêter au bord de la table. Prodige, splendeur de l’univers charnel. Pris dans la même magie, les deux autres se déplacent puis s’immobilisent. Alors le premier verre avance et cette fois tombe et se brise. La terre tremble, s’entend off le bruit d’un train. La fillette, comme auréolée des flocons mystiques de l’été, colle sa joue sur la table. Lent travelling avant, fermeture en fondu. L’enfant est infirme, l’innocence est crucifiée, mais l’Esprit veille en elle et autour d’elle. Le monde est beau mais sa beauté est toujours à défendre ; chaque jour dispense un perpétuel miracle mais l’Histoire broie ses victimes et ne distingue pas parmi les justes. Le mal, la laideur et la mort perdurent mais le sublime, l’espérance, le désir du bien demeurent également. À l’instar d’Andrei Roublev, Stalker s’achève sur un extraordinaire morceau de peinture cinématographique, "sculptée dans du temps". Mais c’est désormais seul que Tarkovski signe sa propre Trinité des Anges, et qu’il transmet à travers elle l’évidence de l’inconnaissable.
https://www.zupimages.net/up/20/02/ndn6.jpg