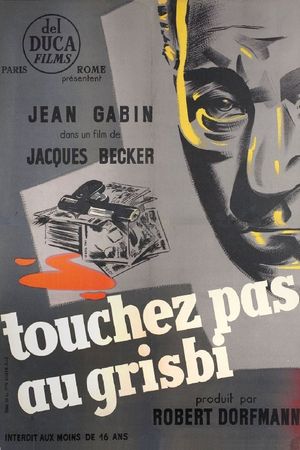Touchez pas au grisbi commence presque comme un documentaire. Une immersion dans le milieu des gangsters parisiens. Mais pas vraiment pour connaître leurs méthodes ou leurs codes. Plutôt pour découvrir ce qui se se cache derrière ces hommes pour qui l’honneur semble encore vouloir dire quelque chose. D’ailleurs, Jacques Becker ne cherche pas à multiplier les effets tonitruants classiques du polar : il préfère s’attarder sur le quotidien somme toute banal de ces truands. Notamment dans une séquence ahurissante où Max (Jean Gabin) et son comparse Riton (René Dary), après avoir échappé de peu à un traquenard qui aurait pu leur être fatal, se brossent les « crochets » avant d’aller au «paddock». Et puis, le film lumineux et clinquant du début, perd peu à peu de son éclat pour basculer soudainement dans le film noir. Les salons élégants, les appartements ultra-éclairés cèdent la place à des sous-sols, à une cave et à une petite route de campagne où se joue la scène clé du polar.
Paradoxalement, Touchez pas au grisbi tout en posant les jalons d’un cinéma de gangsters qui servira de référence pendant des décennies (le thème principal semble débuter sur les mêmes notes que celui du Parrain), annonce à travers le personnage de Max désireux de prendre enfin sa retraite, la fin d’un cinéma de papa que balaiera bientôt la Nouvelle Vague.
A l’image d’un casting où un Jean Gabin majeur tend le flambeau à des débutants portant les noms de Lino Ventura ou de Jeanne Moreau... Touchez pas au grisbi, coincé en 1954, offre ainsi sans le savoir un savant cocktail où les saveurs rassurantes et parfois surannées du cinéma des années 40 se mêlent à celles plus audacieuses du cinéma à venir des années 60.