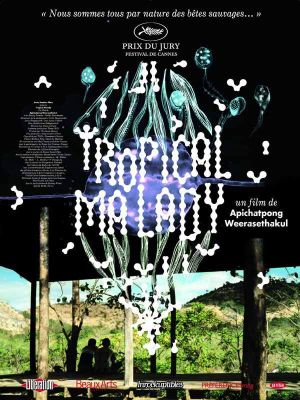Le grand mystère de ce grand film, c'est : où est la violence ? Y a-t-il, même, violence ? Et pourtant : un cadavre à la limite du hors champ manipulé avec insouciance par une bande de militaires gaillards ; un militaire, justement, certes démobilisé et cherchant du travail, mais tout de même ; un tigre, majestueux, qui parle de dévorer l'âme de son poursuivant ; une lutte étrange avec un "fantôme" nu ; et puis cette photo mystérieuse apparue juste à la fin de la première partie, où l'on voit soudain un tiers terme, un tiers personnage, avant que l'image ne disparaisse un peu trop vite... Dans la deuxième partie, on retrouve cette triade dont le troisième terme est incertain, vague, peut-être même, finalement, inexistant : on a le militaire, le tigre, et le fantôme. Se pourrait-il que Tropical Malady soit l'histoire d'une jalousie qui devient maladive et vire à la folie ? Mais tout est si vague, flottant, aérien... Il y a vraiment une grammaire d'un type nouveau : on ne se situe pas dans une esthétique du retour du refoulé, comme chez David Lynch ; ni dans une esthétique de l'émotion distillée sur le long terme, cristallisée dans la chorégraphie des corps, comme chez Tsaï Ming-Liang ; et encore moins dans une esthétique de la symbolisation, où le tigre, le singe, ou la forêt, serait des projections d'instincts intérieurs (Tropical Malady n’est surtout pas une allégorie, rien moins qu’une allégorie). Où est le sous-jacent ? Y a-t-il un sous-jacent ? La mise en scène est allusive, effleurante ; on passe sur les visages et les événements sans que rien n'ait pu véritablement s'ancrer ; que capte-t-elle, qu'enregistre-t-elle ? En quoi consiste cet invisible qui donne toute son étrange force aux morceaux parcellaires qui se succèdent les uns à la suite des autres ?
Et donc encore une fois : où est la violence ? Il nous a fallu pénétrer au coeur de la forêt et s'y enfoncer toujours plus profondément pour enfin rencontrer le tigre : incarnation même de la violence la plus sauvage et la plus débridée. Et la voix-off d'effacer soudainement les délimitations de la personnalité : Keng s'efface dans le tigre, le tigre s'efface dans Keng. Qu'ont-ils trouvé, l'un et l'autre, là, au fin fond de la forêt ? Le singe nous a avertis que le tigre suivait Keng depuis le début. C'était donc le récit d'une aperception à soi-même ? de ce geste paradoxal qui consiste à s'éloigner le plus loin possible de soi-même pour enfin se retrouver soi-même ? Le tigre, bien que présent tout du long, ne se donne à voir tel quel que dans l'infinie et absolue solitude ? Et quelle forme avait-il, ou plutôt, qui étions-nous, alors, lorsque le tigre nous accompagnait sans que nous ne le sachions ? Qui était Keng lorsqu'il vivait paisiblement sa romance avec Tong ?
Si ce film est si beau, est si grand, c'est que, par son esthétique de l'effleurement, de l'esquisse, sa manière de dessiner un ensemble de scènes simplement par petites touches, puis de tresser un véritable périple sonore qui nous transpose littéralement dans un autre monde, la violence demeure à l'état de simple possibilité, simple hypothèse ; elle n'est même pas sous-jacente ou invisible, insidieusement distillée ou refoulée ; elle peut, simplement, être là, ou ne pas l'être. La sauvagerie semble toujours-déjà absorbée par l'infinie paisibilité de la nature, elle n'a pas à être mise en spectacle, ou plutôt, elle ne peut qu'être mise en spectacle sous la forme de sa pleine quiétude. Peu importe, alors, de savoir si la seconde partie est une relecture de la première : il n'y a pas plus de violence dans l'une que dans l'autre ; la première partie n'est pas le versant clair et lumineux dont la seconde serait l'envers sombre et tourmenté. Disons plutôt qu'il y a reprise, remise en jeu, dans une même continuité : Keng tombe sur une photo, et alors une possibilité, une hypothèse, est expulsée dans un ailleurs ; il faut plonger dans cet ailleurs ; et la chasse au tigre commence...