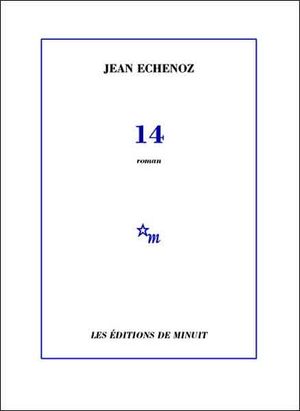De 14, on regrette qu'Echenoz n'ait pas attendu deux ans de plus avant de le publier.
Sobrement intitulé 14, ce petit - pas vraiment besoin de le préciser - livre de Jean Echenoz revient sur la (non) trajectoire de cinq personnages à l'importance variable, mais tous à-peu-près égaux d'insignifiance : Anthime, Charles, Padioleau, Bossis et Arcenel. D'eux cinq on ne sait rien, si ce n'est un métier ou une relation - Anthime et Charles sont frères, comme le souligne innocemment l'auteur au bout de quelques chapitres, comme ça, l'air de rien.
À vélo, le premier jour d'août, Anthime entend - ou plutôt voit le tocsin se mettre en branle : c'est l'heure de la mobilisation. Personne n'est surpris dans son petit village de Vendée, de toute façon tout ça sera fini en quelques semaines. Alors les premiers hommes partent avec un sac pesant pas moins de trente-cinq kilos - le double lorsqu'il se met à pleuvoir, ils boivent - enfin pas au début, puis un jour se mettent à se tirer dessus. Ils ne pensent pas - chez Echenoz personne ne pense, mais tout le monde est là - à la mort, ni à la vie d'ailleurs. La vie, elle, se trouve au détour d'une phrase, dans ces incises qui finissent par devenir le coeur du texte. Charles fuit le front pour l'aviation, il est tué le premier et s'écrase dans un petit village, - "présentement occupé par l'agglomération de Jonchery-Sur-Vesle, joli village de la région de Champagne-Ardennes et dont les habitations s'appellent les Joncaviduliens". De 14 on retient ce "on" qui embrasse tout et rien, qui ne fait que capter les choses et les faits, qui n'interprète rien. Tout nous est ramené à la gueule, et c'est peut-être mieux comme ça. De la guerre, les cinq personnes reviennent - ou non d'ailleurs, cela n'importe que peu - de façon différente : mort, blessé, aveugle, mutilé. Ils ne font rien à proprement parler, mais ils sont là, c'est peut-être ce que souligne le mieux Echenoz vers la fin de son roman : "Il s'est couché près d'elle et l'a prise dans son bras, puis il l'a pénétrée avant de l'inséminer". Et Echenoz se trouve peut-être là tout entier, dans cette petite phrase qui, l'air de rien, dit tout.
Plus que pour 1914, c'est pour ses petits glissements heureux dans les interstices du texte qu'on aime 14. Pour ce petit rythme echenozien, vite devenu caricature dans la bouche de certains, et qu'on ne peut pourtant pas caricaturer si facilement : une analyse plus précise de certains éléments suffirait. Ce qui importante dans ce roman, c'est le mot. Chaque phrase est à sa place et le mot - à l'image du soldat, est là, et ça suffit bien assez.
Les malheureuses comparaisons qu'on trouve ici et là avec Céline et son Voyage au bout de la nuit sont aussi consternantes qu'inappropriées. 14 est intimement différent, peut-être moins grand mais pas moins beau que l'étroit colosse célinien. Céline - Bardamu déverse sa faconde à peu près comme vomissent les soldats sur le front, toute la guerre se trouve dans son texte, dans son interprétation ; le tour de force d'Echenoz ici est de ne rien interpréter, de s'en tenir aux faits dans l'écriture : sont mis sur le même plan les détails les plus sordides de la guerre et de l'existence, la mort et la masturbation. 14 se lit dans ses interstices, dans ses notations les plus banales que le lecteur est libre de retenir ou non. Echenoz note un geste, un fait, et c'est là que se joue toute sa guerre, sa Grande Guerre à lui.