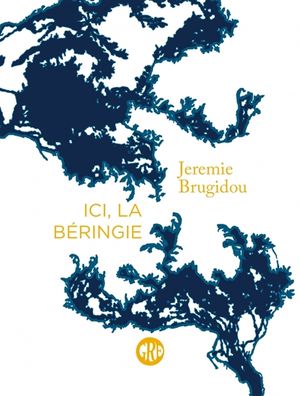Entre la pointe est de l’Alaska et la pointe ouest de la Sibérie, la Béringie sommeille. Aujourd’hui recouvert par les eaux, ce territoire offrait il y a 15000 ans des conditions climatiques idéales à ses habitants. Jérémie Brugidou nous y emmène, à trois époques différentes : à la fin du Pléistocène, lorsque nos ancêtres nomades peuplent ses étendues ; à l’aube de la Guerre Froide, lorsque le détroit de Béring devient un point stratégique crucial et que des scientifiques tentent pour la première fois de percer les secrets de la Béringie ; dans un futur proche où la fonte du permafrost a permis de retrouver et de reconstituer des espèces disparues dans un « Beringia Park ».
A travers les époques se dessinent les contours d’un territoire toujours parcouru par les énergies chamaniques déployées par ceux qui le peuplaient avant la montée des eaux. Ponctué de quelques très belles scènes oniriques qui confèrent aux rituels imaginaires des peuplades de la Béringie des allures de mythe fondateur de l’humanité, Ici la Béringie manque peut-être un peu de chair.
J’aurais aimé que le texte prenne plus d’ampleur, que ce soit dans sa façon de s’emparer de données scientifiques qui en l’état restent un brin obscures (notamment en ce qui concerne la palynologie, l’étude des pollens qui mobilise plusieurs personnages), ou en ce qui concerne ses personnages lancés dans des quêtes personnelles qui ont rarement réussi à m’engager émotionnellement. Peut-être souffre-t-il de la comparaison avec Doggerland d’Elisabeth Filhol, autre roman d’une terre engloutie, qui tenait parfaitement l’équilibre entre technicité et émotion, entre temps court du récit et temps long de la géologie. Ici la Béringie n’en reste pas moins un premier roman riche et singulier, presque trop humble finalement dans sa façon d’aborder une thématique qui engage des problématiques vertigineuses, des origines de l’humanité à sa fin annoncée.