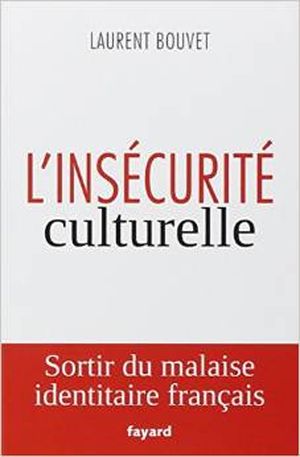Le hasard aura voulu que ce livre sorte une semaine avant les attentats de Charlie Hebdo ; une semaine avant qu'on nous somme d'être Charlie ou pas Charlie ; une semaine avant qu'on nous refasse le coup de la prise ultime de conscience et du monde qui ne sera plus jamais comme avant.
Depuis, Laurent Bouvet, professeur de sciences politiques et ancien militant socialiste, est devenu le chevalier autoproclamé de la laïcité, menant sa croisade héroïque sur les réseaux sociaux avec son fameux "Printemps républicain".
Et moi dans cette histoire, parce que je suis un fieffé socialiste laïcard, on m'a régulièrement fait comprendre qu'il fallait que je connaisse Laurent Bouvet ; que je m'intéresse à Laurent Bouvet ; que je lise du Laurent Bouvet.
C'est ainsi qu'on m'a offert cette "insécurité culturelle" et que je l'ai lue.
Eh bah je ne connais pas les autres travaux de Laurent Bouvet mais celui-là, en tout cas, c'est quand même une petite blague en soi.
Il s'agirait - nous dit la quatrième de couverture - de prendre conscience que les problèmes qui touchent aujourd'hui la société française ne sont pas seulement dûs à la crise économique mais qu'ils ont aussi - et surtout - comme origine une insécurité culturelle galopante, ce qui expliquerait par ailleurs la montée actuelle des "populismes".
Et ce serait donc pour nous faire prendre conscience de cette réalité là que Laurent Bouvet - professeur en sciences politiques - a commis cet ouvrage.
Eh bien soit : j'attends de voir la démonstration.
Confrontons nous à l'expertise scientifique portée dans cet essai...
Première constatation, l'ouvrage est très mince.
Moins de deux cents pages. Écrit en très gros caractère. Aucune biblio en fin de livre. Très peu de notes infrapaginales...
Visiblement Laurent Bouvet - tout universitaire qu'il est - a interprété le concept d'essai un peu trop littéralement.
Et encore, a-t-il vraiment pris la peine d'essayer ?
...J'entends par là essayer d'être un minimum rigoureux.
Premier constat, l'ami Bouvet a visiblement oublié les bases de toute démarche dialectique.
Le livre ne prend même pas la peine de définir son sujet en introduction, ni de réfléchir à comment le mesurer, le questionner, l'interpréter.
Au lieu de ça l'introduction se contente simplement de répéter en un peu plus de lignes la quatrième de couverture, c'est-à-dire que la seule crise économique ne peut suffire à expliquer le sentiment d'insécurité culturelle et la montée des populismes et blablabla...
L'auteur enchaîne alors sur un premier chapitre où il précise que malgré tout il est tout de même important de préciser que l'insécurité culturelle résulte d'un mélange "un peu confus" (pour reprendre les termes de l'auteur) de ressentiment à l'égard de la crise économique, de ressentiment à l'égard de la mondialisation et de ressentiment à l'égard des transformations des modes de vie.
Pour ma part, ce que j'ai surtout trouvé de confus là-dedans c'est qu'on semble nous définir ce concept d'insécurité culturelle qu'au travers de ressentiments.
De quoi parle-t-on dès lors ? D'une insécurité factuelle qui pourrait se mesurer pour peu qu'on prenne la peine de la définir convenablement ou bien parle-t-on de "sentiment" d'insécurité ?
Les rares sources évoquées n'aident pas à clarifier les choses puisque pour mesurer ce mélange confus qui formerait l'insécurité culturelle, l'auteur s'appuie sur trois enquêtes d'opinion chopées sur internet (Bouvet est sympa il a laisser les liens dans son livre pour qu'on puisse cliquer dessus.)
Voilà à quoi se résume l'intégralité du chapitre 1.
C'est tout de même assez mince.
Dans le chapitre 2 on commence enfin un début de travail de définition. Un travail qui s'étale d'ailleurs sur deux chapitres puisque le chapitre 2 est consacré à la définition de l'insécurité et le chapitre 3 au seul qualificatif "culturel"...
Or que nous dit-on dès l'entrée du chapitre 2 ?
...Que "le mot insécurité lui-même est mieux compris s'il est accompagné d'une adjectif. Sinon son sens se perd dans un flou générateur de malentendus et renvoie à une pure perception individuelle."
Soit. Mais dans ce cas pourquoi avoir fait un chapitre sur le seul concept d'insécurité qui est développé ad nauseam en l'associant avec plein d'autres adjectifs sauf celui qui nous intéresse ici, c'est-à-dire le qualificatif culturel ?
...Et pourquoi n'attendre que le chapitre 3 pour enfin traiter de front ce qui est tout de même le coeur du livre, c'est-à-dire l'association "insécurité culturelle" ?
On sent que le gars n'a vraiment pas grand-chose à raconter mais que l'éditeur a précisé que si le bouquin ne se rapprochait pas des deux-cents pages ça serait compliqué de le vendre à quinze balles.
Du coup on se retrouve avec cinquante pages de broderie pour commencer.
Une intro qui répète la quatrième de couverture. Un premier chapitre qui répète l'intro mais avec quelques illustrations.
Enfin deux autres chapitres supplémentaire pour aboutir au final à une définition qui tient en une demi-page et qui se suffit par ailleurs à elle-même.
On suivra [...] Denys Cuche :" aujourd'hui les grandes interrogations liées à l'identité renvoient fréquemment à la question de la culture. On veut voir de la culture partout, on veut voir de l'identité pour tous. On dénonce les crises culturelles comme des crises d'identité, la mode identitaire récente est le prolongement du phénomène d'exaltation de la différence qui a surgi dans les années soixante-dix et qui a été le fait de mouvance idéologiques très diverses, voire opposées, qu'elles aient fait l'apologie de la société multiculturelle d'un côté ou, au contraire, du chacun chez soi pour rester soi-même de l'autre côté." L'adjectif culturel que l'on emploie dans insécurité culturelle est donc une manière de voir la société à travers le prisme du tournant identitaire qui a lieu à partir des années 1960-1970.
En somme si je résume, ce n'est qu'à la page 49 que l'auteur nous avoue qu'en fin de compte il n'abordera son concept de l'insécurité culturelle que sous l'angle biaisé de la question identitaire.
Pourquoi virer toutes les autres interprétations du terme ?
Pourquoi ne pas questionner la menace que fait peser la dégradation de l'école sur l'accès à la culture ?
Pourquoi ne pas interroger la menace que fait peser la financiarisation et la mondialisation de certains milieux culturels sur la diversité de la production de biens culturels ?
Pourquoi d'ailleurs ne pas avoir appelé cet essai "le tournant identitaire" puisqu'en fait c'est visiblement son sujet ?
Tout ça pue l'imposture intellectuelle de la première à la dernière page et c'est tout simplement navrant.
Parce qu'à bien tout prendre, cette "insécurité culturelle" elle ne se réduit malheureusement qu'à ça.
Difficile d'y voir l'expertise d'un expert.
Ça ressemble davantage à une revue de presse abordée selon l'angle du "on se sent plus vraiment chez nous quand même vous trouvez pas ?"
...Enfin pardon je corrige : "les Français ne se sentent plus vraiment chez eux, j'ai trouvé ça en lisant La Croix."
(Et si vous trouvez cette dernière phrase un brin pathétique venant de la part d'un politologue, dites vous qu'elle résume malheureusement plutôt pas mal l'intégralité du chapitre 2...)
Au final, du coup, que tirer comme enseignement de cet essai ?
Eh bah au fond pas grand-chose.
Moi-même j'avoue qu'en le reparcourant vite fait pour écrire cette critique je n'ai su tomber sur rien.
En même temps je ne voyais pas quoi chercher.
J'ai lu ça sans que rien n'impacte vraiment.
C'était essentiellement de la banalité pour tout ce qui relève du premier tiers.
Quelques pics envoyés aux indigénistes et autres mouvements décoloniaux dans le deuxième tiers.
Et enfin le traditionnel "moajvévoudireskifofaire" dans le troisième tiers...
Enfin un essai quoi...
...Mais un essai vraiment pas flatteur pour son auteur, le fameux Laurent Bouvet.
Parce qu'en définitive il est là le coeur du sujet.
Le sujet ce n'est pas l'insécurité culturelle. Le sujet ce n'est pas le tournant identitaire. Le sujet c'est clairement Laurent Bouvet.
Ce bouquin a clairement été écrit dans la plus pure tradition politicienne qui consiste à pondre un livre juste pour le principe de pondre un livre ; celui-ci devant servir de prétexte à faire parler de soi et de ses thèmes.
Rien de plus. Rien de moins.
Le genre de machin jetable qui, d'ailleurs, est oublié sitôt publié...
...d'où ce contenu navrant et cette rigueur quasiment inexistante.
Alors si ce bouquin est un bouquin jetable que tout le monde a déjà oublié, pourquoi ai-je voulu vous en parler plus de six ans après sa sortie ?
Eh bien tout simplement parce que, quand bien même ce bouquin est déjà tombé aux oubliettes, la pensée qui l'anime, elle, est toujours d'actualité.
Car on retiendra peut-être (ou non) que 2021 (année de rédaction de cette critique) fut l'année où une ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche (Frédérique Vidal pour ne pas la citer) s'est targuée d'une sortie sur la nécessité de purger les facs de la gangrène islamo-gauchiste.
Or qu'est ce que l'islamo-gauchisme si ce n'est une autre insécurité culturelle ?
On ne prend jamais la peine de définir vraiment le concept. On confond en permanence les faits et le sentiment du fait, on s'appuie sur trois opinions boiteuses pour justifier le sérieux de l'analyse et derrière on se sert de tout ça pour régler ses comptes et surtout lâcher son traditionnel
moajvévoudireskifofaire...
Or, moi, ce qui me gave vraiment dans toute cette histoire, ce n'est pas forcément qu'on ose parler d'insécurité
culturelle, de tournant identitaire voire d'islamo-gauchisme... Mais c'est plutôt de voir comment on en parle !
Parce que l'air de rien, on se retrouve quand même là avec un politologue - prof à l'université de sciences politiques hein ! - qui débarque dans le débat comme un pochtron du café du commerce.
Il définit que dalle. Il exprime son ressenti. Il sort une vieille enquête d'opinion de son cul pour dire qu'il n'est pas le seul à penser ça (et que donc ça doit pas être totalement con ce qu'il dit) et surtout il ne prend pas la peine de vérifier si ce ressenti colle à une réalité.
C'est dire l'idée que ce type se fait de la politique, d'un essai politique, voire même de l'utilité de mobiliser les sciences sociales dans nos réflexions sociales...
...Alors que le mec est lui-même prof de sciences politiques à la fac !
Et ensuite on s'étonne que les sciences sociales ne soient plus prises au sérieux ?
Mais putain Bouvet ! Regarde toi dans une glace !
Elle est là ton insécurité culturelle !
Regarde comment, par tes écrits et par tes actes, tu menaces toute une culture !
Notre culture scientifique.
Notre culture de l'approche raisonnée des choses.
Parce que le pire dans cette affaire c'est que moi ça m'intéresserait de savoir si - effectivement - ces concepts sont valides ou pas !
Pour ma part, je me souviens très bien lors de mon passage à la fac que certains enseignants-chercheurs s'asseyaient déjà ostensiblement sur la déontologie scientifique pour refourguer leur came idéologique !
Et l'institution laissait faire tranquillou !
N'oublions pas que ce n'est qu'à partir de 2019 que certaines facs de médecine ont commencé à régler le problème de l'enseignement de l'homéopathie entre leurs murs !
Donc moi, si on me dit que les facs de sciences sociales subissent des détournements idéologiques de la part de certains courants politiques je suis prêt à l'envisager.
Mais ce que j'aimerais savoir par rapport à tout ça c'est tout simplement si ces accusations sont FONDÉES !
Qu'est-ce qu'on a comme exemples concrets ? Qu'est-ce qu'on a comme chiffres ? Si certaines études menées actuellement dans le monde de la recherche sont biaisées, où sont les biais ? Ou sont les vices ?
Bouvet prétend vouloir lutter contre l'obscurantisme et le dogmatisme ?
Eh bien dans ce cas qu'il n'en adopte pas les pratiques !
Qu'il oppose à l'ignorance et à l'ineptie culturelle de la rigueur intellectuelle ! Du raisonnement factuel !
Parce que là, que fait-il à part chercher à imposer ses concepts vaseux tout en aspirant à noyauter le milieu universitaire ?
Que fait-il à part définir des cibles sur Twitter ?
En quoi son action se différencie-t-elle franchement de ce qu'il combat ?
Bouvet veut défendre les universités ?
Il veut défendre les écoles ?
Il veut défendre protéger la société française face aux obscurantismes et aux populismes ?
Eh bien qu'il commence par lui-même !
Qu'à la prochaine fois où lui prendra l'envie de commettre un "essai" qu'il fasse preuve de rigueur et d'honnêteté intellectuelle !
Qu'il définisse ses concepts, ses champs d'études, ses sources !
Qu'il fournisse une vraie biblio ! Et qu'il s'en tienne aux faits !
Qu'il s'appuie sur de la stat et non pas sur un sondage paru dans la Croix !
Bien loin d'être une étude permettant de remettre de la raison dans le débat public, cette "insécurité culturelle" participe au contraire à l'installation d'une gigantesque hystérie collective.
Elle est au fond ce qu'elle décrit.
Or il serait peut être un peu temps que les gardiens du temple du savoir se rappellent sur quoi repose le savoir er surtout comment on le défend le mieux.
Car l'entretien et la diffusion de la culture scientifique, ça reste encore le meilleur moyen de lutter contre l'insécurité intellectuelle...