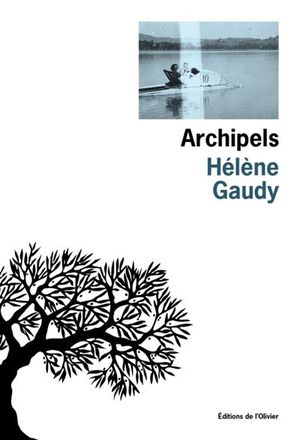Archipels fait partie de ces textes dont la beauté et la profondeur vous touchent après-coup, une fois la lecture finie. Le principe est banal et même trivial : l’autrice tente de reconstituer son père, être taiseux et mystérieux, à partir des objets qu’il a accumulés. Présenté comme ça, ça ne m’intéresse pas du tout : le plus beau livre sur le père de cette année (et peut-être bien plus) est le sublime Alors c’est bien de Clémentine Mélois, d’une beauté et d’une fantaisie à pleurer de joie. Et sur la question des traces, des objets et des archives, de ce qu’on laisse de soi après la mort, Sans valeur de Gaëlle Obliégly était remarquable. Je me disais donc que j’allais relire, en moins bien, deux livres encore frais dans mon esprit que j’avais beaucoup aimés.
On lit plus ou moins péniblement les quelques 300 pages. Certes, il y a de beaux moments, notamment l’introduction où l’autrice explique qu’elle se lance dans cette (en)quête après avoir découvert qu’une île étatsunienne, l’île Jean-Charles (le prénom de son père), est peu à peu engloutie par les eaux. Le parallèle la frappe : elle doit sauvegarder Jean-Charles (son père, pas l’île) avant qu’il ne soit englouti par le temps et la mort. Je ne suis pas insensible à la poésie qui émerge de certains fragments, mais je dois bien reconnaître m’être assez ennuyé en lisant le livre. Peut-être est-ce dû à l’écriture, volontairement simple et blanche, qui laisse toute la place au propos.
Et puis, on referme le livre, on réfléchit à ce qu’on vient de lire, et là, c’est vertigineux. Au fond, Hélène Gaudy utilise la littérature pour fixer le vivant. Elle écrit pour repousser la mort et sauver de l’oubli.
Peut-être écrit-on un peu parce qu’on détruit beaucoup, accumule-t-on surtout parce qu’on oublie trop vite, parce qu’on néglige tant de choses. / Parce qu’il faut bien trouver un lieu pour ce qui n’en a plus. (p. 55)
Que reste-t-il de nous après la mort ? Que transmet-on ? Qu’est-ce qui fait l’unité d’une vie ? L’originalité d’Archipels tient au fait que le père de l’autrice est toujours vivant. Il a lu le manuscrit, l’a annoté. Lui a donné des objets, des bribes de sa vie, ses carnets d’écriture, ses poèmes, ses lettres d’amour. On s’interroge avec elle, ému et pris de vertige par l’ampleur de la tâche : on ne peut jamais vraiment connaître les autres. Alors Hélène Gaudy creuse le passé, fouille la mémoire (l’enfance dans la guerre, le père résistant communiste, les premières amours), interprète, hypothèse. Cette quête de vérité est titanesque, infinie : c’est celle de la littérature. Et comme Sisyphe qu’il fallait imaginer heureux en poussant son rocher, nous sommes heureux·ses en lisant ces textes.
Grandir : réduire les émotions à la mesure du cœur, les amoindrir pour les attraper […] L’écriture lui sert de témoin, de preuve : assailli par l’essaim des pensées, il cherche à les saisir comme un chasseur d’insectes espère mieux voir, une fois la bête épinglée, les couleurs de sa prise. Mais les idées perdent leur éclat à être ainsi figées, elles deviennent des objets d’étude vidés de leur substance. Il les regarde : bavardes, inutiles. Il décide de se taire. Le silence est un travail d’oubli, une paix fermement négociée avec lui-même, et sa grande douceur, le prix fort de cette perte. (p. 166)