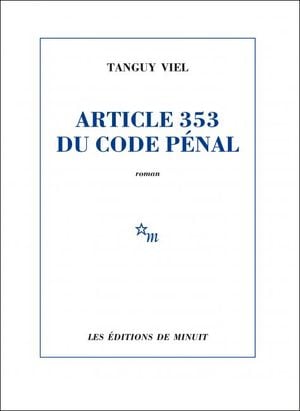Dostoïevski a écrit que le principal défaut des Français était de tant aimer leur langue qu'ils étaient capables de mener une conversation pour ne rien dire, pour le simple plaisir de s'entendre parler. Sa remarque s'applique à notre production littéraire contemporaine, dont une bonne partie consiste en des exercices de styles variés, généralement peu avares en mots.
Dans la catégorie des boulimiques, Tanguy Viel n'est pas le plus mauvais, loin de là. Ce récit d'un ancien ouvrier ruiné par un promoteur immobilier véreux et dont l'existence s'enfonce peu à peu dans les vases de la rade de Brest, simple, émouvant, s'achevant sur ce somptueux morceau de code pénal qu'est l'article 353, est davantage qu'un prétexte. Mais il y a tant de matière autour qu'on aurait envie de débroussailler pour le voir mieux.
Le roman, après la scène de crime initiale, consiste en un monologue de Martial Kermeur devant son juge. Problème : la langue utilisée par Tanguy Viel n'est pas crédible dans la bouche de ce quinquagénaire las. La mauvaise syntaxe, les hésitations, les répétitions, sont une chose. La transcription à l'écrit, et même l'enrobage du style, aussi. Ce que l'on ne peut imaginer dans la bouche d'un homme qui ne fait pas de littérature, c'est ce style plein de métaphores, de variations infinies sur le même thème, de complaisance pour sa propre langue. On dirait que l'auteur, partant de son personnage (et y revenant toujours, ce qui empêche le roman de se noyer tout à fait), se laisse ensuite emporter par sa plume. Un exemple choisi au hasard, il y en a plusieurs par page :
"Seulement, quand on était dedans, dans chaque année ouverte sur quelle bouteille de champagne, il n'y a jamais eu de carte IGN qu'on nous aurait distribuée le jour de l'an pour nous conduire dans les temps futurs. Jamais rien d'autre que les lignes un peu floues qu'on essaie chacun de dessiner pour suivre la pente des saisons, mais c'est tout."
La première phrase est du personnage; la seconde, théorique et vaguement poétique, de l'auteur. Que Martial Kermeur ait pu la dire, on n'y croit pas un seul instant. Sa logorrhée avance ainsi par boucle, partant de lui, s'en éloignant, arrivant dans les mains hâtives de son créateur qui y ajoute son emphase avant de renvoyer la pelote à son personnage. Mais la langue populaire est faite de peu de mots, de silences surtout, et quand elle accélère, s'envole, c'est parce que la pensée se débride : les mots ne prennent pas le dessus sur la pensée, il n'y en a jamais ou rarement trop.
L'excellent Martin Silénus dit dans Hyperion : "J'adore être poète. Ce que je déteste, ce sont ces putains de mots." Si nos contemporains pouvaient détester les leurs, un peu plus, juste un petit peu, leurs écrits y gagneraient peut-être.