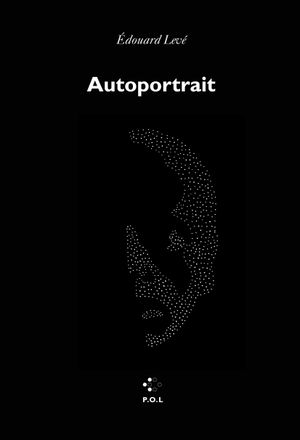L’insignifiance, l’indifférence, la superficialité. Voilà ce qu’on nous offre depuis cinquante ans (en général) sous forme de littérature et d’arts plastiques. Le moi, la nullité, l’absence de volume.
Je ne connais rien d’Édouard Levé. J’ai lu ce livre parce qu’il avait une bonne côte sur ce site. Bien mal m’en a pris. Ce livre m’a attristé.
Si c’est un autoportrait, Édouard Levé apparaît comme un privilégié sans projet, un dépressif ivre d’ennui, un dandy en carton, en vérité affreusement conformiste. Un personnage d’un roman de Houellebecq, fade et sans perspective. Un zéro satisfait. Il voyage un peu partout. Il baise dans des endroits chics. Il est à distance de tout, flasque de savon sans odeur, être banal porté par le courant. Il n’a rien à dire. Rien à défendre. Il représente l’abandon total de tout humanisme, de tout effort, la mollesse glaciale, le vide intérieur.
Je suis souvent étonné par le peu de choses que les gens privilégiés ont à offrir, par cet enfermement individualiste sans but, ce manque de personnalité, cette manière de s’avachir sans plaisir, de se vider de leur force vitale sans que personne ne puisse en profiter. Il n’y a plus de sens de la distinction.
On trouve dans ce livre, écrit comme un mode d’emploi sur une machine humaine, les recettes habituelles de la production artistique contemporaine. Fausse originalité. Fausse provocation. Apparence de rupture. Vide de l’expression. Absence de construction et d’élaboration. Absence de contenu réel, de prise de position réelle, de réflexion sur l’homme et sur la vie. Une porosité à la technicisation du monde, dont on se fait l’écho le plus lâche. Levé parle comme s’il alimentait son compte tweeter et tout ça nourrit l’écume des magazines culturels. On remarque qu’aucune personne réelle n’apparaît autre que la sienne, comme s’il avait vécu dans un monde uniquement constitué de caisses automatiques et de robots, d’images et de fonctions. Ses amantes, son frère, ses parents, ses amis, les inconnus qu’il photographie, ne sont que des hologrammes.
Le lecteur normalement constitué ne peut pas se souvenir, arrivé à la dixième page, de ce qui était écrit à la cinquième. Rien n’est développé. Tout est anecdotique et insignifiant. Ce sont des successions de phrases parfois bien trouvées, parfois teintées de mystère, parfois drôles, mais dont on ne tire aucune substance. Ce sont tout au plus des bons mots, des images intrigantes, des signes de reconnaissance (« ah, moi aussi ça m’est arrivé ça »). La belle affaire.
Le pire, c’est que c’est tellement plat, tellement familier, que cela donne à tout un chacun l’idée d’écrire son propre livre, avec la même absence de contenu, la même absence de profondeur. Peu de gens se sentent capable d’écrire l’équivalent d’un roman d’Henry James ou de Roberto Bolaño lorsqu’ils le terminent, mais tout le monde peut s’imaginer produire du Levé (ou à peu près n’importe quel faiseur de pacotille, de ce genre qui se présente comme artiste, écrivain ou autre). On en ressort perdant, en train de crouler sous les productions minables, toujours soutenues par une critique avide de titres nouveaux, de génies hebdomadaires, qui a besoin de consommer, de trouver le bon coup, la grande œuvre de la semaine, pour remplir ses pages et vider un peu plus nos capacités de jugement.