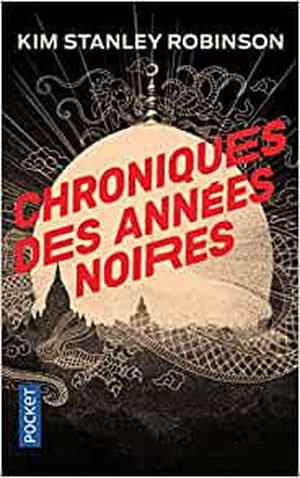En préambule, une question obsédante se pose. Pourquoi cette étrange traduction du titre original du roman de Kim Stanley Robinson ? Pourquoi ces Chroniques des années noires au lieu d’un titre approchant celui voulu par l’auteur ? Face à ce mystère, le lecteur ne peut faire que des suppositions, la pire étant de considérer qu’une Histoire où la civilisation judéo-chrétienne n’existe pas ne peut qu’être noire ! Cette interrogation est d’autant plus lancinante que le titre original convenait idéalement au contenu du récit, consistant à nous narrer l’évolution historique d’un monde dominé par deux grandes civilisations orientales : celle du sel (l’islam) et celle du riz (la Chine). Bref, passons.
En lisant ce roman, le lecteur doit se préparer à faire un long voyage balayant environ 700 années d’une épopée historique dense, au rythme nonchalant, car The years of rice and salt ne se dévore pas, il faut faire des sacrifices pour en apprécier intégralement la profondeur.
Comme tout le monde le sait, la population européenne a été anéantie par la grande peste en 792 du calendrier musulman (ajoutez 622 ans pour la datation chrétienne). Vengeance divine, cataclysme naturel, nul ne s’explique les raisons d’une telle pandémie et nul de comprend pourquoi le reste de l’Humanité a été épargné.
C’est à partir de ce point de divergence que Kim Stanley Robinson bâtit son roman et l’on sent poindre là l’uchronie. Cependant, le terrain n’est peut-être pas balisé aussi clairement qu’on le croit, car assez rapidement le récit se démarque du classicisme uchronique.
Tout d’abord, on se rend compte que les personnages principaux apparaissent à chaque époque, se réincarnant au fil du récit. Identifiables grâce à l’initiale de leurs prénoms successifs, ils endossent l’enveloppe corporelle d’hommes ou de femmes, voire d’animaux, dans la plus parfaite illustration des religions bouddhiste/hindouiste. Sous cet angle, The years of rice and salt apparaît comme une quête individuelle, thème que l’on retrouve d’ailleurs lorsque ces personnages se retrouvent dans le bardo (sorte de limbes bouddhistes) pour y être jugés par les dieux.
Ensuite, au lieu de se cantonner à une date précise de cette histoire parallèle, KSR prend le parti de nous raconter son évolution. Ainsi, le support historique n’est pas un prétexte pour le récit, mais la fin ultime, l’objectif principal de l’auteur. Il nous livre ainsi ses réflexions sur l’Histoire et sur le devenir des civilisations, en usant d’une approche axée à la fois sur le temps individuel et sur le temps long, celui des permanences sociales et mentales, écartant le temps court, celui des révolutions, des événements et des guerres.
Au passage, signalons que les spéculations de KSR se frottent au concept de choc des civilisations, n’hésitant pas à dénoncer les schémas déterministes qui obscurcissent nos réflexions. Dans cette démarche, la part accordée au rôle des femmes est d’ailleurs exemplaire.
Finalement, c’est cette réflexion ambitieuse sur l’Histoire qui permet d’affirmer que The Years of Rice and Salt a tout à fait sa place aux côtés de livres d’historiographie sérieuse, ce dont les littératures de l’imaginaire ne peuvent que s’enorgueillir.
Aparté : Pour qui désire s’informer sur les différents temps de l’Histoire (temps individuel, temps court, temps long, temps immobile), il existe un excellent ouvrage de Fernand Braudel : Écrits sur l’Histoire. Cet auteur s’inscrit dans la lignée de l’École des annales qui propose de repenser l’espace-temps de l’Histoire.
Source