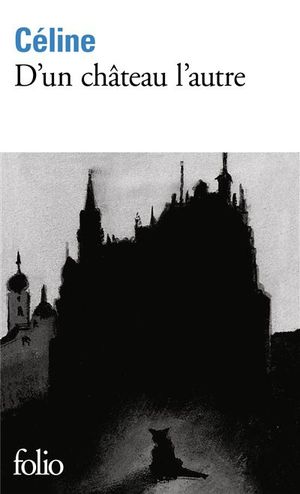Cela faisait un bon moment que j’avais envie de me replonger dans Céline. Avec D’un château l’autre, cela n’a pas été tout de suite l’enthousiasme que j'espérais. Bien au contraire. D’un point de vue formel d’abord, il faut se faire à une ponctuation faite presque exclusivement de points d’exclamation et de suspension, de moignons de phrases sans verbes, etc. Je ne me souvenais pas d’une impression aussi nette de logorrhée pour le Voyage ou pour Mort a Crédit. Et puis, pour ajouter à l’irritation du lecteur, il y a ces justifications permanentes, ce discours du ressentiment, cette volonté de prouver que la victime n’est pas là où on le croit. Céline n’ayant par ailleurs aucun scrupule à présenter son activité d’écrivain comme des plus prosaïquement alimentaires, on a bien du mal à y voir de fait autre chose qu’une tentative, sinon de réhabilitation pour son cabinet médical en perte de clientèle après le discrédit des années de collaboration et de prison, du moins de financement du ménage et de sa ménagerie meudonnaise.
C’était donc la première phase, où au fond, je n’avais pas le sentiment de lire un roman, mais une sorte de pamphlet mal écrit, sans arguments solides et aux visées confuses. Puis vient un moment (au bout de plus d’une centaine de pages pour moi) où l’on ne voit plus le récit autobiographique et la justification personnelle, mais la mise en scène par Céline de lui-même et de l’histoire. Et là, cela devient à la fois très drôle, improbable, inventif et fascinant. C’est drôle parce qu'on trouve à ce moment un grand plaisir à lire ce style "pratique", et parce que Céline ne quitte en aucune circonstance son sens de la cocasserie, qui fait que ses personnages ont tous l’air de sortir d’un film de Kusturica, comme une cohorte de fous constamment prêts aux pires extravagances. Et en même temps il s’agit le plus souvent (mais pas toujours) de personnages et de circonstances historiques ; cette lecture des événements, aussi fantaisiste puisse-t-elle paraitre, a donc aussi une valeur de témoignage, certes subjectif mais unique, donc crédible par forfait en quelque sorte, sur la débâcle intellectuelle et morale du clan collaborationniste réfugié à Siegmaringen à la fin de la guerre. Dans ce grand jeu de mise en scène, la récrimination prend une autre dimension, Céline utilisant les diatribes de son personnage pour confesser, à sa façon certes détournée, ses faiblesses et celles d’une classe politique rongée par la peur sous un habit de façade (cf. cette scène étonnante ou le narrateur donne à Laval la capsule de cyanure que le personnage historique utilisera plus tard, pour tenter de se suicider avant son exécution – frontière toujours floue entre la fiction et l’histoire, ce que l’on retrouve tout au long du roman). D’un château l’autre, c’est finalement l’épopée comico-tragique de la France qui n’a pas voulu dire non, pour ne pas s’attirer d’ennuis peut-être, voire pour être aimable, comme le Dr Destouches qui se laisse manipuler sans broncher par les rares et inutiles patients qui lui restent – mauvais payeurs et peu soucieux des impossibles contraintes qu’ils génèrent pour leur médecin. Dans ce rôle méprisé, et parfois méprisable, Céline et son personnage dessinent le profil d’un anti-héros absolu – ce qui les rend au bout du compte captivants.