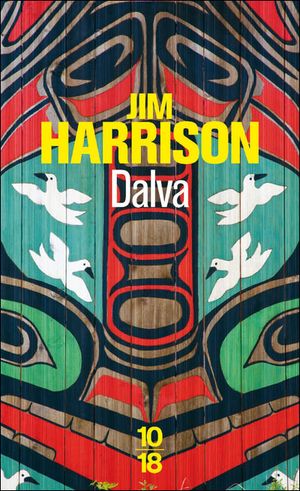C'est un roman testimonial, qui témoigne de l’histoire des amérindiens et de la vie rurale mais aussi de plusieurs représentations de la nature . À travers un récit polyphonique, l’écrivain dévoile les cicatrices indélébiles du passé et lutte pour préserver l'essence même de la vie sauvage. Dalva semble faire une synthèse entre de nombreuses dichotomies, notamment celle de nature et culture et par extension celle de science et spiritualité. En effet, une part importante d’irrationalité se mêle à la science pour faire naître une connaissance profonde du monde.
L'écriture polyphonique de la nature
Le nature writing donne aux grands espaces le rôle central du livre et au narrateur le rôle de l’observateur attentif. Une place importante est dédiée à la description d’un mouvement naturel ou d'un détail de la faune et de la flore. Par exemple, les mouvements du ciel sont très souvent exprimés, de jour : « La pluie s’est arrêtée, un soleil brûlant est sorti des nuages et le ciel s’est dégagé », comme de nuit : « J’ai passé toute une nuit à ma fenêtre pour regarder la lune jusqu’à ce qu’elle se couche juste avant l’aube. Elle s’était levée rouge, avait virée au rose, puis au blanc, puis au rose et au rouge en descendant vers la terre – une lune d’été ». Cela donne au roman un rythme lent mais une lenteur précieuse qui contraste avec la pensée de ceux qui sont incapables de voir la nature à cause de son inutilité pour les systèmes humains. En accordant à la nature d'être personnage plutôt que cadre de l'expérience humaine, l'on renverse les valeurs être et avoir d'un système.
Mais, ce nature writing cache un paradoxe qui tient à la polyphonie du roman. En effet, lorsque le point de vue est celui de Dalva, la nature n’est pas représentée de la même façon que lorsque c’est son amant, Michael. A la lecture de la première partie, tenue par Dalva, l'écriture de la nature procure des sentiments de liberté, d'évasion et de renouveau. Seulement, la nature est une force qui n’est pas tenue d’être gentille avec l’homme et Michael semble s’être dévoué pour le démontrer, au demeurant avec beaucoup d’humour. A son arrivé au ranch familial, Michael devient le narrateur. Celui-ci accorde davantage d’importance aux hommes et aux choses qu’à la nature. Mais, il va revenir de son indifférence par la force des choses en décidant de faire une sieste sur un « tas de cailloux » avant que d’être réveillé par des « serpents noirs qui se chauffaient au soleil ». Jim Harrison s’amuse avec son universitaire érudit en le rendant particulièrement niais au contact de la nature. Au comble de sa bêtise, Michael sera « intrigué » par « des tas de boulettes marron, grosses comme des billes », allant jusqu’à en ramasser pour les palper et les renifler avant de découvrir leur nature d’excrément. Si l’auteur le fait avec beaucoup d’humour, il ne manque pas moins d’insister sur les risques que Michael prend en ignorant tout de la nature. Par ce dualisme, l'auteur propose une synthèse, qui, tout en défendant les beautés spectaculaires et épanouissantes des paysages rappel leurs violences. De fait, les amants, ensemble émettent l’idée nuancée et complexe de sublime – et le lecteur en se laissant guider par l’auteur perçoit la majesté effroyable et inhumaine de la nature tout en préservant l’envie d’être intime avec celle-ci.
Un éloge de la marche
Le roman Dalva offre une matière riche et émouvante entre rêve, spiritualité et poésie. A travers la fiction, Harrison montre l’importance de la marche dans la construction de l’individu et de son rapport à l’altérité. Le rythme de la marche permet la rêverie ; c’est une forme d’accès individuel à la transcendance car la nature est le lieu où la conscience se connectent aux lois intemporelles qui régissent le cosmos, le lieu où nous comprenons intimement que nous sommes un élément d’un grand tout inconnu et universel.
Chacun doit accepter son lot de solitude inévitable, [...] nous ne devons pas nous laisser détruire par le désir d'échapper à cette solitude. Appuyée contre l'abreuvoir au fond de cette vallée, j'entendais le vent et la respiration du chien et du cheval. Les souvenirs de tous les gens que j'avais connus m'ont traversé l'esprit avant de se perdre dans l'air, avec l'impression que l'écho de leurs voix ressemblait aux voix des oiseaux et des animaux - Dalva
Grâce à la solitude vécue dans la nature, l’on comprend que fuir la solitude c’est avant tout renoncer à connaître l’harmonie universelle. La marche s’ouvre sur une communion avec la nature qui replace l’individu parmi le vivant. Dalva en fait l’expérience et l’exprime ; le sentiment de la nature se mêle à la nostalgie pour créer une danse lente et profonde qui fait surgir le passé dans le présent dans l’explosion d’un sentiment ineffable et silencieux
J’ai commencé à me promener à ton âge tout simplement parce que la nature semblait absorber le poison qui étant en moi - Paul
Par ailleurs, la marche s’ouvre aussi sur l’introspection ce qui teinte le roman d’une magnifique nostalgie comme si Harrison avait l’ambition de remplacer, pour un instant, les promenades. Le rythme plus lent des pas qui contraste avec celui d’un cheval ou d’une Ford, permet de prendre le temps de guérir. Paul le reconnaît et le transmet à Dalva qui vient de perdre son bébé : « Je me débarrasse du bébé en marchant […] quand le rythme de la marche s’est instauré et que je me suis sentie apaisée ». Ainsi, l’homme se soigne en parcourant, il mime la fuite en avant, mêlant bien-être et cette étrange sensation de comprendre la terre.
O Mitakuye Oyasin
Enfin, ce roman démontre que le spirituel ne vient pas d’une non connaissance mais justement d’un rapport réel à la nature. Dans la pensée amérindienne être pierre, être fleuve, être bête sont autant de modes d’être rassemblés sur une même scène ontologique - cette reconnaissance est une façon d’honorer d’autres styles d’être dans le sensible et de cultiver les relations entre humains et non humains. La salutation lakota "O Mitakuye Oyasin" (à toutes mes relations) veux dire que tout est reliés. Ainsi, cette littérature empreinte de la philosophie sioux semble écouter les choses et employer son effort à comprendre ce qui ne parle pas et pourtant signifie. En effet, lorsque Dalva habite proche du Pacifique, elle l'écoute pendant des jours et des nuits, et se met à imaginer un langage commun, « peut-être un langage non verbal, frisant la folie, le murmure du sang dans les veines, le chuintement de l’eau qui reflue » mais un langage malgré tout.