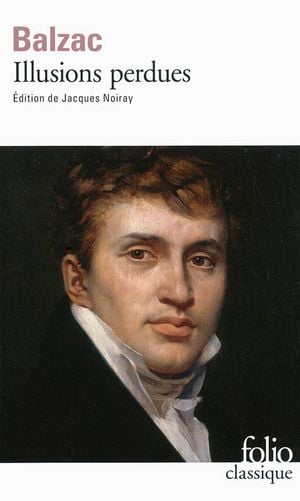J’ai envie d’aller à contre-courant des critiques sur ce roman et de mettre en lumière deux points qui me semblent oubliés dans les critiques que j’ai pu en lire : la province et la morale.
En effet, si l’on m’avait demandé, à peine avais-je fini ma lecture, de raconter l’intrigue du roman j’aurais certainement dit « c’est l’histoire d’un poète raté qui « monte » à Paris, parce qu’il aime une vieille riche et qu’il veut percer dans la littérature ». À y repenser, même si j’avais enrobé tout ça de grandes envolées lyriques, ça n’aurait pas été bien convaincant. En effet, je pense que la fresque du monde littéraire parisien qui nous est donné à lire dans Les Illusions Perdues nous fait oublier que l’œuvre appartient aux « scènes de la vie de province » de la Comédie humaine. Les Illusions Perdues ne peuvent se résumer à la description, aussi méticuleuse qu’elle soit, de la vie parisienne du XIXème siècle. Au contraire. Le roman donne à lire une image pittoresque, parfois pathétique, de la vie provinciale de cette époque. Si Paris est, ça n’est qu’en tant qu’extension de la province. On la découvre au travers des yeux naïfs d’un provincial ambitieux. De même, l’action ne se concentre pas uniquement sur Lucien, mais plutôt sur Lucien et David, qui sont tous deux des provinciaux aux destins croisés, mais opposés. Il ne serait pas juste, comme en atteste la quatrième de couverture de l’édition en ma possession, de prétendre y lire un roman sur Paris, un roman sur Lucien. Je pense que cela revient à nier le caractère bicéphale de l’œuvre, son alternance entre Lucien et David, entre Paris et Angoulême. L’œuvre est, à mon sens, l’illustration de la crispation qu’exerce la capitale sur la province bien plus qu’une simple description de Paris.
De la même façon, la précision avec laquelle Balzac s’attache à décrire le monde de la papeterie, aussi épuisants que puissent être les longs développements qui ponctuent l’ouvrage – oui je dois avouer que les longs discours sur la fabrication du papier ça ne m’excite pas vraiment – , masque le fait que chaque description répond à l’impératif moral que s’est fixé l’auteur. L’ensemble des procédés descriptifs sont au service d’une moralité prégnante dans l’ouvrage. Balzac, à propos de cette œuvre, parlait d’ailleurs d’une «glorification de la vertu ». L’analyse du monde éditorial, du milieu journaliste, des procédures judiciaires répond à ce besoin de souligner les vices d’une époque où l’argent règne en maître. De la même façon, le parcours des personnages donne à lire un schéma parfois manichéen du bien et du mal, où la vertu est récompensée quand le vice condamne à la damnation éternelle
(comment lire autrement l’idée du pacte que passe Lucien avec Carlos Herrera?). La scène finale mettant en scène David et Ève illustre la récompense matérielle offerte à ceux ayant vécu une longue vie de labeur dans la vertu. Ces dernières pages sont christiques. Si Lucien se condamne à l’enfer moral, Ève et David jouissent d’un bonheur aux apparences d’éternité, où les rires de leur enfant résonnent sous l’oranger.
Alors c’est peut-être pour essayer d’attirer l’attention sur d'autres lectures des Illusions Perdues que j’essaie de me persuader que Lucien ne cristallise pas tout l’intérêt de l’ouvrage. Évidemment, l’attachement que j’ai éprouvé pour ce personnage – et que j’éprouve encore – a parfois rendu compliqué mon attrait pour des intrigues que je jugeais subsidiaires. Mais je pense que la force des Illusions Perdues réside véritablement dans cet entrelacement des intrigues et des lieux, dans cette imbrication qui existait déjà à l’époque entre Paris et sa province, dans le rôle pédagogique dont s’était affublé Balzac – autant d’éléments que l’on oublie souvent.